Quelques photos et la position du leader historique des Sex Pistols…

Le dernier ouvrage de A. Atkinson et une réflexion originale sur la fracture numérique mondiale
Les points (aiguilles) sur cette carte correspondent aux endroits dont proviennent les voyageurs passés par l’Islande. Commentez. Vous avez un quart d’heure.
Une synthèse sur la pauvreté en France, dans “Sciences Humaines” (avril 2019)
” No one is Homeless. What is Missing?”
Un article de prospective… avec quelques questions majeures.
À télécharger ICI
Les drames de l’immigration échouée sur les côtes et dans les rues européennes alimentent les deux chroniques lacrymale et sécuritaire. Un paroxysme est atteint dans certains points de fixation qui contribuent à la bidonvillisation de certaines parties de villes. Les populations s’émeuvent de la misère et s’inquiètent de sa proximité. Un mélange de témérité individuelle de migrants qui n’ont pas grand-chose à perdre et d’industrie mafieuse de traite des êtres humains nourrit des réactions vives, bien compréhensibles, de populations se retrouvant au voisinage immédiat de nouveaux campements et bidonvilles. L’aggravation de la crise migratoire – pression démographique, tensions géopolitiques internationales et incurie politique européenne obligent –conduit à penser que le phénomène n’est pas appelé à s’essouffler. Le problème des migrants et des campements n’est pas un sujet du présent, mais assurément un sujet à mieux traiter demain.
Naturellement, de multiples points de vue s’opposent, de façon très vive. Une manière de voir, cherchant à comprendre plutôt qu’à justifier ou invectiver, consiste à recourir à l’histoire et à la sociologie, dans une perspective longue. Les sciences sociales, de qualité, aident à baliser l’actualité plutôt qu’à en faire le commentaire dépité, enthousiaste ou cynique. On soutiendra ici que la compréhension de la crise actuelle doit partir d’un constat très prosaïque : le ping-pong auxquels sont contraints les autorités, à tous les niveaux. Et on soutiendra qu’il y là, au fond, un problème assez classique de l’histoire du vagabondage. Certes les termes ne sont pas forcément bien adaptés. Le recours, imagé, au jeu de ping-pong peut sembler plus ironique que descriptif. Il est pourtant souvent employé et on le conservera car il désigne indubitablement une réalité. Plus au fond, les contenus juridiques de ce qu’étaient les vagabonds et de ce que sont les migrants, réfugiés, sans papiers ou encore demandeurs d’asile ne sont pas les mêmes. On trouve, parmi ces catégories, des nationaux, des européens, des illégaux. Ils sont tous, de facto, deux points communs : l’indigence et l’errance. Dit de manière plus simple, ceux que l’actualité désigne comme migrants sont des vagabonds, les vagabonds de l’ère de la mondialisation.
Vagabondage et mendicité font, au moins en Europe, l’objet d’interventions publiques depuis très longtemps. A partir du milieu du XIVème siècle, le contrôle de la population errante devient la grande affaire d’ordre des Etats monarchiques. Avec le contrôle de ceux qui échappent aux communautés et aux solidarités locales, l’Etat expérimente incriminations, châtiments et tentatives de réhabilitation, s’affirmant de la sorte contre les pouvoirs locaux. Depuis lors, les possibilités de communication et les vitesses de déplacement ont considérablement augmenté. C’est maintenant à l’échelle européenne que le problème se pose. Pour étayer un tel argument, on s’inspirera de la manière dont le sociologue néerlandais Abram de Swaan, dans la suite des travaux fondateurs de Nobert Elias, analyse l’évolution de la prise en charge des vagabonds et des mendiants, parallèlement à la montée en puissance des Etats centraux.
Du ping-pong local au ping-pong national
D’abord, comment caractériser la gestion collective des migrants, réfugiés, sans-papiers, demandeurs d’asile (on ne sait trop quel terme privilégier) ? La métaphore du ping-pong, qui peut se discuter, est souvent employée. On parle aussi parfois de pousse-pousse, d’un campement dont on fait décamper les habitants à un autre campement où ces habitants viennent s’implanter. Ping-pong, pousse-pousse, l’idée est la même. Théoriquement, le sujet relève de la théorie des jeux et de la faible capacité, sans incitations, à coopérer. Prosaïquement, on ne règle pas, mais on déplace. D’un site à l’autre on repousse, d’une ville à l’autre on transporte, d’un pays à l’autre on renvoie les personnes et les responsabilités. Ce ping-pong, qui se joue d’un bidonville évacué à un nouveau campement établi, de pays aisés mais inquiets à des pays en guerre et détruits, mais aussi entre villes et pays plutôt bien lotis, n’est pas chose neuve. Il s’agit de la version contemporaine et internationalisée du problème pluriséculaire du vagabondage et de la mendicité.
Au Moyen-Age, en Europe, il s’agissait de savoir pour une paroisse, une petite communauté, si elle allait accueillir ou repousser des indigents qui n’y étaient pas établis. Le problème soulevé par l’accueil de pauvres venus d’ailleurs s’est avéré non pas un sujet de moyens et de finalités mais un problème de coopération. Un dilemme classique de l’action collective. Si la paroisse se fait accueillante, que vont faire les autres ? Toutes pourraient profiter de l’occasion pour se débarrasser de leurs pauvres. Les communautés n’avaient, en effet, que deux possibilités : accueillir les pauvres qui se présentaient à leurs portes ou les renvoyer. Si une communauté, pour des raisons religieuses ou politiques, décidait d’accueillir, elle n’avait aucun moyen de savoir si les autres collectivités allaient faire de même ou si, au contraire, elles n’allaient pas profiter de cette offre d’accueil pour se décharger de leurs propres pauvres et renvoyer tous les errants. L’équilibre et la coordination du système de secours aux indigents et/ou de coercition des vagabonds, organisé au niveau local, étaient recherchés au niveau régional. Mais rien ne pouvait contraindre une autorité locale à agir dans un sens ou un autre.
D’où la nécessité de faire émerger des autorités régionales en charge du traitement, surtout répressif, du vagabondage, en obligeant les communautés locales à la coopération. Les moyens de communication et de déplacement se développant, ces autorités régionales ont connu le même dilemme, à une échelle donc plus large. Il a fallu que s’affirment les Etats nation afin de tenter de réduire le jeu coopératif instable des régions. Avec le développement des villes et de leurs interdépendances, l’Etat, partout en Europe, est ainsi intervenu pour qu’un équilibre régional des secours s’ajoute aux systèmes charitables locaux devenus insuffisants. La première tentative d’un équilibre territorial plus large fut, en Angleterre, le système des « Poor Laws » et, en France, le « grand renfermement » du XVIIème siècle. Les « lois sur les indigents » constituent un ensemble de textes, dont les plus importants datent du XVIIème siècles, visant à contrôler et fixer les vagabonds et autres indigents dans les paroisses anglaises. Sur certains sites, certaines catégories de pauvres pouvaient se voir allouer une allocation de subsistance. La plupart du temps, il s’agissait de chercher à les faire travailler au sein de « workhouses », des hospices à très stricte discipline. En France, l’initiative de Louis XIV, rapportée de façon discutable par Michel Foucault sous ce nom de « grand renfermement », crée l’hôpital général, à Paris d’abord, dans les provinces ensuite. Des bâtiments, les hôpitaux généraux, étaient édifiés ou transformés pour y enfermer les pauvres afin de mettre fin au vagabondage. Au même moment naissait l’idée des ateliers de charité. Les pauvres n’étaient plus simplement enfermés pour être entretenus ou punis. Ils se voyaient proposer une tâche qui devait les convertir, les punir, les guérir ou les rééduquer. Le principe était d’employer les pauvres valides dans un système de secours autofinancé. Cette idée de créer une certaine autarcie de l’assistance donna l’illusion d’une issue au dilemme entre accueil et renvoi qui accablait le système de collectivités autonomes. Mais les ateliers, comme d’ailleurs les workhouses au Royaume-Uni, avaient peine à s’autofinancer et ils étaient critiqués par les entreprises voisines qui y voyaient une concurrence déloyale. Le pouvoir central joua alors un rôle décisif en soutenant les villes et en apportant financements et/ou commandes à des atelier ou à des hôpitaux. Par la suite les vagabonds et autres indigents sans résidence stable ont glissé du droit pénal au droit social. Les « poor laws » ont été abrogées et les hôpitaux généraux ont changé de destination. Mais l’intervention de l’Etat, ne visant plus seulement la lutte contre la criminalité mais aussi la lutte contre la pauvreté, a continué son affirmation. La participation de l’Etat dans la lutte contre le vagabondage et dans l’aide aux pauvres n’a ainsi cessé de croître. L’autonomie communale s’est effacée devant l’émergence d’un Etat central de plus en plus puissant pour gouverner les communautés de son territoire.
L’histoire de la prise en charge du vagabondage éclaire les phénomènes actuels. La leçon de cette rapide reprise, c’est que des communautés autonomes se révèlent incapables d’action collective pour gérer le vagabondage sans autorité centrale régulatrice. Les interventions de l’Etat ont pour objet, dans ce cadre, d’organiser la surveillance des déplacements et la coopération entre les villes. Mais ces interventions sont dépassées dans un cadre international plus ouvert.
Du ping-pong national au ping-pong global
Passée du local paroissial au national étatique, la gestion de la question des vagabonds, rebaptisés sans-abri, a muté avec l’ouverture et l’élargissement progressifs des frontières européennes. Désormais les sans-abri peuvent, plus ou moins aisément, aller d’un pays à l’autre, en fonction de préférences personnelles, du niveau d’offre collective d’un territoire, de l’accent mis sur la répression ou l’accueil par les municipalités.
Depuis quelques décennies, alors d’ailleurs que les délits de vagabondage et de mendicité ont quitté les différents codes pénaux européens, le problème du traitement du vagabondage s’est ainsi étendu à une échelle plus large. Du local, puis au régional et au national, le sujet s’aborde aujourd’hui pleinement à l’échelle globale. La crise paraît aujourd’hui intense, au regard des évènements de ces mois récents et de la fixation de l’intérêt sur les cas de Calais et de Dunkerque, mais le sujet était déjà présent en ces termes globaux, avec les Maliens (on parlait alors des « Maliens de Vincennes ») qui campaient au début des années 1990 dans Paris et sa périphérie. Si l’épisode a été un peu oublié, il faut simplement rappeler qu’aux files d’attente des distributions de repas, réapparues dans les rues françaises dans les années 1980, parler français était alors suffisant. Dans les années 1990, dans les suites de l’éclatement du bloc soviétique et de la crise yougoslave, il a fallu s’habituer à tenter de parler d’autres langues, celles des pays de l’Est. Depuis les années 2000, et avec accroissement du phénomène par les crises afghane, libyenne, syrienne, irakienne, érythréenne, s’est ajoutée la nécessité de parler des langues extra-européennes. Cette extension du périmètre de la problématique classique du vagabondage illustre aussi ce qu’est la mondialisation. Mais ce n’est pas la mondialisation des capitaux et des cadres supérieurs. C’est une mondialisation par le bas. Et les nations sont engagées dans un jeu de ping-pong entre Mayotte et les Comores, entre les Etats membres de l’Union européenne et ceux qui se trouvent de l’autre côté de la Méditerranée ou à l’Est de leurs frontières, entre la France et certains Etats-membres en ce qui concerne une partie des habitants des bidonvilles qui sont des ressortissants européens. Dans tous les cas, il y a ping-pong, avec des prestations sociales et/ou sécuritaires, pour repousser et renvoyer. Le jeu se déroule à partir du barème des prestations sociales comme à partir du droit de résidence. Du local on est ainsi pleinement passé au global, au moins, incontestablement, à l’européen. En témoignent d’ailleurs les propositions et hésitations de l’Union, en conflit parfois ouvert avec certains Etats membres, au sujet, en quelque sorte, du partage du fardeau.
Aujourd’hui, dans une Union européenne aux frontières globalement ouvertes, la nouvelle échelle de la gestion de la question des sans-abri et autres migrants sans ressource est communautaire. Ce sont maintenant, à certains égards, plus les villes et l’Union que les régions et les Etats qui peuvent valablement agir.
L’alternative, dans un espace Schengen encore ouvert est simple. Il faut fermer les frontières pour tenter de traiter nationalement le vagabondage. Ou bien, constatant en l’espèce l’épuisement et le dépassement de l’Etat nation, il faut totalement européaniser le traitement, sécuritaire et social, de la question. Tout le reste relève du concert de pipeau.
Abram de Swaan, Sous l’aile protectrice de l’Etat, PUF, 1995, (1ère éd. 1988).
Abram de Swaan, Social Policy beyond Borders. The social question in transnational perspective, Amsterdam University Press, 2002
Les uritrottoirs, ces quelques pissotières à vocation écologique installées cet été à Paris, ont occupé une bonne place au palmarès des farces estivales. La polémique enclenchée, les quolibets suscités et les équipements dégradés n’arrangent rien aux affaires d’une municipalité empêtrée dans les échecs des Vélib’ et Autolib’. Le caractère ridicule d’un équipement réservé à des messieurs pouvant se soulager en public ne semble même pas surprendre une mairie pourtant prompte à donner des leçons de genre. L’argument écologique a été avancé : il s’agit d’innovations permettant la récupération des urines et leur transformation en fertilisants. On ne le comprend pas bien. Car plutôt que de nouvelles pissotières spécifiques et symboliques, il faudrait plutôt organiser une récupération généralisée. La maire de Paris rejoindrait, dans l’histoire de l’humanité, l’empereur romain Vespasien. Celui-ci, dont le nom est passé à la postérité avec les vespasiennes, avait établi une taxe pour les personnes urinant dans des lieux publics dédiés, leur production étant recyclée pour les teinturiers.
Le sujet prête d’abord les goguenards à glousser. Il n’en reste pas moins extrêmement sérieux. Les toilettes publiques méritent un effort d’attention. Endroits particuliers, plus ou moins familiers, au cœur de la ville, des restaurants, des gares, des écoles ou des universités, tous ces WC, loin d’être tous aisément accessibles et gratuits, sont des toilettes publiques. Public et toilette sont d’ailleurs des mots, comme le diraient les Beatles, qui ne vont pas forcément bien ensemble. Utiliser les commodités publiques engage des comportements particulièrement privés. Il en va des plus stricts secrets personnels, comme de règles collectives de civilité et de propreté.
Les évolutions des WC, toilettes publiques, sanisettes, et autres latrines ne constituent en rien un problème annexe ou marginal. Au contraire –il s’agit d’un thème important de la vie quotidienne, différenciant clairement les hommes des femmes, les jeunes des vieux, les riches des pauvres, ceux qui ont un logement de ceux qui n’en disposent pas. Concrètement, il s’agit bien d’un problème crucial pour les corps humains dans les environnements urbains contemporains.
Or ces toilettes publiques manquent dans les grandes villes françaises. Certaines d’entre elles, dont Paris, investissent dans des solutions qui peuvent s’avérer coûteuses et qui ont toujours du mal à s’insérer dans le paysage urbain. Mais les besoins – si l’on peut se permettre l’expression – demeurent criants. Avec des populations à la fois plus mobiles, plus diverses et vieillissantes, chacun peut se sentir concerné et tout le monde a déjà pu faire des expériences, plus ou moins heureuses. Il en va de sans-abri condamnés à l’indignité, jusqu’aux touristes interloqués par la malpropreté française, en passant par n’importe qui surpris par la nécessité.
Jusqu’au début du 18ème siècle, nous disent les quelques historiens qui ont bien voulu se pencher sur le dossier, la présence et le côtoiement de l’ordure et des mictions auraient modérément rebuté les paysans des campagnes comme les habitants des villes. Puis les seuils de tolérance, notamment olfactifs, à l’égard de la proximité des selles et déchets se seraient progressivement abaissés. Avec le développement parallèle de l’urbanisation et de l’hygiénisme, les municipalités vont prendre des initiatives pour l’implantation d’installations spécifiques. Naissent alors les premiers mobiliers urbains dévolus aux besoins humains les plus basiques. Les ancêtres des sanisettes modernes, baptisés alors « cases d’aisance » ou « chalets de nécessité », sont réservés aux hommes. Ces équipements resteront longtemps exclusivement masculins. Ils ne se féminiseront qu’au début des années 1980 avec ce que les observateurs avisés ont appelé les sanisettes Decaux.
Entre les deux guerres, Paris comptait plusieurs centaines de vespasiennes. Celles-ci ont connu une forte érosion de leur fréquentation et de leur réputation, à mesure que les logements devenaient mieux équipés en sanitaires. Décriés, depuis l’origine, comme nids de maladies, lieux de trafics, sites de rencontres et de relations réprouvées, ces équipements ont sombré dans la réprobation, à mesure du déclin de leur usage collectif. La raréfaction des toilettes publiques est même devenue, à certains égards, une politique publique. Dans certaines villes, le rasage des toilettes publiques a été une technique explicite visant à repousser les indésirables.
La disparition des toilettes ou la tarification même minime de leur accès ont le même type d’effets. Ceux à qui on souhaitait en interdire l’accès ne s’y rendent plus, mais ils deviennent plus visibles encore en étant obligés de se soulager directement dans l’espace public, devant tout le monde. Par ailleurs tous les passants qui n’ont pas de monnaie ou qui ne trouvent pas de sanisettes sont conduits à des précautions et à des retenues désagréables, ou bien, en dernière extrémité, à devoir trouver des solutions, dans des endroits qui ne sont pas prévus pour cela… Le dilemme se pose de manière évidemment disproportionnée pour les personnes dépourvues d’espaces et de toilettes privés. Les SDF, sans domicile ni offices privatifs, sont en permanence confrontés aux contraintes de la nécessité.
À Paris, la question des toilettes publiques a fait l’objet de nombreuses discussions au Conseil de Paris, à la passation de contrats, de marchés, de conventions de délégation de service public. Elle fait couler un peu d’encre. Mais elle ne fait pas encore véritablement l’objet d’une politique ambitieuse, de développement, d’adaptation aux transformations d’une vie parisienne plus mobile.
Soulignons tout de même que Paris a délivré, en quelque sorte, son laisser pisser au milieu des années 2000 en rendant gratuit l’accès aux toilettes publiques gérées par ou pour la municipalité. Du côté répressif elle a engagé plus récemment un plan dit anti-pipi. Une brigade contre les incivilités, montée en 2018, verbalise afin de tenter d’éradiquer, à coup d’amendes à 68 euros, les « épanchements d’urine sauvages ». Mais le Parisien reste sale et l’offre insuffisante. La ville dispose tout de même de plus de 400 édicules, dont 150 ouverts 24 heures sur 24.
Dans bien des lieux publics (gares notamment) la tarification est cependant encore de rigueur. Recourir aux bars, restaurants, hôtels, requiert des moyens ou, à défaut, de l’aplomb afin d’apaiser les envies les plus naturelles. Une voie originale pour développer le nombre de toilettes ouvertes au public consisterait à soutenir, avec des subventions bien dirigées, les bistrots classiques comme les chaines internationales. Aujourd’hui, aucune obligation ne pèse sur eux et ils peuvent légitimement refuser l’accès aux non-clients. En leur déléguant une forme de service public des servitudes d’aisance, en contrepartie d’un financement incitatif, Paris innoverait vraiment. La ville Lumière pourrait faire coup-double : d’une part, humaniser les espaces publics urbains ; d’autre part, contribuer à la sauvegarde de ces institutions que sont les bars, bistrots et brasseries. Pratiquement, la chose n’est pas forcément aisée. La réticence des gestionnaires doit pouvoir se compenser à travers une subvention substantielle. Celle-ci devrait être assortie de garanties quant à la propreté, la sécurité et la gratuité des toilettes. Doux rêve ou doux délire ? Il existe déjà une prime pour les bureaux de tabac qui remplissent des missions de service public de proximité (délivrance de timbres postaux, timbres amendes colis, presse, commerce alimentaire, etc.). Cette prime, pondérée en fonction du chiffre d’affaire et de la taille des communes, pourrait tout à fait se revoir afin de s’adapter au sujet des toilettes publiques.
Certains établissements ont pris les devants. La chaîne Starbucks, après un scandale retentissant aux États-Unis, à Philadelphie, a pris la décision de laisser ses toilettes empruntées par toute personne, cliente ou non, qui le souhaiterait.
Bien entendu, une généralisation n’a rien d’évident. L’essentiel serait certainement d’ouvrir bien davantage de toilettes au public dans les lieux ouverts au public, principalement les espaces de transport. Les gares et stations de métro devraient proposer des toilettes accessibles à toutes les personnes qui les fréquentent. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a proposé en septembre de au moins doubler les toilettes dans le métro. Le verbe est volontaire, mais comme il y a très peu de toilettes aujourd’hui dans le métro, les doubler ne changerait pas grand-chose. Il faut un modèle économique permettant d’assurer la gratuité, la propreté et la sécurité (un modèle GPS donc) de sites ouverts à tous dans ces espaces de circulation où des commodités de base sont de plus en plus nécessaires.
Si Paris a la capacité d’agir volontairement du côté de l’offre, la ville pourrait également agir plus fermement sur la demande… La ville devrait ainsi faire également preuve de davantage de fermeté contre les incivilités et les souillures. D’abord, en doublant le montant du PV lorsque le contrevenant s’épanche à proximité ou parfois même sur une sanisette. Ensuite, en s’attaquant résolument aux divers campements qui, par endroits, transforment Paris en dépotoirs et urinoirs à ciel ouvert. Un équilibre d’offre de services originaux et de tolérance zéro ferait vivre une politique publique efficace au service de la salubrité, de la dignité et de l’attractivité.
L’épisode des uritrottoirs aura eu l’avantage de rappeler que, à Paris notamment, les toilettes sont capitales. Il reste simplement à comprendre pourquoi les uritrottoirs parisiens se sont avérés si urticants alors que dans leur ville d’origine, Nantes, ils semblent mieux acceptés. Ils soulèvent en tout cas partout les mêmes problématiques.
Le revenu minimum d’insertion (RMI) a fêté, ce 1er décembre, son trentième anniversaire. Il avait franchi ses vingt ans en devenant, le 1er décembre 2008, le revenu de solidarité active (RSA). Pour ses quinze ans, en décembre 2003, il avait été décentralisé et confié, en partie, aux départements. En trente ans, la prestation, plusieurs fois retouchée, a beaucoup déçu.
La désillusion, qui affecte certainement plus les gestionnaires que les allocataires, procède d’un constat très simple : l’allocation, régulièrement reformatée, n’a jamais réussi à atteindre son objectif d’éradication de l’extrême indigence. Renommée et reconfigurée, étendue ou restreinte selon les époques, elle a accompagné bien des évolutions de la société française.
L’histoire de la prestation trentenaire est ponctuée de controverses qui sont toujours d’actualité. Il en va de savoir qui doit la gérer : l’État, les caisses de sécurité sociale, les collectivités territoriales ? Mais ce sujet de gouvernance, qui intéresse aujourd’hui des départements financièrement exsangues, n’est, au fond, pas de première importance. Il en va, également, de questions d’emploi, avec la problématique éternelle des effets désincitatifs à l’emploi des prestations d’aide sociale. Il en va, encore, de thèmes aussi techniques que philosophiques comme celui de la ressource à affecter à un tel budget. Il en va, enfin, du montant de la prestation. Son pouvoir d’achat, dans sa formule basique, a relativement décroché par rapport au SMIC. Mais pour en avoir une appréciation exacte, il faudrait resituer son évolution dans celle, plus générale, du système de redistribution qui, sur trente ans, a beaucoup changé.
Il est en tout cas certain que le RMI/RSA a parfaitement changé la vie des plus pauvres, en tout cas de ceux qui peuvent prétendre à ce revenu. La création du RMI est une date majeure dans la lutte contre la pauvreté. Il y a, incontestablement, un avant et un après en ce qui concerne la situation objective, sur le plan monétaire, des moins favorisés.
Voté à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale, le projet avait fait l’objet d’un beau discours par le Premier ministre. Évoquant un « nouvel espoir », Michel Rocard soulignait une innovation de portée considérable, comparable à la généralisation de la sécurité sociale. À une période de préoccupations et d’innovations tous azimut autour de ce que l’on baptisait « nouvelle pauvreté », Coluche avait créé les Restos du Cœur et les gouvernements cherchaient à agir. Gauche et droite s’accordaient sur la nécessité d’expérimenter et d’investir contre la précarité. Ainsi la création du RMI a-t-elle reposé sur une très large approbation politique. La dispute a cependant très rapidement repris, dès 1988, quand il s’est agi de financement. En effet, alors que le précédent Premier ministre Jacques Chirac avait fait voter, en 1986, l’abrogation de l’impôt sur les grandes fortunes (IGF), les socialistes, revenus aux affaires, le rétablissent sous le nom d’ISF (impôt de solidarité sur la fortune). L’introduction du mot « solidarité » dans le nom n’est pas anodin. Car cet ISF a pour fonction alors, entre autres, de financer ce nouveau RMI. La prestation faisait bien l’objet d’un assentiment et même d’une sorte de belle harmonie politique. Mais la contribution qui la permettait ouvrait sur des luttes partisanes anciennes, appelées à s’approfondir ensuite, et à rebondir aujourd’hui alors que la liaison entre RMI et ISF (devenu impôt sur la fortune immobilière – IFI) est formellement coupée.
Le RMI, avec sa visée de respect de la dignité humaine et sa place d’étage de base de la protection sociale, compte assurément parmi les rares réformes d’envergure du modèle social. Dès son discours à la tribune de l’Assemblée, Michel Rocard déclarait vouloir faire attention à ne pas « créer des abonnés de l’assistance ». Aujourd’hui, la critique est féroce. Le RSA symboliserait les dérives de l’assistanat. C’est en tout cas ce que répète à l’envi Laurent Wauquiez. Celui qui fut, en 2005, dans une commission présidée par Martin Hirsch, l’un des artisans du RSA, incarne cette condamnation. Avec des arguments parfois pernicieux, d’autres parfaitement audibles.
Le grand fond de l’affaire est que le RMI/RSA n’a pas permis ce qu’il promettait : l’extinction de la grande pauvreté et de la mendicité. Il faut se souvenir que l’un des objectifs assignés, en 1988, à cette innovation consistait à « obvier à la mendicité ». Le législateur avec cette expression reprenait, dans les rapports préalables à la loi, une formule issue de la période révolutionnaire. Le RMI reposait également sur des expérimentations menées avec ATD Quart-Monde qui avaient permis aux bénéficiaires, selon le titre d’un rapport, « Un an sans retourner chiner », c’est-à-dire sans fouiller dans les poubelles. Il suffit de constater l’état des rues et les tensions sur les budgets des ménages plus précaires pour considérer que l’objectif révolutionnaire d’en finir avec la manche et les activités dégradantes n’a pas été atteint. Ce qui attriste forcément.
La trajectoire du RMI, sur ces trois décennies, se jalonne de moments d’exaltation et de révision. Alors que l’une des perspectives contemporaines, annoncée pour 2020, porte sur la création d’un « revenu universel d’activité », on oublie rapidement que le RMI avait été revu en ce sens au début des années 2000. Était ainsi né, au moment où on décentralisait le dispositif originel, le « revenu minimum d’activité » (RMA), aujourd’hui totalement oublié. Complétant le RMI, sans le remplacer, ce RMA a rapidement échoué. Extrêmement sophistiqué, ce RMA n’a concerné qu’un nombre très restreint d’allocataires. À peu près autant que le nombre total des parlementaires, qui se sont longuement écharpés à son sujet.
A chaque fois présentées comme des réformes majeures, les transformations du RMI bousculent des principes et des institutions. Si le RMI avait fait dans son principe consensus, il n’en a pas été de même pour le RMA et pour le RSA. Dans les deux cas des oppositions se sont exprimées de manière passionnée.
Toutes les argumentations techniques ou polémiques relèvent d’une même problématique, celle des liens entre activités et garantie de ressources. Dès sa conception ont été adjoints au RMI des dispositifs cherchant à inciter au mieux les allocataires à se replacer ou se placer pour la première fois sur le marché de l’emploi. De fait, le souci de lien avec l’activité, d’« activation » dit-on, a toujours été présent.
Ces prestations ont été élaborées avec un double souci : garantir un revenu minimum, inciter à la reprise d’activité. Or les deux objectifs entrent nécessairement en contradiction, sur le papier comme dans la réalité. D’où des projets alternatifs, à faisabilité discutable, comme le revenu universel (sans être « d’activité ») ou l’impôt négatif. L’ensemble alimente l’usine à gaz socio-fiscale et douche d’une redoutable complexité tous les enthousiasmes réformateurs.
Reste les principaux concernés. Au moment de souffler les trente bougies du RMI, les allocataires continuellement dans le dispositif depuis l’origine se comptent sur les doigts de deux ou trois mains (on en recense une quinzaine). Le stock trentenaire, si on peut dire, est très réduit. Mais le flux, sur la période, aura été considérable. Plus d’une personne sur dix vit actuellement ou a vécu un moment de sa vie dans un foyer dont l’un des membres touche ou touchait ce revenu minimum. Ce qui, en 1988, ne devait toucher, selon les prévisions de l’époque, que quelques centaines de milliers d’individus au maximum, aura concerné plus de 10 % de la population française. Ce qui s’élaborait pour une population marginale est devenu un sujet central. Bon anniversaire ?
Un article sur les réformes possibles de l’accompagnement social et la perspective du référent unique.
« Accompagnement social et référent unique », Revue de droit sanitaire et social, n° 6, 2018, pp. 987-997.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX COLLECTIFS
FORMULE DE LA SÉANCE
L’exposé collectif fait vingt minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.
Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position et, plus précisément encore, à une proposition pour le suivi du phénomène à l’échelle européenne.
Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.
Les présentations seront suivies d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.
Quelques références (pour préparer les travaux) :
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9ae7e081-fr/index.html?itemId=/content/component/9ae7e081-fr
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/18.as_fracturenumerique.pdf
PRÉSENTATION DES TRAVAUX COLLECTIFS
FORMULE DE LA SÉANCE
L’exposé collectif fait vingt minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.
Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position et, plus précisément encore, à une proposition pour le suivi du phénomène à l’échelle européenne.
Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.
Les présentations seront suivies d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX COLLECTIFS
FORMULE DE LA SÉANCE
L’exposé collectif fait vingt minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.
Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position et, plus précisément encore, à une proposition pour le suivi du phénomène à l’échelle européenne.
Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.
Les présentations seront suivies d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée
Allez…. Quelques pistes….
Vous pouvez trouver quelques informations et idées ici :
http://eclairs.fr/9-les-classes-moyennes-celebrees-ou-sacrifiees/
Tiens, et puis ça :
https://www.alternatives-economiques.fr/classe-moyenne-tres-vulnerable-europe/00012707, sur cette source : https://www.ilo.org/paris/actualites/WCMS_538237/lang–fr/index.htm,
Et, surtout, ça (même si ça date) :
https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C282.pdf
Et encore cela : http://ses.ens-lyon.fr/articles/les-classes-sociales-en-europe-entretien-avec-cedric-hugree
Et ça : https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/blog/europes-shrinking-middle-class
Et encore – perspective intéressante (!) – ici : https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/03/22/is-there-a-middle-class-crisis-in-europe/ à voir aussi ici https://www.nytimes.com/2019/02/14/business/spain-europe-middle-class.html
Ceci, c’est pas mal : https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/24/7-key-findings-on-the-state-of-the-middle-class-in-western-europe/
Regardez les statistiques de l’OCDE….. Avec un rapport à voir absolument, même s’il sort la veille de l’exposé…. http://www.oecd.org/publications/under-pressure-the-squeezed-middle-class-689afed1-en.htm
PRÉSENTATION DES TRAVAUX COLLECTIFS
FORMULE DE LA SÉANCE
L’exposé collectif fait vingt minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.
Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position et, plus précisément encore, à une proposition pour le suivi du phénomène à l’échelle européenne.
Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.
Les présentations seront suivies d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.
LISTES DES EXPOSÉS ET DISCUSSIONS
FORMULE DE LA SÉANCE
L’exposé fait dix minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.
Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position.
Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.
L’ensemble des exposés sera suivi d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.
LISTES DES EXPOSÉS ET DISCUSSIONS
FORMULE DE LA SÉANCE
L’exposé fait dix minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.
Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position.
Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.
L’ensemble des exposés sera suivi d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.
LISTES DES EXPOSÉS ET DISCUSSIONS
FORMULE DE LA SÉANCE
L’exposé fait dix minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.
Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position.
Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.
L’ensemble des exposés sera suivi d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.
LISTES DES EXPOSÉS ET DISCUSSIONS
FORMULE DE LA SÉANCE
L’exposé fait dix minutes (à peu près exactement). Il est suivi de dix minutes (moins précisément) de discussion.
Il reprend des informations et doit aboutir à une prise de position.
Il peut s’appuyer sur une présentation Power Point, ou tout autre type d’animation.
L’ensemble des exposés sera suivi d’une discussion collective pour aboutir à une réponse collective à la question posée.
CONTENU
– Les diverses définitions et approches
– Les seuils et les opinions
– Les caractérisations en France et dans le monde
SUPPORT DE LA PRÉSENTATION EN COURS
DOCUMENTS ET SITES À VOIR
– Sur le site de l’observatoire des inégalités, voir la richesse selon les niveaux de vie https://www.inegalites.fr/A-quel-niveau-de-vie-est-on-riche et, plus généralement, la rubrique “hauts revenus”
https://www.inegalites.fr/Revenus-niveau-de-vie-patrimoine?id_mot=27&idrub=
– Une approche en gros tableau de bord : les nouveaux indicateurs de richesse publiés annuellement par le gouvernement. La livraison 2018.
– Pour approfondir, voir la base “world inequality database”
– Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution. 1901-1998, Paris, Grasset, 2001 (autre édition, 2014).
– Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013 (édition poche, 2019).
– Thierry Pech, Le temps des riches. Anatomie d’une sécession, Paris, Seuil, 2011.
– Philippe Askenazy, Partager les richesses, Paris, Odile Jacob, 2019.
CONTENU
– Les diverses définitions et approches
– Les déterminations “ni ni”
– Les caractérisations en France, en Europe, dans le monde
SUPPORT DE LA PRÉSENTATION EN COURS
DOCUMENTS ET SITES À VOIR
– Une vidéo entretien sur la situation nationale et internationale des classes moyennes (Xerfi Canal, 10/2013)
– Pour approfondir, voir le cours plus complet sur “Les classes moyennes : célébrées ou sacrifiées ?”
CONTENU
– Les diverses définitions et approches
– Pauvreté monétaire et pauvreté en conditions de vie
– Pauvreté relative et pauvreté absolue
SUPPORT DE LA PRÉSENTATION EN COURS
DOCUMENTS ET SITES À VOIR
– Article de synthèse sur les mesures de la pauvreté (J. Damon, 2016)
– Pour approfondir, voir le cours plus complet sur “Les mesures de la pauvreté et les mesures contre la pauvreté”
– Une synthèse sur la pauvreté en France, dans “Sciences Humaines” (avril 2019)
CONTENU
– Premières approches de la pauvreté, de la richesse et des classes moyennes
– Quiz introductif
– Tableau essentiel
SUPPORT DE LA PRÉSENTATION EN COURS
DOCUMENTS ET SITES À VOIR
. Tout au long du cours, voir – principalement – l’excellent site de l’Observatoire des inégalités
. Voir, naturellement, le site de l’INSEE, notamment sur les revenus et le patrimoine des ménages.
. Voir, également, les sites de l’OCDE sur le Better life index, la comparaison interactive des situations, les données sur les inégalités de revenu
. Voir, encore, pour les comparaisons européennes, les données Eurostat, autour du socle européen des droits sociaux, sur les revenus et les conditions sociales, sur la stratégie Europe 2020.
POUR APPROFONDIR
Quelques ouvrages récents très notables, avec – en lien – une recension
Anthony Atkinson, Inequality. What can be done ?, Harvard University Press, 2015.
Angus Deaton, La grande évasion. Santé, richesse et origine des inégalités, PUF, 2016.
Branko Milanovic, Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization, Harvard University Press, 2016.
Martin Ravallion, The Economics of Poverty. History, Measurement, and Policy, Cornell University Press, 2016.
Hans Rosling, Factfulness, Sceptre, 2018.
TABLEAU QUI ACCOMPAGNERA TOUT LE COURS
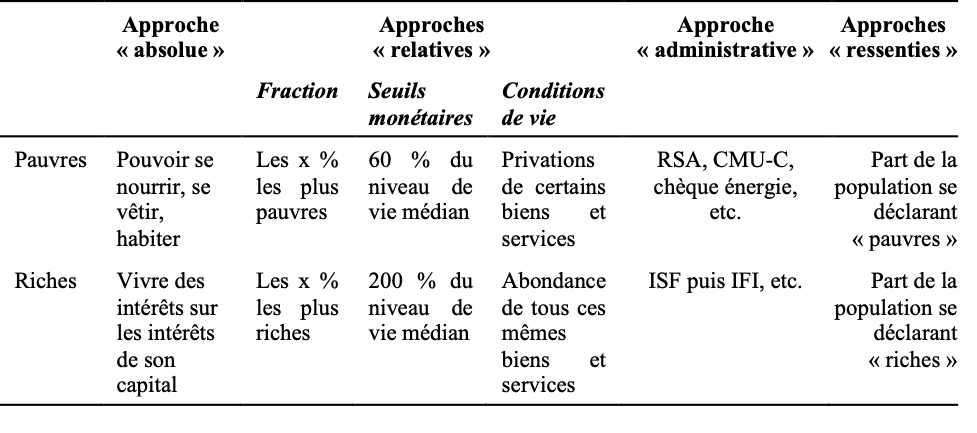
Tim Harford raconte des histoires. Et il les raconte extrêmement bien. Son panorama personnel des inventions qui façonne notre économie et notre vie quotidienne constitue une grande leçon de vulgarisation de l’histoire et de la science économiques.
Harford, chroniqueur au « Financial Times » et habitué des best-sellers, a tenu en 2016 et 2017 une chronique hebdomadaire à la BBC. De ces cinquante épisodes pour traiter des fondements des économies contemporaines, il ressort un ouvrage captivant, opportunément traduit rapidement. On retrouve quelques classiques du genre, avec les étagères Billy, le radar, la pénicilline, le conteneur maritime (« principal facilitateur de la mondialisation »), l’algorithme de Google, ou le iPhone. On découvre des sagas plus originales, comme celles du fil de fer barbelé ou du code-barres. Bien plus qu’aux origines et traits de ces innovations, l’auteur s’intéresse à leurs effets. Il s’agit d’inventions qui lui semblent particulièrement importantes, en ce qu’elles ont transformé le monde. Certaines continuent à le faire ; d’autres ont moins d’importance (qu’il s’agisse du papier, remplacé par du numérique, ou du grand magasin au sujet duquel l’auteur anglais ne cite pas le Bon Marché). Quelques-unes sont, bien entendu, des incontournables. Il en va de la sorte de l’invention de l’écriture et, en même temps, de la comptabilité à Uruk.
50 essais réussis
Débutant par la charrue, dont il ne dit pas s’il faut la mettre avant les bœufs mais qu’il place avant son introduction, et terminant par l’ampoule électrique, que l’humanité vénère insuffisamment, Harford ne se veut ni chronologique, ni hiérarchique, ni exhaustif. Le plan adopté est analytique. Les essais sont présentés en sept rubriques. L’auteur, écrivant que les Luddites ne s’inquiétaient pas de l’appauvrissement de l’Angleterre mais du leur, rappelle qu’il y a toujours des gagnants et des perdants (première rubrique). Il montre combien les découvertes mises en avant, comme le lait en poudre pour les bébés ou la pilule contraceptive, ont réinventé nos vies. À ce titre, il tranche. C’est plus le plateau-télé que la machine à laver qui a changé la vie des femmes, tout en contribuant à l’obésité. Certaines nouveautés sont d’entières révolutions. Harford en rend compte avec un bel art de la formule. C’est le cas de la sécurité de l’ascenseur (qui déplacerait chaque jour l’équivalent de la population mondiale) ou de la chaine du froid (qui permet aux bananes de durer plus longtemps, sans effet cependant sur les Républiques bananières). Quelques idées contées sont précisément des « idées sur les idées » : la société à responsabilité limitée (qui serait née le 31 décembre 1600), la propriété intellectuelle (pour laquelle se battait Charles Dickens). Dans l’une de ses rubriques, celle de « la main visible », le chroniqueur range ce qui a été rendu possible par une conjonction d’intérêts privés et de présence publique. On trouve là les paradis fiscaux, le cadastre (avec mise en valeur des travaux de Hernando de Soto), ou bien la monnaie mobile qui, avec le fameux M-Pesa d’abord au Kenya, révolutionne les échanges et limite la corruption.
De l’anecdote, forcément savoureuse et bien mise en valeur, le narrateur de talent sait tirer des enseignements généraux. Appuyé sur une grande consommation de littérature économique, le propos fait dans la synthèse attachante, autant sur l’importance de la normalisation internationale (de type ISO), que sur celle de la réfrigération ou de la climatisation. Le ton, agréablement léger, permet de faire passer et d’illustrer ce qui est parfois compliqué. Il en va ainsi de l’importance du compilateur en informatique, ou des coûts de conversion et des tarifs binômes, expliqués ici par le rasoir et sa lame jetables.
S’il souligne ingéniosité, habileté et sagacité chez des personnalités extraordinaires (Elisha Otis, père des freins d’ascenseur, James McKinsey, père du conseil en management), Harford ne tombe pas dans le piège actuel de la célébration tous azimuts de l’innovation. Il appelle d’ailleurs à la sagesse et à la simplicité. Ce que devraient méditer les techno-prophètes béats du monde des start-up, qui pontifient sur les vertus prétendument « disruptives » (un qualificatif absent du texte) de leurs logiciels. Voici donc un volume où tout vaut le coup. De l’inviolabilité des messages électroniques à l’ajustement des horloges pour et par le chemin de fer, en passant par le point crucial des chasses d’eau et réseaux d’assainissement. Dire de cet ouvrage qu’il en vaut une cinquantaine serait exagéré. Mais pas forcément tant que ça.
Tim Harford, L’économie mondiale en 50 inventions, PUF, 2018, 369 pages, 22 euros.
Julien Damon
Professeur associé à Sciences Po
Conseiller scientifique de l’Ecole nationale supérieur de Sécurité sociale (En3s)
Experts et responsables politiques ont copieusement critiqué, à l’automne, un Emmanuel Macron « président des riches ». Robin des Bois à l’envers, le président inspecteur des finances détrousserait les pauvres pour financer les favorisés. Le trait fait certainement mouche. Exagéré, il risque de masquer une volonté de secouer les branches de l’édifice social. On peut penser ce que l’on veut de la nouvelle présidence, se bagarrer à grands coups de chiffres, il y a tout de même une nette volonté de changer.
Cette volonté s’exprime clairement en matière de pauvreté. Les annonces à ce sujet ont suscité moins de commentaires, acerbes ou conquis, que les débats sans fin sur l’ISF. Pourtant les orientations mises en avant, avec la nomination d’un délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, ont tout d’une stratégie rénovée. En se centrant sur la pauvreté des enfants, l’action publique se donne une juste cible. Quatre dimensions incarnent ce possible nouvel agenda. Tout d’abord, le gouvernement se refuse à annoncer un énième plan Marshall ou une xième grande loi contre les exclusions. C’est heureux. Plutôt que d’imaginer de nouveaux dispositifs venant s’ajouter à l’entrelacs déjà présent, il s’agit de concentrer les moyens sur un objectif : réduire la pauvreté infantile. Ensuite, toujours dans la méthode, les pouvoirs publics ouvrent une concertation avec les associations. Là aussi, ni nouveau Grenelle ni plan Schmilblick à effet d’annonces. D’abord de la discussion, et ensuite certainement de la négociation pour réformer le secteur de la lutte contre la pauvreté. Troisième dimension, cruciale, la visée. Emmanuel Macron a raison de mettre en avant la pauvreté des enfants. Ce ne sont pas uniquement les petits mendiants dans les rues, souvent ignorés par des pouvoirs publics dépassés. Ce sont tous les mineurs vivant dans des familles pauvres. Alors que le taux de pauvreté, en moyenne, est de 14 % en France, il est de 20 % pour les enfants. Un enfant sur cinq est compté comme pauvre ! Ce triste score ne se résorbe pas d’un coup de baguette magique. C’est la quatrième dimension : pas de gadget, mais des inflexions structurantes. Grâce à son système de retraites, la France a presque éradiqué la pauvreté des personnes âgées. Il demeure des situations intolérables, avec, par exemple, un demi million de retraités au minimum vieillesse. Mais le sujet de la pauvreté s’est transformé, basculant vers les plus jeunes. Aussi, c’est bien par des réformes des prestations sociales et familiales que tout se joue. Les décisions récentes (ponction autoritaire des allocations logement) ou envisagées (mise sous condition de ressources des allocations familiales) ne sont pas forcément les meilleures. D’autres idées matérialisent la priorité aux enfants pauvres. Le gouvernement aspire à investir dans les crèches. Il n’est pas le seul à y avoir pensé. Il faut le faire massivement en reconfigurant la politique familiale. Celle-ci doit s’adapter aux familles et problématiques contemporaines qui relèvent davantage d’un souci de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle que d’une préoccupation nataliste. Le gouvernement veut également aller dans le sens d’un « versement social unique ». Il faut, en effet, prendre à bras le corps la complexité d’un système auquel plus personne ne comprend grand-chose. Réduire la pauvreté, c’est aussi réduire la complexité de la lutte contre la pauvreté.
Tony Blair, il y a exactement vingt ans, avait fixé un cap : éradiquer la pauvreté des enfants sur le temps d’une génération. Le Premier ministre britannique n’a pas réalisé son dessein. La Présidence française sait ce que sont les difficultés d’un volontarisme résumé à un slogan comme « zéro enfant pauvre ». Il s’agit pourtant d’un bon objectif. Avec de tels énoncés, l’action publique s’oblige. Assigner une ambition élevée, peut-être inatteignable, c’est se donner la possibilité de s’en approcher le plus possible, par les instruments adaptés et les réformes nécessaires.
FICHE DE LECTURE CRITIQUE
Les étudiants se voient chacun attribuer un ouvrage.
Ils doivent en produire la recension, en mettant en avant une synthèse du propos et une critique personnelle. Il s’agit de pouvoir mettre en perspective le cours à partir d’une analyse particulière.
Il est donc attendu trois choses, dans un plan en deux parties (!) :
– synthèse du contenu et du propos ;
– mise en perspective par rapport au cours, à l’actualité, à des sujets plus généraux ;
– une vision critique.
Les étudiants doivent traiter l’ouvrage en 10 000 signes (espaces compris, avec une tolérance de 15 %), avec un plan annoncé et suivi.
La recension peut être accompagnée d’annexes (graphiques, tableaux, extraits).
Ils doivent adresser le fichier Word (insistons : c’est un fichier Word et pas autre chose) au plus tard le 26 octobre à minuit.
Les remarques et corrections seront faites directement sur les fichiers, renvoyés aux élèves.
| ABDERMA, Ali | Hervé Le Bras, Se sentir mal dans une France qui va bien |
| ABI-KHALIL, Thelma L. | Rob Reich, Just Giving. Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better |
| AISSO, Carpus M. | Guy Standing, le précariat |
| AMARI, Dorah | Kate Pickett , Richard Wilkinson, Pour vivre heureux, vivons égaux ! |
| ANDA NTOU’OU, Astrid Aubin | Darren Mcgarvey, Fauchés : Vivre et mourir pauvre |
| ANDREOTTI, Chiara | David Robichaud, Patrick Turmel, La juste part |
| APATOUT, Chloé J. | Anthony Atkison, Measuring Poverty Around the World |
| ARUTYUNYAN, Lévon | Payal Arora, The Next Billion Users. Digital Life Beyond the West |
| ATHLAN, Camille A. | James k. Galbraith, Inégalité – Ce que chacun doit savoir |
| AULANIER, Laure A. | Alberto Alesina, Ed. Glaeser, Combattre la pauvreté aux Etats-Unis et en Europe |
| AYOUB, Sarah | Danielle Zwarthoed, Comprendre la pauvreté. John Rawls, Amartya Sen |
| BACONNET, Capucine | Branko Minlanovic, Inégalités mondiales |
| BAGNOL, Martin | Angus Deaton, La grande évasion : Santé, richesse et origine des inégalités |
| BALAIRE, Yasmine | Jacques Lévy, Jean-Nicolas Fauchille, Ana Póvoas, Théorie de la justice spatiale. |
| BALEH, Massinissa M. | Armelle Choplin et Olivier Pliez, La mondialisation des pauvres |
| BALLAYDIER, Laetitia M. | Jean-Michel Severino et Olivier Ray, Le temps de l’Afrique |
| BALOUZEH, Said | John-Kenneth Galbraith, L’art d’ignorer les pauvres : Suivi de Economistes en guerre contre les chômeurs et Du bon usage du cannibalisme |
| BARBIER, Timothée | Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Richesse des nations et bien-être des individus : performances économiques et progrès social |
| BARTH, Antoine | Christophe Guilluy, Fractures françaises |
| BAUDUIN, Noé N. | Acemoglu et Robinson, Prospérité, puissance et pauvreté |
| BEAUDICHON, Léo | Michel Bolasell, André Bonet, Les insurgés de la pauvreté |
| BELKESSA, Maxime C. | Jacques Carré, la prison des pauvres |
| BENDA, Sarah J. | Elisa Chelle, Gouverner les pauvres |
| BENNADJEMA, Elouène F. | Catherine Herszberg, Mais pourquoi sont-ils pauvres ? |
| BENRAHOU, Hanifa | Père Pedro – Pierre Lunel, Insurgez-vous ! |
| BERRE, Jade M. | Matthew Desmond, Evicted. Poverty and Profit in the American City |
| BERTOT, Nathan R. | Etienne Helmer, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité |
| BEUCLER, Tristan P. | Patrick Cingolani, La précarité |
| BOKA, Marcio | Serge Paugam, Le salarié de la précarité |
| BONNEFOUS, Tara | Pierre Lunel, Père Pedro, prophète des bidonvilles |
| BONO, Hugo A. | Marie-Claude Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles |
| BOOS, Pauline | Serge Paugam, L’intégration inégale |
| BOSCHE, Maylis | Pierre-Yves Cusset, Le lien social |
| BOUÉRY, Lina | Rutger Bregman, Utopies réalistes |
| BOULAKCHOUR, Amel | Zygmunt Bauman, Le coût humain de la mondialisation, |
| BOULINEAU, Antonin | Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir, Scarcity. Why Having too Little Means so Much |
| BOURGNEUF, Mathilde | Georges Gilder, Wealth and Poverty |
| BOURILLET, Léo | Charles Murray, Losing Ground |
| BRAMI, Natacha | Henry George, Progrès et pauvreté |
| BRETON, Diane | Bruno Parmentier, Faim Zéro. En finir avec la faim dans le monde |
| BUENTELLO, Alejandra | Denis Clerc, Michel Dollé, Réduire la pauvreté. Un défi à notre portée |
| CAFFREY, Louise | Jean-Claude Bolay, Jerome Chenal, Learning from the Slums for the Development of Emerging Cities |
| CAMARA, Coumba | John Scotson, Norbert Elias, Les logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d’une communauté |
| CANTAT, Julien | Philippe Sassier, Du bon usage des pauvres. Histoire d’un thème politique, XVIème-XXème siècles |
| CARDIN, Alan | John Maynard Keynes, La Pauvreté dans l’abondance |
| CARTON, Pierre A. | Peter Singer, The Life You Can Save : How to Play Your Part in Ending World Poverty |
| CASSAGNAUD, Cyril | Majid Rahnema, Quand la misère chasse la pauvreté |
| CASTIEL, Benjamin | Peter Edelman, Not a Crime to Be Poor: The Criminalization of Poverty in America |
| CHAFI, Kenza | Majid Rahnema, La Puissance des pauvres |
| CHETCUTI, Louise | Stephen Smith, La ruée vers l’Europe: La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent |
| CHOUCROUN, Johan | Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale |
| CIOBANU, Eness Andrei A. | Michel Forsé, Olivier Galland, Caroline Guibet Lafaye, Maxime Parodi, L’égalité. Une passion française |
| COHEN, Shana | Christophe Guilluy, La France périphérique |
| CONRATH, Elise | Fabian Frenzel, Slumming It: The Tourist Valorization of Urban Poverty |
| CORMIER, Victor G. | Laurence Chandy, Hiroshi Kato, Homi Kharas, The Last Mile in Ending Extreme Poverty |
| COULET, Marie C. | Thomas Sowell, Wealth, Poverty and Politics: An International Perspective |
| COURTOIS, Caurentin | Kathryn J. Edin, H. Luke Shaefer , $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America |
| COUTARD, Fleur | Katherine Boo, Annawadi. Vie, mort et espoir dans un bidonville de Mumbai |
| DE GARNIER DES GARETS, Arthur | Hernando de Soto, Le mystère du capital |
| DE LA CODRE, Xavier | Branko Milanovic, The Haves and the Have-Nots, |
| DE LA PRESLE, Alban | Daryl Collins et Jonathan Morduch, Portfolios of the Poor – How the World`s Poor Live on $2 a day |
| DE LA RUELLE, Maëlys A. | Collectif, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité (éditeur : Vrin) |
| DE MALEFETTE, Sophie M. | Matthieu Villemot , Regarder l’homme transpercé : Quelques grandes pauvretés urbaines |
| DE MARCELIER DE GAUJAC, Marie | Philippe Askenazy , Tous rentiers ! Pour une autre répartition des richesses |
| DEBUT, Manon C. | Serge Paugam, Vivre ensemble dans un monde incertain |
| DEER, Conrad G. | Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass Incarceration in America |
| DESACHY, Antoine | Alain Supiot, L’esprit de Philadelphie : La justice sociale face au marché total |
| DESCAMPS, Eloi | Edward Conard, The Upside of Inequality: How Good Intentions Undermine the Middle Class |
| DÉSIGAUD, Grégoire | Forrest Stuart, Down, Out, and Under Arrest: Policing and Everyday Life in Skid Row |
| DIMBOUR, Samuel P. | William-T Vollmann, Pourquoi êtes-vous pauvres ? |
| DOLCEROCCA, Arthur | Pierre Rosanvallon, La société des égaux |
| DOUIGHI, Yassine | Axelle Bordiez-Dolino, Combattre la pauvreté |
| DUBOT, Amaury C. | Loïc Wacquant, Punir les pauvres : Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale |
| DUCRET, Zélie C. | Giovanna Procacci, Gouverner la misère, la question sociale en France, 1789-1848 |
| DUHAU, Mathilde C. | Lionel Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches |
| DULUC, Albane | René Lenoir, Les exclus |
| DUPONT, Diane | Martin Hirsch, Cela devient cher d’être pauvre |
| DUPONT, Romain | Dominique Schnapper, La démocratie providentielle |
| DZOSSOU, Natacha | Alexis de Tocqueville, Sur le paupérisme |
| EL HAJOUI, Adil | Rosa Luxemburg, Dans l’asile de nuit |
| EL OUAZANI, Mariam | Esther Duflo, Lutter contre la pauvreté : Tome 2, La politique de l’autonomie |
| FABRE, Antoine | Amartya Sen, L’idée de justice |
| FABRIS-DAVET, Raphaël | Joseph Stiglitz, Le prix de l’inégalité |
| FALCO, Léa A. | Louis Napoléon Bonaparte, Extinction du paupérisme |
| FLOCH, Sandra | Georg Simmel, Les pauvres |
| FOFANA, Dialiha | François Dubet, Les places et les chances |
| FOREAU, Mathys T. | François Dubet, Le temps des passions tristes |
| FOUILLEN, Morgane | François Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité |
| GAGNY, Augustin | Camille Peugny, Le destin au berceau : Inégalités et reproduction sociale |
| GARYGA, Charlotte | Richard Hoggart, La Culture du Pauvre : Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre |
| GICQUEAU, Orianne | Bossuet, De l’éminente dignité des pauvres – avec présentation de Alain Supiot |
| GODDARD, Alexandre | Martin Heidegger, La pauvreté |
| GOUY, Clémence | Tancrède Voituriez, L’Invention de la pauvreté |
| GOUZE, Ambroise P. | Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, Repenser la pauvreté |
| GROCCIA, Louise M. | Bruno Tardieu, Quand un peuple parle |
| GUEDJ, Nikita | Michèle Grenot, Le souci des plus pauvres |
| GUERINI, Enzo | Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time |
| HADDOUF, Juliette S. | Paul Collier. The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What Can be Done About it |
| HAMDIDOUCHE, Mélissa | Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro. Histoire et droit, 19ème et 20ème siècles |
| HARDY, Pierre | Janice Perlman, Favela: Four Decades of Living on the Edge of Rio de Janeiro |
| HAZARD, Juliette | Licia Valladares, La favela d’un siècle à l’autre |
| HERBIN, Kathleen | Hervé Le Bras, Se sentir mal dans une France qui va bien |
| HERZOG, Nina | Rob Reich, Just Giving. Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better |
| HOUZE DE L’AULNOIT, Alexis | Guy Standing, le précariat |
| HUCHET, Eva H. | Kate Pickett , Richard Wilkinson, Pour vivre heureux, vivons égaux ! |
| HUGUENY, Gaëtan P. | Darren Mcgarvey, Fauchés : Vivre et mourir pauvre |
| IHADJADENE, Mélissa O. | David Robichaud, Patrick Turmel, La juste part |
| IRAND, Thibaut | Anthony Atkison, Measuring Poverty Around the World |
| JACQUEAU, Marie | Payal Arora, The Next Billion Users. Digital Life Beyond the West |
| JAEGY, Caroline | James k. Galbraith, Inégalité – Ce que chacun doit savoir |
| JAUFFRET, Hortense | Alberto Alesina, Ed. Glaeser, Combattre la pauvreté aux Etats-Unis et en Europe |
| JOHNSTONE, Alexander | Danielle Zwarthoed, Comprendre la pauvreté. John Rawls, Amartya Sen |
| JORON, Raphaël A. | Branko Minlanovic, Inégalités mondiales |
| KANAGASABAI, Jonathan A. | Angus Deaton, La grande évasion : Santé, richesse et origine des inégalités |
| KARAM, Jana | Jacques Lévy, Jean-Nicolas Fauchille, Ana Póvoas, Théorie de la justice spatiale. |
| KATJAWAN, Amélie F. | Armelle Choplin et Olivier Pliez, La mondialisation des pauvres |
| KAUFMANN, Naïs | Jean-Michel Severino et Olivier Ray, Le temps de l’Afrique |
| KEMALOGLU, M-Salih | John-Kenneth Galbraith, L’art d’ignorer les pauvres : Suivi de Economistes en guerre contre les chômeurs et Du bon usage du cannibalisme |
| KERSTING, Lenz | Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Richesse des nations et bien-être des individus : performances économiques et progrès social |
| KOUBAITI, Anas | Christophe Guilluy, Fractures françaises |
| KREIENBÜHL, Diane | Acemoglu et Robinson, Prospérité, puissance et pauvreté |
| LAMBERT, Paola J. | Michel Bolasell, André Bonet, Les insurgés de la pauvreté |
| LATOUR, Alice | Jacques Carré, la prison des pauvres |
| LAURENT, Chloé | Elisa Chelle, Gouverner les pauvres |
| LE GUEVEL, Loeiz | Catherine Herszberg, Mais pourquoi sont-ils pauvres ? |
| LE MEILLOUR, Yann | Père Pedro – Pierre Lunel, Insurgez-vous ! |
| LEBLANC, Rémi | Matthew Desmond, Evicted. Poverty and Profit in the American City |
| LECOINTRE, Maëlle | Etienne Helmer, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité |
| LEFEBURE, Louis | Patrick Cingolani, La précarité |
| LEFLOCH, Corentin | Serge Paugam, Le salarié de la précarité |
| LEGENT, Marion | Pierre Lunel, Père Pedro, prophète des bidonvilles |
| LENFANT, Alexandre | Marie-Claude Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles |
| LEPOURAS, Pavlos I. | Serge Paugam, L’intégration inégale |
| LEROY, Mélissa | Pierre-Yves Cusset, Le lien social |
| LETOURNEUR, Morgan A. | Rutger Bregman, Utopies réalistes |
| LIDSKY, Claire F. | Zygmunt Bauman, Le coût humain de la mondialisation, |
| LIN, Victoria | Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir, Scarcity. Why Having too Little Means so Much |
| MAITRA, Amrita | Georges Gilder, Wealth and Poverty |
| MALDONADO, Clément | Charles Murray, Losing Ground |
| MALHAS, Hanane | Henry George, Progrès et pauvreté |
| MAMODJIE OMARJIE, Bilkiss | Bruno Parmentier, Faim Zéro. En finir avec la faim dans le monde |
| MARBACHER, Augustin | Denis Clerc, Michel Dollé, Réduire la pauvreté. Un défi à notre portée |
| MAS, Fanny | Jean-Claude Bolay, Jerome Chenal, Learning from the Slums for the Development of Emerging Cities |
| MAYER, Pauline | John Scotson, Norbert Elias, Les logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d’une communauté |
| MAZURIER, Margaux M. | Philippe Sassier, Du bon usage des pauvres. Histoire d’un thème politique, XVIème-XXème siècles |
| MEFFRE, Carole | John Maynard Keynes, La Pauvreté dans l’abondance |
| MEMICHE, Rania | Peter Singer, The Life You Can Save : How to Play Your Part in Ending World Poverty |
| MENDES TAVARES, Veronica | Majid Rahnema, Quand la misère chasse la pauvreté |
| MEZZINI, Eva | Peter Edelman, Not a Crime to Be Poor: The Criminalization of Poverty in America |
| MINAULT, Marie | Majid Rahnema, La Puissance des pauvres |
| MIRI, Rahma | Stephen Smith, La ruée vers l’Europe: La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent |
| MONTEIL, Bertille | Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale |
| MOURRE, Blanche | Michel Forsé, Olivier Galland, Caroline Guibet Lafaye, Maxime Parodi, L’égalité. Une passion française |
| MOUSSA, Soibaha | Christophe Guilluy, La France périphérique |
| MULLER, Charlotte | Fabian Frenzel, Slumming It: The Tourist Valorization of Urban Poverty |
| NARAÏNIN, Arnaud F. | Laurence Chandy, Hiroshi Kato, Homi Kharas, The Last Mile in Ending Extreme Poverty |
| NASS, Claire-Line S. | Thomas Sowell, Wealth, Poverty and Politics: An International Perspective |
| NASTORG, Marie | Kathryn J. Edin, H. Luke Shaefer , $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America |
| NDOM, Aïssatou | Katherine Boo, Annawadi. Vie, mort et espoir dans un bidonville de Mumbai |
| NOMBRET, Johanna | Hernando de Soto, Le mystère du capital |
| NOR, Farah-Inès | Branko Milanovic, The Haves and the Have-Nots, |
| NUTTENS, Mathilde | Daryl Collins et Jonathan Morduch, Portfolios of the Poor – How the World`s Poor Live on $2 a day |
| OLPHE-GALLIARD, Marc | Collectif, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l’antiquité (éditeur : Vrin) |
| OUHADDOU, Souad | Matthieu Villemot , Regarder l’homme transpercé : Quelques grandes pauvretés urbaines |
| PAGORIWAN, Lewis A. | Philippe Askenazy , Tous rentiers ! Pour une autre répartition des richesses |
| PAIRON, Marie-Laure P. | Serge Paugam, Vivre ensemble dans un monde incertain |
| PAPANTONAKI, Charis | Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass Incarceration in America |
| PATHAULT, Victoria | Alain Supiot, L’esprit de Philadelphie : La justice sociale face au marché total |
| PELLIZZARI, Lisa | Edward Conard, The Upside of Inequality: How Good Intentions Undermine the Middle Class |
| PETITFAUX, Léandre | Forrest Stuart, Down, Out, and Under Arrest: Policing and Everyday Life in Skid Row |
| PINTON, Caroline R. | William-T Vollmann, Pourquoi êtes-vous pauvres ? |
| PITSCHI, Louna | Pierre Rosanvallon, La société des égaux |
| PORTAIS, Chloé | Axelle Bordiez-Dolino, Combattre la pauvreté |
| PRESILLA, Anthony C. | Loïc Wacquant, Punir les pauvres : Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale |
| PRUDHOMME, Thibaud G. | Giovanna Procacci, Gouverner la misère, la question sociale en France, 1789-1848 |
| RABARY, Sitraka N. | Lionel Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches |
| RAHMOUNI, Inès I. | René Lenoir, Les exclus |
| RALAMBOARISON, Iavintsoa J. | Martin Hirsch, Cela devient cher d’être pauvre |
| RAVEY–NEVEU, Camille C. | Dominique Schnapper, La démocratie providentielle |
| RENOUX SAN MILLAN, Maëlys A. | Alexis de Tocqueville, Sur le paupérisme |
| ROMANSKI, Stanislas D. | Esther Duflo, Lutter contre la pauvreté : Tome 1, Le développement humain |
| RONCIÈRE, Adèle S. | Rosa Luxemburg, Dans l’asile de nuit |
| ROULLIER, Emmanuel | Amartya Sen, L’idée de justice |
| ROUSSEAU, Guillaume | Joseph Stiglitz, Le prix de l’inégalité |
| RUIZ, Leandra M. | Louis Napoléon Bonaparte, Extinction du paupérisme |
| SADOUKI, Lëyna | François Dubet, La préférence pour l’inégalité |
| SAKHO, Kadiatou | Georg Simmel, Les pauvres |
| SAM MING, Tanya D. | François Dubet, Le temps des passions tristes |
| SANCHEZ RUIZ, Jose Zeferino Z. | François Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité |
| SANZ, Léa M. | Camille Peugny, Le destin au berceau : Inégalités et reproduction sociale |
| SCHULZ, Alexandre | Richard Hoggart, La Culture du Pauvre : Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre |
| SEVESTRE, Juliette L. | Bossuet, De l’éminente dignité des pauvres – avec présentation de Alain Supiot |
| SIEBER, Alex | Martin Heidegger, La pauvreté |
| SILVEIRA, Gustavo C. | Tancrède Voituriez, L’Invention de la pauvreté |
| SIMON, Léa | Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, Repenser la pauvreté |
| SISAID, Saadia | Bruno Tardieu, Quand un peuple parle |
| SMIDT-NIELSEN, Chloe | Michèle Grenot, Le souci des plus pauvres |
| SOBREVILLA, Léa | Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time |
| STEPONAVICIUTE, Paule | Paul Collier. The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What Can be Done About it |
| STERN, Marion | Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro. Histoire et droit, 19ème et 20ème siècles |
| TAÏEB, Joachim | Janice Perlman, Favela: Four Decades of Living on the Edge of Rio de Janeiro |
| TARONI, François | Licia Valladares, La favela d’un siècle à l’autre |
| THOMAS, Antoine | Hervé Le Bras, Se sentir mal dans une France qui va bien |
| TOFFANI, Clara | Rob Reich, Just Giving. Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better |
| TOLLEC, Anne-Laure | Guy Standing, le précariat |
| TOURNIER, Sylvain | Kate Pickett , Richard Wilkinson, Pour vivre heureux, vivons égaux ! |
| TRAINEAU, Célia | Darren Mcgarvey, Fauchés : Vivre et mourir pauvre |
| TRAN QUY, Clémence | David Robichaud, Patrick Turmel, La juste part |
| URBAIN, Valérian | Anthony Atkison, Measuring Poverty Around the World |
| VAN MILINK, Alexandra E. | Payal Arora, The Next Billion Users. Digital Life Beyond the West |
| VASSAN, Marie C. | James k. Galbraith, Inégalité – Ce que chacun doit savoir |
| VERGNES, Jade N. | Alberto Alesina, Ed. Glaeser, Combattre la pauvreté aux Etats-Unis et en Europe |
| VIDAL, Diane G. | Danielle Zwarthoed, Comprendre la pauvreté. John Rawls, Amartya Sen |
| VIGNERON, Nolwenn | Branko Minlanovic, Inégalités mondiales |
| VINCENT, Julie M. | Angus Deaton, La grande évasion : Santé, richesse et origine des inégalités |
| VINIACOURT, Elise | Jacques Lévy, Jean-Nicolas Fauchille, Ana Póvoas, Théorie de la justice spatiale. |
| VITOU, Clotilde M. | Armelle Choplin et Olivier Pliez, La mondialisation des pauvres |
| VOIRY, Clara S. | Jean-Michel Severino et Olivier Ray, Le temps de l’Afrique |
| VOLCY, Anchise | John-Kenneth Galbraith, L’art d’ignorer les pauvres : Suivi de Economistes en guerre contre les chômeurs et Du bon usage du cannibalisme |
| WAILLY, Manon | Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Richesse des nations et bien-être des individus : performances économiques et progrès social |
| WIERZBICKA, Aleksandra W. | Christophe Guilluy, Fractures françaises |
| WIGNESWARAN, Vithursan | Acemoglu et Robinson, Prospérité, puissance et pauvreté |
| WYNEN, Katelynn | Michel Bolasell, André Bonet, Les insurgés de la pauvreté |
| ZAMBA, Marguerite Lucrèce | Jacques Carré, la prison des pauvres |
| ZANA, Eva | Elisa Chelle, Gouverner les pauvres |
| ZHANG, Jingyi | Catherine Herszberg, Mais pourquoi sont-ils pauvres ? |
Les SDF sont réapparus, en France, en tant que problème social dans les années 1980 et 1990. La compassion, réveillée de manière plus ou moins spectaculaire chaque hiver, a accompagné la constitution d’un système de prise en charge dont l’objectif, qui n’est pas forcément clair, est de lutter contre l’exclusion. Il y a là une sorte d’obligation, presque éthique, de moyens que se donne la collectivité. Une autre perspective est de se donner un objectif de résultat comme « zéro SDF ». Il s’agit, avant tout, d’une visée à l’aune de laquelle évaluer, puis réformer, les politiques en place.
Historiquement, tout un arsenal juridique, plus ou moins raffiné en fonction des époques, a été éprouvé pour venir à bout des vagabonds et des mendiants. On a tour à tour, ou tout à la fois, voulu enfermer, nourrir, bannir, renvoyer dans les paroisses, torturer, soigner, assister, mis au travail. Rétrospectivement, l’objectif « zéro SDF » était implicitement présent, mais sous d’autres mots et avec une toute autre orientation : la répression. Au 19ème siècle, l’ambition « zéro vagabond » n’était pas explicitement exprimée. Mais l’objectif était bien là : éradiquer le phénomène, non par l’intervention sociale mais par une répression radicale.
Dans la période contemporaine, l’expression « zéro SDF » comme dessein de politique publique apparaît de manière récurrente lors des campagnes pour l’élection présidentielle. D’abord critiqué au point d’être prestement rejeté, cet objectif s’acclimate progressivement.
La formule « zéro SDF d’ici à 2007 » évoquée par le candidat Lionel Jospin au printemps 2002 comme l’un des axes de son programme présidentiel a donné lieu à de vives réserves. Le mot d’ordre a été jugé simpliste et maladroit. L’idée avait pourtant déjà été exprimée en 1997 par Laurent Fabius alors Président de l’Assemblée nationale. Elle s’inspirait d’une proposition « un toit pour tous » du premier ministre anglais Tony Blair réélu en 2001. Le candidat Nicolas Sarkozy la reprendra à son compte en décembre 2006, dans la perspective de la présidentielle de 2007, promettant que « plus personne ne serait obligé de dormir sur le trottoir » d’ici à deux ans s’il était élu président de la République. Sans que l’objectif quantifié soit véritablement employé, il aura été utile pour légitimer les opérations de « refondation » de la politique de prise en charge durant le quinquennat. En 2017, c’est la Fondation abbé Pierre qui a communiqué et proposé. Dans une adresse aux candidats à l’élection présidentielle, la Fondation soutient que la France a les moyens d’« en finir avec le scandale des sans-domicile ». Elle invite le pays à s’assigner « une obligation de résultat : ne plus laisser personne, homme, femme, enfant, sans un vrai logement pour se reposer, se ressourcer, se reconstruire ». Ses communications sont titrées « SDF : objectif zéro ! »
L’objectif « zéro SDF » convoie certainement son lot d’ambiguïté. Il ne s’agit cependant pas seulement d’un slogan. C’est une orientation rationnelle et raisonnable de politique, permettant une réforme et une mise en adéquation des moyens à un objectif précis. Cette orientation est en parfaite adéquation avec de grands engagements internationaux français, ne serait-ce que l’objectif européen d’éradication de la pauvreté et l’objectif international d’extinction de la pauvreté extrême (l’un des principaux objectifs du développement durable – ODD – de la communauté internationale). Naturellement, comme cette visée plus générale de réduction de la pauvreté, la fixation d’un tel horizon appelle des réformes conséquentes, qu’il s’agisse des définitions, des indicateurs et des instruments des politiques.
Avec de tels énoncés, l’action publique s’oblige à fonctionner sur une logique objectifs/résultats. Assigner un objectif élevé, peut-être inatteignable, c’est se donner la possibilité d’en approcher le plus possible, par les instruments adaptés et les réformes nécessaires.
Une recension dense de “Basic Income”.
Livre à lire !
Pour le guichet social unique
Julien Damon
Professeur associé à Sciences Po
Conseiller scientifique de l’Ecole nationale supérieur de Sécurité sociale (En3s)
Dans la famille des serpents de mer sur l’évolution de la protection sociale, je demande le guichet unique. Il est de bon ton de hausser les épaules dédaigneusement à sa simple évocation. Il faut dire que l’expression même est dépréciée. En particulier parce que les guichets uniques (en matière d’emploi, de handicap ou de famille) existent, au moins sur le papier. Ils se sont même multipliés. Mais avoir plusieurs guichets uniques paraît, évidemment, peu logique. Au-delà de l’ironie, le sujet mérite que l’on s’y arrête. La situation commande des améliorations en ce qui concerne l’accueil de gens, qui ne saurait être qu’immatériel, et le service des prestations, qui ne saurait continuer à autant se disperser. Surtout, la révolution numérique et son déluge d’algorithmes et de données permettent de progresser. Le guichet unique pourrait bientôt ne plus relever du mythe.
Tout le monde se perd dans le dédale de la protection sociale et de ses multiples guichets. En réponse, l’idée d’un guichet unique a pied depuis des années dans le débat spécialisé. Elle a ses incarnations, en France et à l’étranger. La Mutualité Sociale Agricole se présente pour ce qu’elle est : un véritable guichet unique, assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations pour l’ensemble des branches de sécurité sociale, dans le monde agricole. De l’autre côté de l’Atlantique, Service Canada offre aux Canadiens un point d’accès unique à un grand nombre de services et de prestations du gouvernement. En Australie CentreLink (nouveau nom de la sécurité sociale) fait de même, pour les Australiens.
Et en France ? Sommes-nous condamnés à l’éparpillement des guichets ? La solution existe. Elle passe par les systèmes d’information. Plutôt que de s’évertuer à vouloir fusionner des institutions qui rechignent à se rapprocher de peur de disparaître, il faut les faire mieux vivre ensemble, en permettant un point d’entrée unique, qui redirige vers chacune d’entre elles. Les usagers voient leur vie simplifiée. Les institutions continuent d’exister. Avec ce « point d’entrée unique » (que les anglo-saxons baptisent « one stop shop »), il s’agit, fondamentalement, d’un site Internet intégrant tous les autres. Un tel guichet unique dématérialisé assurerait une relation de service simplifiée et unifiée à partir de l’ensemble des services en place. Il intégrerait, de la sorte, tous les services qui y sont rattachés, sans nécessairement les remplacer. Avec la puissance des systèmes d’information et un peu de volontarisme, le guichet social unique peut passer de l’incantation à la réalisation.
Puisque les différentes institutions ne peuvent être bouleversées du jour au lendemain, l’idée force est de rendre compatibles, interopérables et interconnectés les systèmes d’information. La complexité doit ainsi être internalisée par la technique. Symétriquement, et toujours en s’appuyant sur les systèmes d’information, il est possible d’externaliser la simplicité, en faveur des usagers. La perspective d’un point d’entrée unique, en matière sociale, apparaît être une cible souhaitable et possible. Le programme « Dites-le nous une fois », développé par l’administration à destination des entreprises, consiste à alléger les tâches administratives en diminuant les sollicitations et en mutualisant les données. Il y a là un début de coopération et d’intégration que d’autres réalisations et expérimentations incarnent. Il en va par exemple ainsi de la mise en œuvre d’un « coffre-fort numérique » contenant, potentiellement, l’ensemble des informations et données sociales individuelles. Il n’y a donc pas forcément, sur ce dossier du guichet social unique, loin de la coupe aux lèvres. Et puisque l’ambition consiste à intégrer l’ensemble des branches, régimes et risques, on peut même avancer un surnom possible pour le projet : il s’agit de l’agence tous risques.
La pauvreté n’augmente pas. Elle se transforme.
Les politiques publiques contre la précarité
Julien Damon
Professeur associé à Sciences Po
Dernier ouvrage paru : 100 Penseurs de la société (PUF, 2016)
La notion de précarité, devenue un élément important des débats politiques et des expertises sociales, désigne des situations et phénomènes différents mais convergents. Il s’ensuit des programmes d’action publique dans des domaines variés mais avec des points communs. Concrètement, la précarité désigne une absence ou une insuffisance de revenus, mais aussi une instabilité des situations. C’est dans les années 1980, alors que l’on parlait beaucoup de « nouvelle pauvreté » et, en réponse, de « nouvelles solidarités » que la lutte contre la précarité a été érigée en objectif explicite de politiques publiques. Fondamentalement, la précarité revient à ce qui est parfois baptisé « insécurité sociale »[1]. Alors que depuis l’après-guerre et tout au long des « Trente Glorieuses » la sécurité sociale s’étendait et se renforçait, accompagnant l’extension du salariat et des classes moyennes, la « crise » des années 1970 a stoppé ce mouvement d’ascension sociale et de renforcement des garanties et couvertures sociales rattachées à l’emploi. Le chômage a bousculé l’édifice d’une protection sociale dont le principe repose sur le travail et, plus précisément, sur le projet d’un plein emploi salarié. Afin de lutter contre cette insécurité sociale grandissante et pour continuer à assurer le développement de la sécurité sociale, tout un ensemble de réponses ont été montées par les gouvernements successifs. Il en va, d’abord, des dispositifs de lutte contre la pauvreté, qui ont été au tout départ, au milieu des années 1980, appelées « programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité ». Il en va, ensuite, des réformes et révisions du droit du travail afin de tenter d’y maintenir ou d’y faire accéder des travailleurs « précaires ». Il en va, enfin, de tentatives ou projets bien plus substantiels ne cherchant pas à réformer à la marge les contours d’une protection sociale principalement axée sur le salariat, mais à la refondre en profondeur de manière à mettre fin au « précariat ». Les politiques publiques ont, en effet, contribué à cette institutionnalisation progressive de la précarité, avec une coupure assez nette entre les salariés plutôt bien protégés, et les autres actifs ballotés d’un statut à un autre.
La lutte contre la pauvreté et la précarité
Avant le début des années 1980, l’Etat ne disposait pas d’instruments ni, encore moins, de politiques publiques structurées explicitement pour lutter contre la pauvreté. La sécurité sociale, par sa généralisation, devait couvrir toutes les populations et prévenir les situations défavorisées. Le choc du chômage, à partir des chocs pétroliers, a déstabilisé cette ambition. Des personnes pauvres, ne relevant pas de la catégorie des infirmes, des vieillards ou des handicapés, venaient frapper aux portes de l’assistance, auprès des associations caritatives ou des services des villes. Des actifs ne trouvaient plus d’emploi, ne gagnaient plus suffisamment pour subvenir à leurs besoins. Certes des réflexions et propositions se faisaient jour pour prendre en considération ce qui commençait à être appelé « exclusion », mais rien n’a véritablement été lancé avec grande ampleur avant les hivers rigoureux du début de la décennie 1980. A ce moment, la gauche gouvernementale et de la droite d’opposition s’accordent avec le secteur associatif pour répondre, en urgence, aux situations des nouveaux pauvres et de ceux qui commencent à être nommés « précaires ». Ainsi des campagnes « pauvreté/précarité » sont décidées et mises en œuvre conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales. Afin de compenser l’absence ou l’insuffisance de revenus de ces chômeurs ou travailleurs à revenus faibles et instables, sont créés des compléments locaux de ressources, qui deviendront, en 1988, le Revenu minimum d’insertion. Ce RMI est conçu pour éliminer les formes les plus extrêmes de la nouvelle pauvreté, mais aussi pour atténuer les difficultés des actifs en situation précaire. Sur le plan de la précarité du logement, c’est-à-dire de l’instabilité ou de l’insalubrité de l’habitat, ce sont des dispositions en termes de droit au logement qui vont orienter les nouvelles priorités de la politique du logement. La plupart des recompositions et réformes de la protection sociale, depuis cette période, visent à réduire la précarité et ses conséquences, à la fois sur les individus, les familles et la collectivité. Sur le plan du financement de la protection sociale, la création, en 1991, de la contribution sociale généralisée (CSG), prend acte du fait que les revenus du travail ne peuvent plus constituer la seule ressource d’une sécurité sociale qui s’étend au-delà des salariés et des indépendants. Tout ce qui a été tenté pour lutter contre le chômage, de la réduction des cotisations sociales à la mise en place des 35 heures hebdomadaires de travail, relève d’une volonté de stabiliser à nouveau un monde du travail, et, en son sein, principalement un salariat qui est déstabilisé par le nouvel environnement économique. En un sens, une grande partie des décisions de politiques sociales depuis plus d’une trentaine d’années ont été prises de manière à essayer de contrecarrer et limiter la précarité, tant dans ses effets individuels (dégradation des niveaux de vie et des relations sociales) que dans ses contrecoups collectifs (dualisation de la société et difficultés accrues à maintenir à la fois cohésion sociale et protection sociale). Dans une large mesure, la création puis la transformation du Revenu de solidarité active (RSA), dans la suite du RMI, incarne cette volonté d’assurer à la fois un socle minimun et des incitations à l’emploi pour les personnes précaires, ou au moins une partie significative d’entre-elles, connues désormais comme des « travailleurs pauvres ». Exerçant une activité professionnelle, généralement réduite et peu rémunératrice, ces précaires vivent dans des foyers aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Ils se trouvent au noyau dur de la précarité. Les difficultés des politiques publiques qui visent à les aider à s’extraire de leurs problèmes se trouvent au noyau dur des controverses sur les formes et l’étendu légitimes de l’aide sociale[2].
Droit du travail, droit de l’emploi et flexisécurité
Face à la précarité, le droit du travail, qui protège essentiellement le salarié, a été appelé à s’adapter. Il a été appelé à s’adapter pour, en quelque sorte, digérer la précarité. Ce faisant il l’a institutionnalisée. En l’espèce, ce sont les « contrats aidés » qui matérialisent le mieux cette réalité et cette perspective. Des les années 1980, de nouvelles formes d’insertion dans l’emploi, qui ne sont pas des formes traditionnelles d’intégration dans l’entreprise, voient le jour. Sont alors créés et développés, sous forme de contrats de stage, des stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) et des travaux d’utilité collective (TUC). Les pouvoirs publics prennent alors acte des difficultés particulières de la jeunesse à trouver du travail. Dans les années 1990, ces contrats particuliers vont se renforcer, devenant de vrais contrats de travail, mais limités dans le temps, avec des subventions publiques censées palier la plus faible productivité de leurs titulaires, et avec une vocation à combler des besoins en théorie non satisfaits par le marché du travail « normal ». Ce seront les contrats emploi solidarité (CES) et contrats emploi consolidés (CEC). Parallèlement, et plus largement, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) va s’intensifier. Alors que le contrat de travail de référence est le contrat à durée indéterminée (CDI), le CDD se banalise et devient, pour une partie de la population, une porte de sas vers le CDI. Pour une autre partie de la population, le CDD n’est qu’une nasse, un moment vers un autre CDD ou une période de chômage. D’autres contrats aidés, comme le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou, à partir de 2012, les emplois d’avenir actualisent la panoplie des réponses à la précarité. Celle-ci, de fait, est devenue un élément du paysage du marché du travail. Il ne s’agit plus de l’éradiquer mais de la gérer. Significativement, à tout CDD est attachée une prime de précarité, c’est-à-dire une indemnité spécifique de fin de CDD, venant s’ajouter aux autres indemnités prévues pour toute cessation du contrat du fait de l’employeur. Pour les publics les plus précaires, que l’on dit également les plus éloignés de l’emploi, c’est tout un secteur économique singulier qui a également été imaginé. Sous formes juridiques classiques, des entreprises d’insertion, des associations intermédiaires, des régies de quartier emploient des personnes aux problèmes particulièrement denses, avec des soutiens publics, sur des missions normales. L’ensemble de ce secteur et de ces contrats représente, contre son gré, l’institutionnalisation de la précarité. Sans qu’il se transforme fondamentalement, le droit du travail s’est peu à peu adapté à la précarité. Non pas en cherchant à faire varier ses garanties et protections pour le salarié, mais en laissant se développer, à côté de lui, un droit de l’emploi[3]. Pour lutter contre la précarité, un domaine économique et juridique particulier s’est installé. L’ensemble donne corps à une caractérisation classique du modèle français : d’un côté des insiders plutôt bien pris en compte et en charge, de l’autre des outsiders (les pauvres et précaires) aux ressources faibles et aux situations généralement instables. Bien conscients de cette tension et de ce possible creusement d’un fossé, les pouvoirs publics cherchent à réagir, en voulant combler la distance entre droit de l’emploi et droit du travail. La loi sur la sécurisation de l’emploi (2013) comporte ainsi plusieurs mesures visant à réduire la précarité des travailleurs, en favorisant le recours aux CDI, en améliorant la situation des salariés à temps partiel (durée minimale fixée à 24 heures) et en offrant aux salariés de nouveaux droits dans les domaines de l’assurance chômage, de la santé et du logement. L’idée générale, pour dépasser la précarité, est celle de la flexisécurité. Pour traiter de la précarité subie par les travailleurs et de la flexibilité nécessaire aux entreprises, il faut revoir le droit du travail issu des compromis de la société salariale. La flexisécurité est un mot du nouveau millénaire. Issue des réflexions d’économistes et de juristes, au sein de l’OCDE notamment, la notion prend concrètement pieds en France avec les débats autour de la modernisation du marché du travail. Cette contraction lexicale maintenant répandue veut clairement signifier une combinaison de la flexibilité et de la sécurité. La flexisécurité est généralement présentée comme une caractéristique positive des modèles sociaux nordiques, danois en particulier. Elle se veut conjugaison de marchés du travail souples avec des sécurités individuelles adéquates. Ses partisans proposent, à travers une telle orientation, des instruments pour dépasser les rigidités du marché du travail. Ses détracteurs y voient des attaques pour désagréger les protections collectives issues des Trente Glorieuses. Ses partisans soutiennent, par exemple, la création récente d’un compte personnel d’activité (CPA). Celui-ci doit permettre d’assurer les transitions professionnelles de manière plus souple, permettant à chacun de construire son parcours professionnel, en s’appuyant notamment sur un droit universel à la formation. Dans un monde changeant, en particulier dans un contexte de révolution numérique, de remontée du nombre d’indépendants, de critiques à l’égard de la vie salariale, des instruments comme le CPA veulent régler la précarité en créant de nouvelles sécurités pour tout le monde. A l’inverse, les opposants à la flexisécurité vont voir dans le contenu de la loi travail de 2016, dite loi El Khomri, un ensemble d’agressions contre le droit du travail, amenant une précarisation plus grande encore. Très contestée, cette loi originellement titrée « loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », ne contient finalement pas d’évolutions radicales. La mobilisation à laquelle elle a conduit montre d’abord que la révision du droit du travail et du droit de l’emploi ne va jamais de soi.
Précariat, révolution numérique, revenu universel
À mesure de son affirmation dans le débat public et, surtout, dans la réalité de millions de ménages, la précarité est devenue un sujet et un problème structurels, et non plus une situation transitoire, conjoncturelle, que traverseraient des individus et la société salariale. Des sociologues ont proposé le néologisme « précariat », formé à partir des mots précarité et prolétariat, pour décrire une sorte de nouvelle classe sociale. Celle-ci, repérée avec ce mot dans bien des contextes nationaux (en France, mais aussi un peu partout en Europe ou aux Etats-Unis), serait la résultante des évolutions des politiques du travail et de l’emploi, mais aussi des mutations de l’emploi et du travail. En période de révolution numérique et d’économie dite de la connaissance, les moins qualifiés et les moins productifs seraient irrémédiablement écartés de l’accès au salariat. D’où la nécessité impérieuse d’innover. Certains appellent au renforcement du droit du travail classique, assorti d’augmentation des pénalités pour les entreprises produisant trop de précarité. D’autres estiment que la voie adéquate est celle de la flexisécurité. D’autres encore pensent que des solutions de type « revenu universel » s’imposent. À gauche comme à droite, chez les plus libéraux comme chez les plus interventionnistes, l’idée fondatrice est la même : assurer à tous un minimum de revenus et de droits sociaux permettant, en théorie en toute liberté, de refuser un emploi plutôt bien payé mais ennuyeux et d’accepter une emploi plutôt mal payé mais passionnant. Si les visées ne sont pas les mêmes (compléter l’Etat providence, pour les uns ; le détruire, pour les autres), il s’agit incontestablement d’une option qui a, sur le papier, bien des vertus. L’établissement d’un tel revenu, dont la première caractéristique serait d’être inconditionnel (donc sans lien avec l’activité professionnelle), permettrait de mettre fin aux controverses sur la précarité, en en limitant assurément les manifestations les plus importantes. Reste que dans le contexte français un tel revenu, de plus en plus souvent évoqué, pose des questions de simple faisabilité. Surtout, dans un contexte de protection sociale universelle (assurance maladie, politique familiale et système de retraite permettent à tout le monde de prétendre à des droits relativement substantiels), il est compliqué d’envisager l’introduction d’une prestation universelle de base. Au-delà des considérations techniques et politiques sur le revenu universel, celui-ci ne réglerait certainement pas tout ce que la problématique de la précarité révèle, en particulier en termes de dualisation, déclassement et désespoir d’une partie de la société. En France, comme dans nombre d’économies développées.
[1]. Robert Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Le Seuil, col. « La république des idées », 2003.
[2]. Pour davantage de développements, cf. Julien Damon, L’Exclusion, PUF, « Que sais-je ? », 2014.
[3]. Sur cette distinction, voir Jean-Emmanuel Ray, Droit du travail, droit vivant, Wolters Kluwer, 2016.
Un papier qui date peut-être, mais dont le contenu est de pleine actualité….
Quartiers prioritaires, ghettoïsation et politique de la ville (*)
Julien Damon
Professeur associé à Sciences Po
(*)Ce texte est inspiré, pour sa partie sur l’évaluation, d’un article publié dans Constructif n° 45 (novembre 2016), la revue de réflexion de la Fédération française du bâtiment, en libre accès sur www.constructif.fr
L’élection présidentielle de 2017 se déroule environ 35 ans après la création des ZEP (zones d’éducation prioritaire) et 20 ans après celle des ZUS (zones urbaines sensibles). Ces acronymes sont devenus des mots classiques de l’action publique désignant des réalités très disputées dans le débat public. Il s’agit, en un mot, du problème des « quartiers ». Ces territoires sont marqués par des niveaux particulièrement élevés de chômage et de pauvreté, mais aussi par la concentration des questions d’intégration et d’insécurité. Aux multiples émeutes qui ont pu se succéder ont voulu répondre plusieurs grands programmes, dont certains ont même été baptisés « plan Marshall ». Aux discriminations, supposées ou observées, dont sont victimes les habitants de ces quartiers, des politiques dites de « discrimination positive » ont été élaborées.
Alors que ces territoires font l’objet de toutes les attentions et interrogations, ils sont ainsi la cible d’interventions singulières qui contribuent aussi à les distinguer, ne serait-ce qu’en les nommant. Il est bien difficile de mettre au jour les effets propres liés à l’habitat et à la vie quotidienne dans ces quartiers. Il est en tout cas certain que les attentes d’amélioration et de pacification des relations sont déçues.
Ces quartiers, dont le périmètre et la désignation ne cessent d’être réformés, concentrent à la fois les problèmes les plus intenses de la société française et, parce qu’ils sont peuplés de jeunesse et de dynamique, des gisements d’initiatives. Alternativement présentés comme des réservoirs de ressources originales ou comme des berceaux du terrorisme islamiste, ils constituent assurément l’un des principaux défis pour l’avenir.
Un apartheid français ?
À l’occasion de ses vœux à la presse, en janvier 2015, le Premier ministre Manuel Valls avait étonné par l’emploi d’une formule forte : « Il faut aussi regarder la réalité de notre pays. Un apartheid territorial, social, ethnique s’est imposé ». Le terme « apartheid » a fait polémique. Car rien de l’action publique française ne relève de l’apartheid, une ségrégation organisée à dessein sur la base d’un référentiel ethno-racial. Bien au contraire. Nombre de voix différentes ont alors rappelé que la France n’avait strictement rien à voir avec le racisme d’État institutionnalisé sous l’apartheid. Les regroupements et concentrations de populations en difficulté ne sont pas souhaités par les pouvoirs publics français.
Depuis 30 ou 40 ans, une très discutée « politique de la ville » se développe afin de lutter contre la ghettoïsation. Malgré son intitulé, elle ne concerne ni toutes les villes (toutes les communes ne sont pas concernées), ni toute la ville (car elle traite d’une géographie et de quartiers prioritaires). Chaque année l’État y consacre environ 500 millions d’euros et, fin 2015, plus de 10 milliards d’euros avaient été engagés dans le cadre d’un ambitieux programme de rénovation urbaine lancé il y a plus de dix ans. Rien d’un apartheid, mais une logique, telle qu’elle a été baptisée, de « discrimination positive territoriale ». Il s’agit, en un mot, de faire plus, ou tenter de faire plus pour ces quartiers « prioritaires ».
Chômage et pauvreté y sont deux à trois fois plus élevés que sur le reste du territoire. En 2015, le gouvernement, après une révision substantielle des modalités et contours de cette politique, a diffusé des documents indiquant que la pauvreté dans ces quartiers atteignait 42 % de la population, contre 12 % dans le reste des agglomérations dans lesquelles ils se trouvent, et contre un moyenne nationale à environ 14 %. C’est dire le niveau de concentration atteint par la pauvreté. Dans ces quartiers, 74 % des ménages vivent dans un logement social, contre 17 % en moyenne national et 24 % dans l’ensemble des agglomérations où se situent ces quartiers. 25 % des foyers de ces quartiers perçoivent des allocations chômage. Parmi les actifs occupés dans ces quartiers, 21 % sont en emploi précaire (CDD, intérim, stages…). Parmi les femmes de 15 à 64 ans, trois sur cinq n’ont pas d’emploi[1]. En termes de concentration ethnique, la donnée est sensible et malaisée. On l’approche par les jeunes de moins de 18 ans d’origine immigrée : 20 % en France, 40 % en Ile-de-France, 60 % en Seine-Saint-Denis, 70 % à Grigny, 75 % à Clichy[2].
Dans certains de ces quartiers, où s’accumulent les difficultés et les tensions de la société française contemporaine, les autochtones ont fui ou rêvent de le faire, tandis que des communautés s’enracinent en se consolidant, en partie, contre la société française[3]. Afin de s’attaquer frontalement à cette dynamique de spécialisation ethno-raciale, le Premier ministre, en même temps qu’il lançait l’alarme au nom de l’apartheid, appelait une « politique du peuplement ». Maires et organismes HLM savent habituellement faire, grâce au permis de construire et à la sélection des occupants du logement social. L’Etat professe, lui, des objectifs de « mixité sociale » (sans coloration ethnique affichée, mais avec cette dimension lourdement cachée). Il impose des priorités d’accès aux HLM à des publics « prioritaires » venant peupler les quartiers prioritaires.
Pour une « politique du peuplement », trois grandes options se présentent. La dispersion (ou ventilation) consiste à vouloir faire partir les pauvres (par exemple avec des offres de logement ailleurs) ; mais les plus pauvres restent sur zone. L’attraction (ou gentrification) consiste à vouloir faire venir des riches (en soutenant de lourds programmes de rénovation urbaine) ; mais les pauvres s’en vont car les prix augmentent. L’affirmation (ou développement endogène) consiste à améliorer le quartier en s’appuyant sur ses forces vives ; mais ces forces vives proviennent souvent de communautés problématiques. En un mot, aucune de ces trois voies n’est la voie magique pour résoudre les problèmes des quartiers.
Une politique très évaluée pour des bilans locaux contrastés
Si l’expression « apartheid » contient une certaine exagération, son emploi veut certainement légitimer des efforts accrus et des réformes de la politique qui traite des problèmes des quartiers ghettoïsés.
À la lecture des innombrables évaluations concernant la politique de la ville, il apparaît un bilan localement contrasté, laborieux à établir nationalement et qui relève, au fond, plus de la conviction politique que de la comptabilité des indicateurs.
La politique de la ville est l’une des plus commentées et des plus disputées[4]. Parmi les paradoxes de ce domaine d’action publique, on trouve son évaluation. La politique de la ville compte, en effet, parmi les politiques qui ont été les plus évaluées. Listons cinq éléments de cette saga évaluative.
Mais quelles leçons tirer ? En l’espèce, plutôt qu’un accord général, ce sont des thèses qui s’opposent. Listons cinq écoles en présence.
Contrasté. Voici donc le bilan de la politique de la ville. Le bilan de l’ensemble des bilans sur la politique de la ville ne saurait être tranché. En effet, c’est localement que la politique de la ville peut être valablement évaluée. À l’aune certes des critères, objectifs et indicateurs nationaux qui, avec le temps, se sont amoncelés. Mais aussi, localement, en fonction de ce que pensent les habitants. Bien entendu, les difficultés méthodologiques sont importantes. Tout relève certainement de l’explicitation des critères locaux, des objectifs locaux et des indicateurs locaux. Mais ce n’est qu’à l’échelle locale qu’il est possible de dire si oui ou non la politique de la ville a été efficace. Avec les instances nationales d’évaluation et d’observation, les différents opérateurs et partenaires de la politique de la ville, qui d’ailleurs n’ont ni forcément les mêmes idées ni les mêmes intérêts en la matière, disposent d’une riche matière pour faire leur propre bilan.
Reste que le bilan local de la politique de la ville sera toujours politique. Tel élu se félicitera de son action, alors que les décisions ont été prises avant son élection. Tel autre déplorera la situation que rien ne semble pouvoir améliorer. Un autre soutiendra que ses décisions ont permis d’améliorer très visiblement un quartier quand son opposition observera que ce ne sont plus les mêmes habitants. En tout état de cause, il est possible de fournir, pour les villes, des bilans chiffrés. Assurément, il manquera toujours quelques données. Mais l’essentiel est facilement disponible, et peut nourrir, localement, des débats, plus ou moins apaisés, non pas sur la politique de la ville (une dénomination très nationale et bureaucratique), mais sur un ou des quartiers.
Une politique péniblement évaluable à l’échelle nationale
Si le bilan, au niveau local, de la politique de la ville est, presque par nature, contrasté, il n’en va pas de même aussi facilement au niveau national. Ce serait une facilité de langage de dire de la politique de la ville, à l’échelle nationale, qu’elle produit un bilan contrasté. Agrégeant les évolutions locales, on peut noter des quartiers dont la situation s’améliore, d’autres dont la situation se détériore, et ce sur une multitude d’indicateurs. Ce tableau de bord, qui a ses vertus, ne saurait tenir lieu de bilan pour une politique. En fait, la politique de la ville, à l’échelle nationale, malgré tous les efforts et toutes les belles paroles, est peu évaluable. Un argument puissant va dans le sens de l’inévaluabilité : la politique de la ville n’a que des moyens dérisoires, d’une part, par rapport aux objectifs très généraux qui lui sont fixés et, d’autre part, par rapport à l’ensemble des autres politiques concourant à ces mêmes objectifs et intervenant sur ces mêmes quartiers. Surtout, il est impossible de dresser le bilan irréprochable d’une politique dont la cible n’a cessé de bouger.
Cette politique à dénomination bien française (où trouve-t-on ailleurs dans le monde une politique de la ville qui ne soit de la responsabilité des villes ?) consiste, principalement, en mécanismes nationaux de ciblage des territoires. L’idée centrale de la politique de la ville est de repérer les territoires « les plus en difficulté », ceci afin de les traiter de manière particulière. Ce détour par des inégalités positives de traitement pour rétablir une certaine égalité des territoires a toujours fait débat autant sur le plan doctrinal (cette équité recherchée correspond-elle vraiment aux principes constitutionnels français ?) que pratique (quels critères et indicateurs d’inégalités et dissimilarités choisir ?).
L’accordéon de la géographie prioritaire
La pratique du zonage, qui a été révisée plusieurs fois, fonctionne, si on prend ces dernières décennies, un peu comme une sorte d’accordéon. La géographie des quartiers sensibles s’étend et se rétracte comme un soufflet d’accordéon. Dans une phrase de dilatation de l’accordéon, c’est-à-dire d’extension de la géographie prioritaire, il s’agit de couvrir davantage de territoires par les crédits et procédures visant la réduction des problèmes dans les quartiers sensibles. Sur une quarantaine d’années c’est, au total, une forte dilatation (que les critiques baptisent aussi une dispersion et un saupoudrage), avec une cible prioritaire passée de quelques quartiers expérimentaux à la fin des années 1970, à plusieurs milliers au cours des années 2000. Et entre temps, les gouvernements, avec les administrations et les collectivités territoriales, ont beaucoup joué à l’accordéon, cherchant, un temps, à resserrer, un autre à développer.
La politique de la ville repose sur une séquence : ciblage, écrémage, recentrage. L’observation est simple : les dispositifs centrés sur des difficultés d’intensité n bénéficient davantage à des situations territoriales ou sociales de niveau n-1, ou n-2. C’est là un effet classique d’écrémage. Il s’ensuit, après tout ciblage, un peu d’écrémage, qui pousse les responsables publics et les experts à proposer d’autres critères afin vraiment de toucher le niveau n. En termes de géographie prioritaire l’accordéon est une métaphore pour cette suite de séquences qui consistent, d’abord, à cibler certains quartiers, puis à étendre le ciblage à d’autres quartiers. Et après le ciblage, l’écrémage, puis le recentrage.
Prosaïquement, la géographie prioritaire de la politique de la ville, dans cette logique d’accordéon, est arrivée à une sorte de caricature. Emmenée par ces séquences successives de ciblage, écrémage, recentrage, nouveau ciblage, elle s’est incarnée à travers un zonage imbriqué qui comprenait, jusqu’à récemment, les zones franches urbaines (ZFU), définies comme les quartiers les plus en difficulté au sein des zones de redynamisation urbaine (ZRU), elles-mêmes définies comme les quartiers les plus en difficulté au sein des zones urbaines sensibles (ZUS).
Face à cette stratification compliquée en trois zones, il a fallu définir de nouvelles priorités par rapport aux priorités précédemment définies. On se doit de citer les 163 quartiers jugés, parmi les 750 ZUS, « archi-prioritaires » en 2003 pour bénéficier des nouvelles interventions au titre de la rénovation urbaine. La mise en place du PNRU (Programme national de rénovation urbaine) a conduit, dans un premier temps, à déterminer 215 quartiers prioritaires ; devenus 530 quartiers éligibles. Au découpage emboîté de la géographie prioritaire (les ZFU sont dans les ZRU qui sont dans les ZUS), il faut ajouter les quartiers des contrats urbains de cohésion sociale. Ceux-ci rassemblaient près de 2 500 quartiers et huit millions d’habitants. Les partitions possibles pour jouer de l’accordéon vont donc d’une centaine de ZFU à plus de 15 % de la population française vivant dans les centaines de quartiers concernés par ces contrats particuliers.
Des quartiers prioritaires aux quartiers très prioritaires
Après avoir fait tourner les ordinateurs de l’INSEE, la Ministre de la Ville a annoncé, à la mi juin 2014, une nouvelle géographie, plus resserrée. Le choix des quartiers prioritaires ne procède plus d’indices statistiques compliqués (ni, en théorie, de discussions et négociations politiques) mais d’un critère unique : la faiblesse du revenu des habitants.
Avec cette nouvelle carte, sont identifiées toutes les concentrations urbaines de pauvreté a? travers le territoire. Il n’y a plus dans cette logique que 1 300 quartiers, en métropole, éligibles aux financements de l’Etat au titre de la politique de la ville. Et grande nouveauté, certaines communes très urbaines où se trouvaient des quartiers défavorisés n’apparaissent plus dans la cartographie prioritaire (Boulogne-Billancourt ou Biarritz, par exemple). Symétriquement, certaines communes plus rurales (en tout cas moins denses) apparaissent désormais (Guéret ou Auch, par exemple).
Au total ont ainsi été repéré 1 300 quartiers, baptisés « quartiers prioritaires » et connus sous le sigle « QP » ou « QPV » (pour « quartiers de la politique de la ville »). Cette phase de resserrage par rapport aux anciennes procédures et à leurs 2 500 quartiers, a connu rapidement son écrémage et son nouveau ciblage. En effet, en octobre 2015, les QP ont été complétés par les QTP, les « quartiers très prioritaires ». Ceci avant, peut-être, une extension à d’autres quartiers qui s’estiment injustement mis à l’écart de cette géographie prioritaire. Et une reprise de souffle donc dans l’accordéon.
ENCADRÉ – La définition des nouveaux quartiers prioritaires
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose que les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont caractérisés par un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart, indique la loi, « sera défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui pourront varier en fonction de la taille de cette unité urbaine ».
Un décret du 3 juillet 2015 fixe à 1 000 le nombre minimal d’habitants conduisant à la délimitation d’un quartier prioritaire. Il définit le critère de revenu des habitants comme le « revenu médian par unité de consommation » (RMUC).
Pour être un quartier prioritaire, un territoire doit avoir un RMUC inférieur au seuil de revenu médian par unité de consommation, calculé selon une formules qui diffèrent selon que l’unité urbaine a une population de moins de 5 millions d’habitants ou d’au moins 5 millions d’habitants.
La formule : le seuil de revenu médian par unité de consommation mentionné est défini ainsi,
1º Pour les unités urbaines de moins de 5 millions d´habitants :
S = 0,6 × ([0,7 × RMUC-nat) + (0,3 × RMUC-UU]) ;
2º Pour les unités urbaines de 5 millions d´habitants ou plus :
S = 0,6 × ([0,3 × RMUC-nat) + (0,7 × RMUC-UU]),
pour son application, S est le seuil de revenu médian par unité de consommation, RMUC-nat est le revenu médian par unité de consommation de la France métropolitaine et RMUC-UU est le revenu médian par unité de consommation de l’unité urbaine au sein de laquelle est situé le quartier.
Le décret précise que la délimitation des quartiers prioritaires implique la consultation des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de métropoles et de maires des communes concernés. On doit ainsi retenir que les quartiers prioritaires ne résultent pas uniquement des seuls ordinateurs de l’INSEE, mais aussi d’une discussion politique.
FIN DE l’ENCADRÉ
Tous ces changements dans l’organisation territoriale de la politique de la ville n’ont probablement pas un grand impact sur le quotidien des habitants et sur celui des opérateurs de la politique de la ville. Sur les habitants, il en va presque sans dire, puisqu’il s’agit, avec la réforme de la géographie prioritaire, d’une réforme administrative très technique. À court terme, une telle révision des cibles de l’action publique n’aura aucune incidence. Il est cependant évident que l’intention est d’avoir un impact, à long terme, sur les habitants avec des procédures et des moyens plus adaptés. A ce titre, c’est probablement sur les opérateurs de la politique de la ville que la réforme aura le plus de conséquences. La suppression du zonage en ZUS et ZRU va transformer les avantages socio-fiscaux qu’il y avait à s’installer dans ces zones. Signalons que les ZFU (les « zones franches ») demeurent, avec une nouvelle appellation, plus dynamique et positive : on les appelles désormais les « territoires entrepreneurs ». C’est tout de même bien d’un changement significatif qu’il s’agit, du point de vue de la politique économique de soutien aux quartiers en difficulté.
Quant au sujet de l’animation et du soutien dans ces quartiers, activités généralement gérées par des associations, la nouvelle géographie ne devrait pas avoir d’incidence notable. Les sommes dévolues à la politique de la ville ne vont pas beaucoup changer. De toutes les manières, le bilan de cette réforme sera à apprécier dans le cadre plus général de la réforme territoriale (avec diminution du nombre des régions, et évolution du rôle des départements). C’est cette transformation plus globale de l’action publique locale qui aura le plus d’impact sur la manière de gérer les quartiers de la politique de la ville. D’ailleurs, quelles que soient l’issue du scrutin de 2017 et les orientations qui s’ensuivront, le devenir de ces quartiers sera toujours davantage fonction des interventions génériques affectant tous les territoires que des interventions spécifiques cherchant à traiter spécialement les territoires dits prioritaires.
Pour en savoir plus
Damon J. (2010), Questions sociales et questions urbaines, Paris, PUF.
« Économie des quartiers prioritaires », Revue économique, n° 3, 2016.
[1]. Pour les informations socio-démographiques, les plus récentes, voir « Les habitants des quartiers de la politique de la ville », INSEE Première n° 1593, 2016.
[2]. Cf. B. Aubry, M. Tribalat, « Les jeunes d’origine étrangère », Commentaire, n° 126, 2009.
[3]. Sur ce point très sensible, P. Beckouche, « terroristes français : une géographie sociale accablante », Libération, 28 décembre 2015, qui signale que de Mohamed Merah à Amedy Coulibaly en passant par les frères Abdeslam, ces jihadistes viennent surtout de zones urbaines sensibles.
[4]. Sur les évolutions et évaluations contrastées de la politique de la ville, voir les travaux de R. Epstein et T. Kirszbaum.
Une prise de position argumentée, dans le cadre d’un débat important.
« Pour un service national obligatoire », Les Cahiers français, n° 396, 2017, pp. 73-76.
Rétrospective de la prospective de la branche Famille
Variables, scénarios et enseignements
Julien Damon
Julien Damon est professeur associé à Sciences Po et conseiller scientifique de l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (En3s). Il a été responsable de la recherche et de la prospective à la CNAF de 1999 à 2005. Dernier ouvrage paru : La sécurité sociale (PUF, coll. « Que sais-je ? », 2015).
La branche famille est familière de la prospective. Les démarches les plus récentes s’inscrivent dans une tradition de travaux d’anticipation, de projection et de prospective remontant aux années 1960. La branche, notamment par l’intermédiaire de ses dirigeants qui participaient aux Commissions du Plan comme aux analyses doctrinales publiées notamment dans la revue Droit Social, a alors largement contribué à des réflexions et inflexions de la politique familiale.
On peut, ensuite, grossièrement distinguer quatre périodes passées qui ont été caractérisées par quatre principaux sujets de prospective. Les premiers travaux (publiés dans les années 1970 et 1980) portent sur la famille, son évolution et l’évolution plus générale des politiques sociales. Une deuxième période (dans les années 1990) porte sur la politique familiale, et, directement, sur ce que les CAF peuvent faire et proposer dans un environnement qui se transforme. Une troisième période (dans les années 2000) traite de l’environnement des politiques familiales, avec établissement de scénarios de contexte, en se penchant sur les conséquences de différents scénarios sur les CAF. Une quatrième période (au début des années 2010) va plus directement se concentrer sur les perspectives et souhaits d’évolution des métiers, de l’identité et du réseau des CAF. Ces exercices les plus récents se rattachent à une logique plus générale de montage et de suivi des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d’objectif et de gestion. Mais leur horizon temporel, supérieur à l’annualité des LFSS et au caractère quinquennal des COG, autorise un détachement vis-à-vis des priorités urgentes, ceci afin de préparer des orientations stratégiques.
Au fil des années, les scénarios sur les politiques familiales, comme sur les CAF elles-mêmes ont été proposés, révisés, raffinés. La relecture de trois travaux passés permet certes de donner une idée de la richesse du passé, mais surtout de formaliser ce qu’il en est des options possibles, des variables déterminantes et même des scénarios pour les CAF. Rien n’est définitivement écrit pour l’avenir des CAF, mais les démarches prospectives ont permis de le baliser. Un point commun absolument central de toutes ces démarches tient du rôle des CAF dans la construction, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques. Il n’y a pas là expression d’un défaitisme face au constat de transformations par rapport à de supposés âges d’or passés, mais, au contraire, expression du volontarisme de la branche famille.
Un groupe prospective au début de la décennie 1990
Un groupe prospective, constitué autour de la Commission Organisation et Gestion (le sigle COG n’était pas employé, et ne désignait pas une convention avec l’Etat) réunissant la CNAF et le réseau des CAF, rend un rapport en 1991 avec un « essai de projection prospective de la gestion des Caisses ». Les sujets et éléments d’analyse retentissent comme profondément actuels. Alors que le rapport raisonne à l’horizon 2000, nombre de ses constats et perspectives se retrouvent, toutes choses égales par ailleurs, lorsque l’on raisonne maintenant, en 2015, à l’horizon 2025. On peut présenter, à la serpe, les éléments constitutifs de cet exercice.
Les variables de l’environnement stratégique à venir
Des changements majeurs envisagés pour la branche
Des faiblesses et des forces institutionnelles
Une stratégie pour les années 1990 (à relire donc avec des yeux visant 2025…)
Les CAF à l’horizon 2000, vues du milieu des années 1990
Un groupe de travail interne a réalisé fin 1996, un nouvel exercice de prospective en mettant au jour les variables centrales d’évolution des CAF entre 1995 et 2000. Dans un système estimé relativement stable, quatre variables décisives ou « motrices » fortement structurantes ont été identifiées : 1/ la politique de redistribution, 2/ les mutations technologiques, 3/ les profils des publics, 4/ l’autonomie de conception des CAF. En l’absence de degrés de liberté supplémentaire, l’avenir du système apparaît ainsi relativement encadré et prédictible.
Le travail effectué par le groupe a permis de construire différents arbres d’influence mettant en évidence les effets cumulés des variables, et illustrant la dynamique du système étudié. Une quarantaine de tendances lourdes à horizon 2000 ont pu être identifiées et validées par les directeurs des CAF, parmi lesquelles la fiscalisation croissante des ressources, un plus grand ciblage et une plus forte conditionnalité des prestations, la montée en puissance des acteurs locaux.
L’analyse des jeux d’acteurs a permis, quant à elle, d’identifier les acteurs internes et externes les plus en accord et en désaccord avec les objectifs de développement des CAF. Les désaccords potentiels apparaissent en nombre limité et les CAF semblent se mouvoir dans un environnement autorisant des actions stratégiques nouvelles pour peu que leurs visées et leurs modalités d’application soient clairement explicitées.
Le groupe a enfin élaboré quatre scénarios de développement selon des trames très différentes :
Quatre scénarios très contrastés donc, mais avec, au fond, un sujet commun : celui de la place et du rôle des CAF dans des politiques dont la conception risque de davantage leur échapper.
Encadré – La branche Famille de demain vue de 1995
Le Directeur des prestations familiales de la CNAF a tenté, en 1995, une prévision de ce que pouvait être la branche Famille dans dix ans (c’est-à-dire à peu près en 2005 quand était organisée une autre démarche prospective). Insistant sur le « caractère ardu de la tâche » il écrivait que l’exercice relevait de « la plus haute acrobatie intellectuelle ». Rappelant que la branche Famille abritait en son sein bien d’autres éléments (politiques du logement, des revenus, du handicap, etc.) Philippe Steck la présentait comme « multipolaire ». Il envisageait trois scénarios :
Ces trois scénarios sont de facture au fond très classique car ils correspondent à trois hypothèses simples (mais extrêmement utiles) : le déclin, la stabilité, le retour à l’ambition.
Le scénario du déclin prend en compte l’évolution passée qui, de 1946 à 1994, a vu la branche Famille considérablement reculer, proportionnellement aux autres, en termes de masse financière. Elle représentait plus de 40 % du total des dépenses de Sécurité sociale en 1946, et n’en représentait plus qu’environ 11 % vers 1995. Certaines variables, déjà repérées par Ph. Steck, comme le vieillissement de la population, l’absence de maîtrise des dépenses de santé ou la poursuite du déclin démographique pouvaient laisser envisager une branche Famille marginalisée, à hauteur de 4 ou 5 % des dépenses de Sécurité sociale. Dans ce scénario le financement par les cotisations ne se justifie plus et l’appartenance même à la Sécurité sociale est présentée comme « aléatoire ».
Le scénario de stabilité de la politique familiale prenait appui sur les dispositions et les ambitions de la loi famille du 25 juillet 1994. Dans le cadre de ce plan, la politique familiale devait être en quelque sorte rehaussée, et sortir de son statut de « politique résiduelle, aléa du développement des autres politiques sociales ». La loi famille, appuyée par une nécessaire croissance soutenue, pourrait permettre une quasi-stabilité des moyens de la branche Famille à hauteur de 10 % des dépenses de Sécurité sociale. Dans ce scénario, des priorités et des ciblages seraient établis vers la petite et la grande enfance. Le rapport action sociale/prestations légales pourrait passer de 5 à 15 %, avec un souci plus affirmé de développement des équipements.
Le scénario de très forte relance de la politique familiale reposait sur l’hypothèse d’un retour aux options de 1946. C’est principalement le constat d’un « crash » démographique accéléré, relayé par une prise de conscience européenne, qui pourrait être à l’origine d’un sursaut. Très improbable, selon son concepteur, ce scénario est celui d’une « gigantesque volonté politique » pour un « changement d’échelle intense ».
Pour l’auteur, l’avenir le plus probable, en 1995, est celui d’une hybridation de ses scénarios 1 et 2. A côté de ces extrapolations, il repérait, sous une large rubrique baptisée « l’imprévu…», quelques faits « lourds et porteurs » qui pouvaient avoir un impact majeur sur les évolutions de la branche et de la politique familiale. Il relevait ainsi la possibilité d’une apparition d’un « grand service public de garde gratuite des enfants âgés de moins de trois ans ». Pour la « génétique » du phénomène il notait que cette idée ne pouvait passer que si elle était portée par une femme ou un homme public qui, tel Jules Ferry en son temps, imaginait « la création d’une école pré-maternelle pour les bébés ».
Source : Philippe Steck, « La branche famille demain », Droit social, n° 9/10, 1995, pp. 808-814.
FIN DE L’ENCADRÉ
Les « futurs possibles » de la politique familiale, vus de 2005
La démarche récente de prospective la plus conséquente, au moins en termes d’investissement, a été développée de 2004 à 2006. Elle a permis de traiter, de façon très approfondie, de l’environnement global et des évolutions possibles des politiques familiales. Au terme d’un exercice de micro-scénarios par composantes (démographie, politique, etc.), il a été possible de dessiner et de déduire des scénarios globaux d’environnement de la politique familiale et, partant, des futurs possibles en termes de politique familiale.
Un premier scénario – tendanciel et le plus probable – relève d’ajustements paramétriques, sans réformes en profondeur. Il est marqué par un repli mécanique de la politique familiale par rapport à d’autres domaines de protection sociale. Dans un deuxième cadre il est possible d’imaginer que tous les indicateurs d’environnement se remettraient au vert, ce qui permettrait la reprise d’une dynamique vertueuse pour les dépenses publiques en direction des familles et des enfants. Ce scénario est spontanément assez improbable, dans la mesure où il ne va pas de soi et suppose la conduite de politiques très volontaristes, impliquant précisément des réformes en profondeur. Face aux évolutions démographiques et aux problèmes de financement, notamment, des choix peuvent être faits au détriment de la politique familiale (celle-ci étant contestée et critiquée) ou bien en sa faveur (ses performances étant valorisées, et sa légitimité réassurée). Il s’ensuit deux scénarios nécessairement contrastés, celui d’une politique familiale contestée ou celui d’une politique familiale rénovée.
Tendanciel sans réforme : le repli mécanique de la politique familiale
Ce futur possible se caractérise par le prolongement des principales tendances en cours : un contexte économique morose, un vieillissement accéléré, la continuation des transformations familiales. Les pouvoirs publics ajusteraient et gèreraient au quotidien, avec certainement des tensions accrues en ce qui concerne les financements, mais aucune réforme fondamentale ne serait mise en œuvre. Mécaniquement, dans ce contexte, la politique familiale serait en repli relatif par rapport aux autres risques, voire même en repli absolu. Les rythmes actuels de création de nouvelles prestations et de complexification du droit ne seraient pas nécessairement ralentis. Les CAF pourraient en revanche être mises totalement en question, et leurs compétences et moyens absorbés par les collectivités locales et/ou par l’Etat. Inversement, elles pourraient continuer, en resserrant leurs activités, à investir et à agir dans des domaines toujours plus restreints de prestations légales et d’action sociale. Sans être radicalement remis en cause, les fondements de la branche famille se trouveraient considérablement affaiblis, tandis que le partenariat avec les collectivités locales se trouverait ballotté par les arbitrages budgétaires dans le domaine de l’action sociale, et les difficultés à établir des priorités dans les secteurs d’intervention.
Les indicateurs au vert : une politique familiale confortée
Ce futur possible se caractérise par la conjonction d’évolutions favorables pour conforter la politique familiale : une croissance « retrouvée » et riche en emplois, une stabilisation des transformations familiales, un vieillissement pondéré par un niveau de fécondité encore plus élevé qu’aujourd’hui. Ce futur possible (qui n’est pas impossible mais suppose notamment d’emprunter de nouveaux chemins, en particulier pour ce qui concerne la politique de l’emploi) est celui de tous les indicateurs au vert. La politique familiale serait dans ce cadre en expansion. Lui seraient attribuées certaines des vertus de la situation actuelle : elle permettrait ainsi de soutenir la fécondité et de mieux concilier vie familiale/vie professionnelle. La politique familiale à la française pourrait inspirer les orientations de l’Union Européenne. Les moyens financiers qui lui seraient alloués se trouveraient confortés même si le besoin d’une plus grande lisibilité continuerait de se faire sentir. Ce futur possible, optimiste, n’est pas nécessairement celui du statu quo quant aux formes et aux priorités des dépenses publiques en direction des familles. De nouvelles options seraient possibles. Pour les CAF, ce scénario pourrait s’accompagner de changements notables, en particulier dans leurs relations, de plus en plus contractualisées, avec les collectivités locales.
La politique familiale contestée, sacrifiée
Dans un contexte de faible croissance, d’explosion des dépenses vieillesse/dépendance, de difficultés persistantes à maîtriser les dépenses de santé, des arbitrages défavorables seraient effectués au détriment de la politique familiale. Les dépenses de prestations, mais également les dépenses fiscales, voire celles pour les équipements seraient réorientées au profit d’autres risques. La remise en cause de l’universalité des allocations familiales pourrait être radicale. Le ciblage pourrait être extrêmement précis sur les catégories les plus défavorisées de la population. L’idée même d’une politique familiale à base et visée universelle serait contestée, au profit d’une logique d’aide sociale pour les familles à bas, voire très bas revenus. Cette contestation et ce sacrifice seraient rendus possibles par l’incapacité à démontrer ce qu’il en est véritablement des effets et des coûts des dépenses en direction des familles. Un autre appui à cette option serait de critiquer la socialisation des revenus et de laisser aux « solidarités » familiales le rôle de la politique familiale. A moins de disparaître, les CAF pourraient alors être conduites à recomposer leurs interventions dans des logiques centrées sur l’insertion ou encore le financement d’établissements et de services locaux pour les enfants en difficultés, les personnes âgées dépendantes ou les handicapés. Les CAF deviendraient alors, avant tout, des prestataires de services des départements.
La politique familiale rénovée et recentrée
Dans un contexte qui peut être celui d’un cumul de difficultés financières et sociales comme celui d’un contexte plus favorable (relativement), des arbitrages seraient effectués entre les différents pans de la protection sociale. Ces arbitrages seraient réalisés en faveur des investissements en direction des enfants et de la jeunesse. Il pourrait s’ensuivre une politique familiale renforcée mais réformée, avec des priorités claires quant à ses domaines, voire même ses modalités d’intervention. Sur le plan des formes, dans ce contexte « favorable » à la « politique familiale », les CAF pourraient toutefois se trouver en retrait, un outil fiscal puissant (par exemple) se substituant à la myriade des prestations. Les CAF pourraient au contraire occuper un rôle de premier plan dans la mise en œuvre d’un service public de la petite enfance, en tant qu’autorité organisatrice, aux côtés de l’Etat et des collectivités locales (comme pour les transports publics locaux).
*
* *
Que retirer, en ultime synthèse, de cette relecture d’anciens travaux de prospective ? Trois leçons se dégagent. En premier lieu, on l’aura plusieurs fois noté, ce qui saute aux yeux c’est l’actualité des variables, des hypothèses et des scénarios. En deuxième instance, ce qui pourra avoir marqué le lecteur de ces relectures, ce sont les répétitions et les ressemblances à des années et des décennies d’écart. Est-ce à dire que le futur prend toujours, vu du jour, les mêmes formes et directions, avec donc une forme de fatalisme, condamnant notamment les CAF à une dépendance accrue vis-à-vis d’autres acteurs ? Rien n’est moins certain. Et c’est dans la diversité des scénarios que se trouve véritablement la richesse de tous ces exercices. Mais il est un troisième enseignement, portant non pas sur les variables à prendre en compte. Celles-ci sont, au fond, presque toujours les mêmes. Mais leur importance relative diffère largement. Au regard de l’actualité, et ceci afin de souligner que rien n’est définitivement écrit ni acquis, il est probable que la variable « révolution numérique » (repérable depuis des décennies, sous d’autres termes et avec des conséquences supposées bien moindres) soit à intégrer avec plus grande force pour réévaluer tout ce qui a pu être dessiné et scénarisé jusqu’à aujourd’hui. L’avenir des CAF et de la politique familiale n’est en rien définitivement déterminé. Mais il ne peut raisonnablement s’envisager qu’en ne raisonnant plus à partir des habitudes et perspectives de la société industrielle, que l’histoire des CAF et de la politique familiale a pleinement accompagné, mais en fonction de l’essor d’une société numérique qui transforme tout. Et que les différents exercices de prospective ont tous, à leur manière, annoncé.
Établir des habitats flottants permanents ne serait plus uniquement une utopie pour les riches mais une option sérieuse pour l’humanité. Le pari technologique et financier de la production de nouveaux espaces au-delà des terres relève toujours de projets de société. Projections réalistes ou programmes fictifs ?
La Smart Cité en 2040 :
l’utopie urbaine en deux fictions
Julien Damon, Professeur associé à Sciences Po, auteur, notamment de Questions sociales et questions urbaines (PUF, 2010) et Les 100 mots de la ville (PUF, 2015). www.eclairs.fr
Villes, métropoles et mégapoles sont, historiquement, de bons terreaux à utopies et dystopies. La ville fait rêver ou cauchemarder, c’est selon. Aujourd’hui la mode est à tout ce qui est smart (intelligent, élégant, habile), notamment en territoires urbains. Et on projette des réalisations grandioses ou des préoccupations graves. En tout état de cause, smart et utopie sont engagés ensemble sur le bateau de la réflexion urbaine. Celle-ci peut passer par des modèles, des tables et des projections statistiques. Elle peut aussi passer par un peu d’imagination. Une imagination qui est à l’œuvre, en matière urbaine, depuis bien longtemps.
L’utopie fête, en 2016, son demi-millénaire. Thomas More publie, en effet, en 1516 son Utopia, ce « nulle part », qui ne figure sur aucune carte, peuplé d’Utopiens qui résident dans l’une des 54 villes de l’ile. Chacun loge dans une maison confortable sans serrure mais avec jardinet. Tous les dix ans, il en change par tirage au sort afin d’éviter le syndrome du propriétaire. Il prend ses repas dans une taverne collective, s’initie aux arts, écoute des conférence, pratique le culte de son choix, peut divorcer. Ce texte se constitue en genre littéraire et l’on ne compte plus les utopies que le monde occidental va produire au cours des siècles suivants pour épouser et renforcer au 20ème siècle la littérature de science-fiction. Les utopies sont variées et si certaines se déroulent en ville, la plupart sont agro-artisanales ce qui ne déplaira pas au mouvement hippy américain ou aux néo-ruraux français de l’après mai 68. À dire vrai, l’utopie est d’abord une démarche plus qu’une contre-société. L’architecture et l’urbanisme n’y tiennent qu’un rôle secondaire, bien après l’amour, l’éducation, les loisirs. L’urbanisation progressant partout, c’est plutôt directement dans les villes, et dans des villes transformés, que l’imagination utopique puise maintenant son essence. Après l’île d’Utopie, c’est désormais la smart city qui fait songer, conjecturer, fantasmer. Avec des réalités – certes augmentées – mais très concrètes.
Pour en rendre compte, on passera par le récit. Ces deux courtes fictions portent, de façon contrastée et décalée, sur la vie quotidienne d’un chef d’entreprise métropolitain d’ici une vingtaine d’années. L’idée est de montrer les avantage et inconvénients des logiques smart. Il s’agit, surtout, de démythifier, par le sourire et l’imagination, les deux perspectives opposées du cauchemar technologique et du paradis numérique.
Relevons, à titre introductif, que le même exercice mené il y a vingt ans, n’aurait vraisemblablement pas mesurer ce qu’allaient être la diffusion et la pénétration dans la vie quotidienne des téléphones portables (qui n’étaient pas encore dits intelligents), des GPS, des courriers électroniques ou, plus généralement, de l’Internet… Pour ne rien dire de l’autopartage, du retour du tramway et du vélo, rendus possibles par les performances des systèmes d’information.
Et n’oublions pas que le rêve des uns peut être le cauchemar des autres. Et vice-versa.
Nightmare city
Sylvain Camille vient de se réveiller. Il est 7 heures. Ses enfants – il en a la garde aujourd’hui – vont pouvoir prendre leur petit-déjeuner qui se prépare automatiquement avec la cuisine totalement intégrée et connectée de l’appartement. Ses soucis sont d’ordre professionnel. Économiquement, sa société de conseil en design fonctionne plutôt bien. Mais il ne sait pas si la banque lui accordera ce matin le crédit quotidien dont il a besoin pour payer – comme chaque jour – la Taxe sur les Données Ajoutées (TDA) que chaque métropole, depuis 2025, fixe avec différents taux tous les jours.
Il lit les nouvelles sur la vitre intelligente de son salon, au vingtième étage de la tour Harmitage, juste au-dessus de la ferme urbaine dont il apprécie les produits. Il est aujourd’hui bien fatigué. Le buzzer a, en effet, sonné deux fois, dans le cadre de son programme de disease management, pour lui rappeler de prendre ses cachets contre l’insomnie.
Après l’absorption d’un solide café et des informations, il prend sa voiture, le nouveau modèle de IpadVolvo avec toit ouvrant et quatre roues, qui lui permet de rejoindre son espace de travail à côté de la gare centrale. Pendant le trajet – totalement géré par l’ordinateur de bord – il refait les tableaux de financement pour son investissement dans une nouvelle imprimante 3D permettant de reproduire directement des appartements. Au-dessus de lui, dans la circulation mésoaérienne, des drones renifleurs d’incivilités repèrent et repoussent les individus indésirables et déconnectés qui, parfois, accèdent aux autoroutes des données. Les coûts de protection contre les cyberattaques représentent 40 % du budget métropolitain.
Arrivé à ce qu’il aime appeler, en termes désuets, son « bureau », il entre en communication holographique avec le Chief Data Officer de son arrondissement industriel. Délégué de la municipalité, mais payé par les différentes entreprises qui s’abonnent à ses services, celui-ci lui transmet la base quotidienne d’optimisation d’activité. Il en va, pour Sylvain, de sa consommation énergétique, et, surtout, de ses dépenses. La communication n’est pas amusante aujourd’hui car elle invite, assez sèchement, Sylvain à participer à un déjeuner au Schéma de Cohérence Territoriale des Entreprises (SCOTE). Virtuelle, cette rencontre permet à tout participant de consommer ce qu’il veut, mais elle est consommatrice de temps.
Ce n’est, en réalité, qu’à partir du début de l’après-midi que Sylvain trouve un moment dégagé de ses différents appareils de réalité augmentée. Il a une heure avec une feuille de papier, tout de même à écriture numérique. Il dessine un nouveau plan d’appartement, avec décoration standardisée mais également intégration des doubles normes Feng Shui 5.0 et Bonshommes Basse Consommation (BBC). L’ensemble lui semble correct, même si loin des vieilles études de design et d’architecture de son père.
Il reçoit un pneumanumérique sur son bureau. Les documents contenus dans cette mémoire de 7 To correspondent à l’appel d’offre en Partenariat Public Privé Population Police (PPPPP) lancé par le grand consortium VidiVicci et l’instance de gouvernance métropolitaine. L’ambition est d’installer de nouveaux services de dortoirs urbains, avec sanitaires et télématique intégrés, pour les ouvriers des réseaux. Ces derniers, travaillant la plupart du temps dans les sous-sols, habitent généralement en dehors des frontières métropolitaines. Les grandes entreprises et les élus ont décidé de leur proposer des équipements les autorisant, en semaine, à mieux concilier leurs temps de déplacement avec leurs obligations professionnelles. Un grand sujet est de trouver des espaces où implanter ces bâtiments d’un type nouveau, à distance raisonnable des tramways suspendus (c’est le principe Sleep In My Transportation Yard – SIMTY) et à distance raisonnable à la fois des habitations résidentielles du centre de l’agglomération et de son Central Business District (c’est le principe Not In Their BackYard – NITBY). Sylvain a lu dans un journal progressiste du début des années 2020 que de tels principes d’aménagement étaient ségrégatifs. Il ne le croit plus, notamment depuis qu’il a vu les grands groupes lancer des cours sur Internet pour diminuer la fracture numérique.
Sylvain Camille consacre, comme de tradition, la fin d’après-midi à ses amis et au sport. Il a pu rejoindre son club Dem’, où il pratique, en équipe, le trail sur pistes électroniques. Hélas, la séance est perturbée par une panne générale des systèmes du quartier. Depuis la grande attaque des OccupyHacking de 2031, certains segments urbains du système central d’informations font ponctuellement défaut. C’est le cas aujourd’hui. Les grandes installations, comme les trois aéroports, les retail clinics et les hôpitaux, les centrales d’énergie et la voirie, ont pu être intégralement sécurisés. Mais les coûts sont trop importants pour empêcher toute intrusion dans d’autres sous-systèmes. Pas de sport donc aujourd’hui. Il en profite tout de même pour une télérencontre dans le salon de sa mère. Âgée, elle se trouve depuis cinq ans dans un Établissement Personnalisé Attentif à Haute Domotique (EPAHD). Elle lui indique, comme d’habitude, qu’elle regrette de ne pas l’avoir vu depuis cinq ans.
Le soir, en se couchant, il se rappelle de la lecture d’un ouvrage du milieu du siècle précédant, évoquant une sorte de enormous brother qui contrôlait toute la ville. Avec ses cachets bien pris, il s’endort tout de même heureux de ne pas dépendre totalement ainsi d’un seul homme. Mais inquiet de voir sa vie reposer sur une infinité d’applications interopérables mais pas toujours agréables…
Dream city
Camille Sylvain n’a pas entendu le réveil à 7 heures. Mais à 7 heures 15, la couette autochauffante s’est mise à rouler à terre. Elle a la possibilité de prendre, virtuellement, un petit-déjeuner avec ses enfants qui ne sont pas avec elle aujourd’hui. Professionnellement, elle est heureuse de savoir qu’elle, ses associés et l’ensemble des protoentrepreneurs qui exercent dans sa société vont pouvoir se rencontrer ensuite – tout aussi virtuellement – dans la salle de conférences organisée dans ce qui était une salle à manger.
Elle sort faire un jogging, accompagné de son assistant personnel, un robot D3R3 dernier modèle qui lui fait part des dernières informations et également de ses performances sportives immédiates. Sur le chemin, Camille a le plaisir de croiser la directrice du service « égalité d’accès » à la mairie centrale. Elle l’apprécie car c’est avec elle qu’elle a pu designer à la fois l’espace d’accueil et, surtout, les programmes de formation en ligne qui assurent l’égalité numérique.
Juste avant la fin de ce jogging, au moment d’arrêt optimal signalé par D3R3, Camille notifie le virement annuel de Taxe sur le Numérique Adapté (TNA) que la métropole prélève. C’est, depuis la grande réforme fiscale de la fin des années 2010 (celle qui a fait suite à l’effondrement des finances locales), le seul impôt métropolitain pesant sur les entreprises. Avec un taux relativement élevé (20 % des bénéfices et 10 % du montant total des abonnements numériques), cette taxe est très bien acceptée. Dans son club des incubateurs métropolitains – qui permet des échanges avec toutes les catégories d’entreprises et d’entrepreneurs – Camille a même soutenu une motion visant à faire basculer une partie des prélèvements pesant sur les ménages vers la TNA. C’est une question d’attractivité, autant pour des personnes talentueuses et aisées que pour des ménages moins favorisés.
Alors qu’il n’existe plus que de véhicules totalement individuels et que l’offre de transports collectifs (allant de vélos en libre-service à des Trains Intraurbains à Grande Vitesse – TIGV) est très étendue, Camille emprunte surtout le covoiturage des véhicules en autopartage. Les systèmes d’enregistrement préalable permettent à tout passager d’avoir des informations de base sur de futurs autres passagers. L’ensemble autorise des discussions par affinité, mais aussi, si l’on se débranche, un peu de surprise.
Elle arrive, en général, le matin à 11:00 au sein de son Massive Open Space (MOS), un espace de travail partagé par 1 257 salariés et entrepreneurs. Chaque jour elle sait auprès de qui elle va se retrouver. Un ancien terme – celui d’écosystème – cherchait à désigner cette émulation rendue concrètement et humainement possible dans ces nouveaux tiers-lieux de l’activité professionnelle, entre chez-soi et le bureau fixe. 56 % des actifs exercent maintenant de la sorte.
Il en va autrement des réseautiers, nom donné à partir de 2025 à toutes les personnes exerçant, notamment en sous-sol, dans l’implantation et la maintenance des services de gestion des fluides (de l’eau à la donnée). Le nombre d’emploi a cependant fondu dans ces domaines tandis que l’élévation des niveaux de technicité a conduit à une augmentation importante des rémunérations. Afin d’attirer ces talents concrets, la métropole a même mis en place un régime de formation et de retraite avantageux. En référence à un ancien régime d’assurance chômage, les promoteurs de ce modèle l’ont baptisé le régime des intermittents des réseaux, avec un mi-temps affecté à la formation et un autre à la production. L’ensemble de la protection sociale, qui couvre l’ensemble de la population métropolitaine, est intégré et géré par la Régie smart de l’Indemnisation (RSI), un partenariat public privé à performance prouvée (PPPPP).
Camille et ses proches correspondent à la famille typique. Avec des revenus moyens et un mode d’existence conforme aux normes ISO 20250032 (normes non contraignantes d’adaptation environnementale), elle a, comme 78 % des habitants, un niveau très élevé de satisfaction à l’égard de sa ville et de sa vie.
Aujourd’hui, après sa réunion du matin, elle déjeune, en face-à-face, avec deux amis, protoentrepreneurs également. Ils étaient auparavant réseautiers mais, grâce à la formation, ils ont pu accéder à ce nouveau statut. Ils sont aujourd’hui restaurateurs, et ont lancé le nouveau concept du déjeuner débranché. Dans des espaces sans réseaux sociaux ni lignes électroniques ouvertes, les mets dégustés sont issus des 27ème et 28ème étages des tours du quartier de La Fée Danse, là où l’ensoleillement est optimal.
L’après-midi de Camille est consacré à produire son nouvel ensemblier de couleurs de décoration. Celles-ci se vendent à travers le monde. Il lui faut les imaginer et les tester sur des panels modélisés, à partir de développements qui ont été programmés par les étudiants de l’Université Bill Gates/Paul Delouvrier.
Camille sort ensuite pour participer, dans la salle de la mairie de quartier, à la discussion collective hebdomadaire où sont présentés les projets d’aménagement. Les divers résultats des consultations organisées dans la semaine sont discutés par échanges interactifs sur les écrans intégrés aux grandes baies vitrées. Ces confrontations, toujours positives, l’intéressent. Comme elles intéressent les investisseurs et aménageurs qui ont vu les temps de réalisation des projets divisés par trois en trente ans.
Rentrée chez elle à 20 heures, elle s’amuse à jouer avec ses enfants à la Conf’ Call – une activité ancienne dont le souvenir l’amuse et dont les enfants pensent qu’elle ne servait qu’à rigoler. Elle utilise ensuite, après les avoir embrassés, son casque stimulateur qui permet de piloter consciemment les rêves. En commun avec son compagnon Charles, resté à New York pour le mois. Mais avant de s’endormir, elle ne résiste pas à l’idée de passer un peu de temps sur cet ancien jeu, Sim city. Et, comme chaque fois, elle sourie en organisant sciemment des embouteillages et des pannes électriques. Deux éléments du passé dont ses enfants ne veulent pas croire qu’ils aient pu exister.
Évolution des sociétés et des modes de vie dans le monde
Julien Damon
On ne saurait, aux horizons 2030 et 2050, peindre un panorama prospectif exhaustif des évolutions sociales possibles dans le monde. On peut, en revanche, insister sur des tendances extrêmement structurantes. On en retiendra quatre. Le monde sera, demain, moins pauvre. La perspective d’extinction de la pauvreté extrême n’est pas utopique, même s’il faut conserver à l’esprit le sujet de la progression des inégalités. Deuxième dynamique, les classes moyennes émergentes vont très probablement continuer à s’affirmer, avec leurs nouvelles aspirations et d’importants potentiels de consommation. Troisième mouvement, l’urbanisation va poursuivre sa progression, sous ses deux formes très contrastées de la métropolisation (concentration des richesses et des activités dans les grands centres urbains) et bidonvillisation (extension des habitats dégradés). Enfin, quatrième évolution majeure, le monde sera plus religieux qu’attendu. Ces phénomènes affecteront très différemment pays pauvres (plus religieux et en cours de moyennisation) et pays riches (moins religieux et affectés par une certaine démoyennisation).
https://www.futuribles.com/fr/revue/415/societes-et-modes-de-vie-dans-le-monde-grandes-ten/
Julien Damon
Passée de la proscription à la prescription, puis à la normalisation, la résidence alternée est une organisation de l’hébergement et de l’existence des enfants de parents séparés. Elle consiste, essentiellement, en un partage du temps de l’enfant, selon une fréquence d’alternance qui peut varier, entre deux foyers. L’enfant a ainsi deux foyers, deux logements et, plus concrètement, deux chambres. Il s’agit, pour lui, de s’adapter à un mode de vie que lui ont choisi ses parents (comme après toute séparation).
Un enfant peut être, une semaine, en famille recomposée, l’autre semaine en famille monoparentale. Il peut vivre, chaque semaine, dans une famille monoparentale différente (une semaine avec son père, une semaine avec sa mère). Il peut aussi vivre, alternativement, dans deux familles recomposées différentes. Dans le premier cas, il aura un beau-parent. Dans le second, il en aura deux. Le cas échéant, il pourra se trouver entre une famille recomposée avec un couple hétérosexuel et une famille recomposée homoparentale. Si le cas est statistiquement rare, il vient, avec les autres, montrer que résidence alternée et recomposition familiale posent toujours, pour les parents mais surtout pour l’enfant, des problèmes d’organisation, mais aussi de représentation et d’identification.
On propose ici une rapide synthèse sur ce sujet disputé, en tentant une pesée équilibrée des différents arguments.
Une pratique reconnue, et en progression, depuis une dizaine d’années
La pratique était très limitée et contestée à l’origine. La possibilité d’une reconnaissance a été plusieurs fois repoussée à l’occasion des multiples réformes de l’autorité parentale. La résidence alternée au domicile de chacun des parents a été consacrée par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale[1]. Inspirée de deux rapports importants[2], le texte énonce que « père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Cette règle sous-tend à la fois un droit de l’enfant à être élevé par ses deux parents et le droit pour chacun des parents d’être impliqué dans l’éducation de ses enfants. Introduisant la référence à l’intérêt de l’enfant, elle va compléter la définition de l’autorité parentale. Dans la suite de cette loi, l’article 371-1 du code civil est ainsi rédigé : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». L’article 373-2 du Code civil prévoit, par ailleurs, que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Ce texte uniformise les droits et devoirs de tous les enfants dont la filiation est établie. L’autorité parentale conjointe s’applique à tous les enfants quelle que soit la situation matrimoniale et quel que soit le type de filiation, y compris en cas de rupture du couple parental. La loi consacre totalement le principe dit de « coparentalité » en assurant le maintien du lien de l’enfant avec ses deux parents.
La loi de 2002 dispose que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ». Et le législateur ajoute au Code civil que le juge, en cas notamment de désaccord des parents, peut ordonner une résidence alternée. Dans les séparations et divorces, la résidence alternée devient un modèle, au moins une modalité ordinaire, pour permettre le maintien des liens avec les parents.
Davantage encore qu’une modalité ordinaire, l’alternance et la double résidence pourraient même devenir la norme. Une proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, discutée à l’automne et l’été 2014[3], a voulu substituer à la notion d’alternance celle de double résidence de l’enfant. Le texte, très controversé et qui n’a finalement pas été adopté, pose le principe de la double domiciliation de l’enfant d’un couple séparé. Par exception, si aucun hébergement n’était possible chez l’un des parents (pour des raisons matérielles liées à ce domicile ou en raison de l’éloignement géographique, par exemple), le juge déterminerait la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents et fixerait le droit de visite de l’autre parent.
Le nombre d’enfants concernés par la résidence alternée reste relativement faible. Mais il augmente assez rapidement. Des études menées au début des années 2000 précisaient la décision d’une résidence alternée n’était prise que dans moins de 10 % des divorces d’époux avec des enfants. La proportion est probablement plus importante pour l’ensemble des enfants dont les parents sont séparés car le juge aux affaires familiales n’est systématiquement saisi que dans le cas des divorces. En 2012, le chiffre, pour les suites des divorces, est passé à 21 %.
Qu’en pensent les Français ? Le thème de la résidence alternée est devenu, à mesure de son affirmation dans le débat public et dans la réalité des famille, assez commun ; au point de voir différents sondages porter sur lui. Dans l’enquête barométrique du CREDOC sur les conditions de vie et les aspirations des Français, début 2014, il apparaît que 72 % des Français estiment que, lorsque les parents se séparent, l’enfant devrait résider alternativement chez son père et chez sa mère. Seuls 23 % considèrent que l’enfant devrait vivre principalement avec sa mère. On notera que quasiment personne (1 %) ne songe confier l’enfant principalement au père. 4 % des personnes interrogées ne sont pas fixées. Cette faveur pour la résidence alternée est, en tout cas, très largement défendue dans tous les groupes : les femmes (69 %), les seniors (67 %), les bas revenus (70 %).
Les arguments d’un débat vif
Au-delà du droit, il ressort de la progression de l’alternance, des manières de faire famille – c’est-à-dire de vivre au quotidien – qui diffèrent pour l’enfant : des horaires, des menus, des arts de la table, des règles de discipline, des modalités d’usage de la télévision ou des jeux vidéo. Il s’ensuit des contextes et types de socialisation qui peuvent significativement varier. Le tout produisant des enfants enrichis ou dérangés par ces expériences et contextes.
Certains critères sont à prendre en compte, par les parents comme par le juge, pour la mise en place d’une alternance de résidence : la proximité géographique des deux domiciles (pour limiter les déplacements) ; la proximité de l’école où est scolarisé l’enfant (l’école devenant une institution de stabilité) ; le niveau d’entente des parents (au moins sur les principes éducatifs) ; l’organisation pratique mise en place (dates et horaires d’alternance, partage des dépenses, etc.). L’âge de l’enfant est également pris en considération, de nombreux experts (médecins ou psychologues) estimant, souvent en accord avec les juges, que la résidence alternée peut être défavorable au développement du très jeune enfant.
Rien ne permet d’affirmer que l’hébergement partagé soit fatalement néfaste. Tout comme rien ne permet de dire qu’il soit naturellement bénéfique. Comme souvent en matière familiale, deux écoles s’opposent. Dans un camp, surtout, des pédopsychiatres qui dénoncent les hauts risques psychiques, en particulier sur les enfants de moins de six ans, et qui font état de leurs consultations avec des angoisses, du vide dans les regards, des troubles cutanés et du sommeil, de l’agressivité. Dans l’autre, des juristes et des familles militantes qui expliquent que, malgré d’incontestables difficultés, le modèle fonctionne. À coups d’exemples opposés, d’expertises et d’attaques, qui ne sont pas toujours convaincantes, ils exposent leurs arguments et, parfois, s’empoignent durement, par pétitions comme par ouvrages savants[4].
Arguments en faveur de la résidence alternée :
Arguments en défaveur de la résidence alternée :
Les arguments puisent dans les mêmes familles d’idées, d’observations et de principes que ceux qui condamnent ou qui vantent les recompositions familiales. La résidence alternée est alternativement présentée, d’un côté, comme source de joie et de partage, et, de l’autre, comme nid de psychopathologies. Les enfants directement impliqués peuvent tout autant joyeusement dire que l’on leur fête deux fois leur anniversaire et Noël, que tristement signaler, comme tout enfant de parents séparés, qu’ils trouvent douloureux et malheureux de vivre cette situation.
L’absence d’études irréfutables sur les conséquences positives ou négatives pour l’enfant, noyée dans la généralisation d’observations cliniques (qui, par construction, ne portent que sur des dysfonctionnements[5]) tout comme dans l’affirmation de grands principes généraux empêchent de conclure définitivement. Qui y trouve, en définitive, son compte ? Des parents séparés qui se préservent chacun un mi-temps d’enfants ? Ou des enfants qui voient leurs parents à mi-temps à défaut d’un plein temps ?
S’il est impossible de démêler une incontestable vérité, on peut convenir que la résidence alternée n’a pas le même impact sur tous les enfants, comme sur tous les parents. Ces derniers ont d’ailleurs un profil qui présente des singularités, même s’il est impossible, faute de données précises, d’en dresser un portrait détaillé. Le faible recours à l’aide juridictionnelle, tout comme l’ampleur des dépenses que suppose la mise en place d’une résidence alternée, laisse d’abord penser que les parents qui demandent ce mode de résidence sont dans une situation financière relativement aisée. Toutes les catégories sociales peuvent être séduites, mais les coûts sont élevés notamment quand il faut acheter en double des vêtements ou des fournitures scolaires, pour ne rien dire des difficultés à se loger dans des conditions permettant un accueil de qualité pour un enfant. Ensuite, ces parents doivent avoir sur la famille et les enfants des idées modernes (ou qui le sont devenues) pour s’investir dans des solutions qui étaient jusqu’à récemment refusées sous prétexte qu’elles seraient nuisibles par principe à l’enfant. Enfin, il faut un haut niveau d’entente du couple parental pour surpasser des tensions et confrontations qui ont pu être à la source de la dislocation du couple conjugal et qui peuvent se revivre à l’occasion de la vie en alternance de leurs enfants.
L’organisation d’une résidence alternée, qui n’est pas un droit des parents mais une option maintenant favorisée, n’est pas figée. Le rythme de l’alternance ne l’est pas, ses composantes non plus. Les parents, et éventuels beaux-parents arrivés en cours de route, ont le loisir de s’accorder sur des modifications. Si nécessaire, le juge peut être saisi. Tout d’abord, les formes de l’alternance varient. Dans certains cas (qui ne durent probablement pas longtemps) ce sont les parents qui alternent au même domicile où demeurent les enfants. Si la plupart des résidences alternées cherchent une organisation rigoureuse et à stricte parité, avec des horaires bien fixés, permettant des repères aux parents et aux enfants, toutes les formules, des plus souples jusqu’aux plus acrobatiques (deux jours sur quatre par exemple) sont possibles. La loi n’impose pas, pour que la résidence de l’enfant soit fixée en alternance aux deux domiciles de chacun de ses parents séparés, que le temps passé par l’enfant chez son père et sa mère soit de même durée. Le juge peut même, si l’intérêt de l’enfant le commande, décider d’une alternance avec un partage inégal du temps de présence. Surtout, la formule n’est pas figée dans le temps. Elle peut s’adapter aux emplois du temps et à l’organisation familiale des parents, mais aussi aux aspirations des enfants qui, grandissant, doivent être entendus pour exprimer leurs préférences s’ils en font la demande.
Une entrée originale dans ce débat est de se demander, au vu de la fluidité et de la malléabilité possibles des organisations de résidence alternée, si toutes les séparations ne mènent pas, en réalité, à des organisations en alternance. On fait sciemment l’impasse sur les parents non gardiens qui n’exercent pas ou qui n’exercent plus le droit de visite, en se concentrant sur les cas où père et mère, d’une manière ou d’une autre, continuent à vivre, une partie du temps, avec leur enfant. Quand cet enfant n’a pas, juridiquement, de résidence alternée, dans les autres formes d’organisation après un divorce ou une séparation, il alterne bien entre deux domiciles, à un rythme qui n’est pas égal. Il aura une résidence que le droit dira « habituelle », mais au minimum un week-end sur deux, et la moitié des vacances, il vivra avec son autre parent, dans un autre contexte familial. Tout enfant de parents séparés vit, en quelque sorte, en multirésidence. Dans cet ordre d’idées, les critiques à l’endroit de la résidence alternée pourraient être, plus généralement, des critiques à l’égard des séparations et des divorces.
Les politiques familiales recomposées
Quittant la sphère des débats d’opportunité pour revenir à celle des faits et du droit, il faut maintenant indiquer que la résidence alternée est une source particulière de recomposition et complexification des politiques familiales. Partageant le temps et la charge des enfants, l’alternance de résidence amène le sujet du partage des prestations et des avantages fiscaux.
Avec la coparentalité, les deux parents ont l’autorité parentale et la charge effective et permanente de l’enfant (même s’il ne réside pas en permanence au domicile des deux). Ceci implique des adaptations pragmatiques du droit social à ce que les faits et maintenant le droit civil organisent. En matière de santé, les enfants peuvent être inscrits sur la carte vitale de chacun des deux parents. Côté fiscal, depuis 2004, la charge est partagée entre les deux parents séparés en cas de résidence alternée. Chacun des parents a droit, pour le calcul de l’impôt de son foyer, à une majoration de part égale à la moitié de celle attribuée en cas de résidence exclusive. Le partage de la majoration implique également le partage des réductions et des crédits d’impôts liés aux enfants (frais de garde, frais de scolarité, taxe d’habitation). Le partage des allocations familiales entre les deux ex conjoints a été rendu possible par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007. Ce partage ne concerne que les allocations familiales, versées à partir du deuxième enfant sans condition de ressources, et non les autres prestations (prestations d’accueil du jeune enfant, allocations logement, etc.). Ces dernières sont soumises à des conditions de ressources ou bien modulées en fonction des ressources, ce qui rend, pour le moment, impossible de savoir comment exactement mesurer les ressources à prendre en considération, sauf à imaginer que les deux foyers organisant la résidence alternée fusionnent en un unique foyer fiscal, ce qui n’a, évidemment aucun sens. Elles restent donc versées à un seul des deux parents, à charge au couple de s’entendre sur une répartition et une circulation de cet argent.
Pour le calcul et le versement des allocations familiales, la charge de l’enfant est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe de leur part, soit s’ils sont en désaccord sur désignation de l’allocataire. Il est une autre possibilité, tout à fait légale, consistant à n’avoir qu’un parent allocataire, sans mention de la situation de résidence alternée. Le gain est net lorsqu’il y a recomposition familiale et apparition de nouveaux enfants dans l’un des deux foyers, dans l’un des deux résidences. L’allocataire maximise alors les allocations familiales, qui sont progressives en fonction du nombre d’enfants. Il restitue ensuite à son ex conjoint, soit la moitié du montant total, soit sa quote-part. Si l’un des deux parents est seul allocataire en titre, l’ensemble des enfants issus de lits différents ne forme pas, pour le versement des allocations familiales, une famille recomposée. Les parents par accord privé, se partageront, selon des clés de répartition qu’ils choisissent, les prestations. Résidence alternée et recomposition sont affaires d’arrangements privés. Certes, ces accords ne sont pas toujours possibles en raison de l’intensité des conflits, mais leurs bénéfices sont fortement incitatifs. Et la récente modulation des allocations familiales peut conduire à de nouveaux arbitrages et bricolages entre les foyers fiscaux des enfants en résidence alternée.
Illustrons. A et B sont séparés. Ils ont deux enfants en résidence alternée, et se trouvent, en termes de revenus, sous le plafond de modulation des allocations familiales. Choisissons un cas simple… Le montant mensuel d’allocations familiales est de 130 €. B vit maintenant avec C avec qui il a eu un enfant. Pour un seul enfant, il n’y a pas d’allocations familiales. Pour trois enfants, le montant est de 290 €. A, B et C ont intérêt à ce que B demeure allocataire pour les trois enfants et verse 65 € à son ex conjoint A. Sur le plan fiscal, la même opération est d’ailleurs réalisable. L’un des deux foyers, sauf s’il est à composition et à revenus parfaitement identiques, a intérêt à demeurer foyer fiscal de référence pour tous les enfants. Il maximise le nombre de parts pour le calcul du quotient familial. Avec trois enfants, déclarés à charge exclusive, le foyer de B et C compte deux parts, alors que dans le foyer A, avec deux enfants en résidence alternée il n’y a qu’une part. A, B et C ont, généralement, intérêt à ce que B et C bénéficient d’une forte réduction d’impôts dont ils feront ensuite profiter A à proportion de ce qu’aurait été pour son foyer le bénéfice du quotient familial. Tout est donc possible au cas par cas. Relevons que pour les cas relatifs aux calculs sur le quotient familial, il faut que les deux foyers soient assez aisés pour compter parmi les foyers imposés. Et il faut même certainement qu’ils atteignent des niveaux de revenus élevés leur permettant de maximiser le mécanisme du quotient familial, ce qui est loin d’être donné à tous.
Quelles limites ?
La leçon plus générale relève de la prospective. Alors que le partage des avantages socio-fiscaux est possible, pour le moment de manière limitée, pourquoi ne pas envisager, comme certains le réclament d’ailleurs, son extension ? Le partage fonctionne sur une règle de moitié. On peut envisager un partage prorata temporis des prestations qui seraient dès lors servies à proportion du temps vraiment passé par l’enfant dans l’une de ses résidences. On peut aussi envisager un partage qui ne s’opère plus seulement entre les deux foyers des parents séparés, mais, en fonction des éventuelles séparations ultérieures, entre tous les foyers qui conservent un lien avec l’enfant. Les prestations seraient dès lors divisées en trois, quatre ou plus. L’établissement d’un statut du beau-parent, si statut il devait y avoir, doit prosaïquement envisager ces éventualités. Bien entendu, tout ceci serait, d’abord, d’une redoutable complexité à gérer. Mais c’est certainement au droit et aux opérateurs chargés de la gestion des droits de s’adapter à la complexité familiale. Cette prospective du prorata temporis ou de la répartition peut sembler baroque. C’était le cas, il y a moins d’une décennie, de nombre de phénomènes, d’organisations et d’arrangements actuels.
Les idées sur la famille ont bougé, tout en demeurant relativement conflictuelles (et c’est ce dont ont pleinement témoigné, en 2013, les controverses autour du « mariage pour tous »). Le droit social s’est, en tout cas, adapté et densifié. Les organismes gestionnaires (caisses d’allocations familiales en particulier) assimilent ces transformations qui ne cessent de se traduire en textes et en applications informatiques.
On le voit la résidence alternée n’est pas uniquement un sujet de psychologie et de développement de l’enfant ; un thème de polémiques puissantes autour de la famille. C’est aussi un sujet technique important.
Une question cruciale, pour les parents, pour le droit, pour les systèmes d’information, est bien de savoir quelles limites s’imposer. Les frontières sont certes ouvertes mais tout le monde doit se demander si la résidence alternée et, plus largement, les recompositions familiales incarnent véritablement une reconnaissance des droits et des intérêts de l’enfant, ou bien la satisfaction des désirs des parents. Sur cette alternative fondamentale, chacun son opinion.
[1]. Pour une présentation et une analyse, du point de vue juridique, voir le dossier « Résidence alternée », AJ Famille, Dalloz, n° 12, 2011.
[2]. Il s’agit du travail de la sociologue Irène Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Paris, Odile Jacob, 1998 et de celui de la juriste Françoise Dekeuwer-Defossez, Rénover le droit de la famille. Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, Paris, La Documentation française, 1999.
[3]. Cette « loi famille » a connu un parcours parlementaire compliqué, avec adoption en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 juin 2014. Il est, depuis, toujours en jachère au Sénat. Signalons que ce texte a été, lui aussi, inspiré par des rapports préparatoires dont : Irène Théry, Anne-Marie Leroyer (dir.), Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Odile Jacob, 2014.
[4]. Pour une charge contre la résidence alternée, voir Le livre noir de la garde alternée (Dunod, 2006), préfacé par le pédopsychiatre Maurice Berger. Ce Livre noir s’est vu répondre un Livre blanc. Voir Gérard Neyrand, Chantal Zaouche Gaudron (dir.), Le livre blanc de la résidence alternée. Penser la complexité, Toulouse, Érès, 2014. Dans un genre équilibré, mais d’édition plus ancienne, voir Claire Brisset, Catherine Dolto, Gérard Poussin, Pour ou contre la garde alternée ?, Paris, Mordicus, 2010.
[5]. Signalons que, souvent, les pédopsychiatres et psychologues critiques et très critiques font état de ce qu’ils observent dans leurs cabinets. Mais s’ils rendent bien compte de cas problématiques, on ne saurait en tirer des leçons générales sur tous les cas de résidence alternée. Il y a là classiquement ce que Raymond Boudon appelle un « effet de position ». L’échantillon de cas est celui que connaît le professionnel, mais il ne représente pas la population concernée. À ce sujet, crucial, des échantillonnages discutables, voir, sur un autre sujet, Nicolas Gravit, Les surdoués ordinaires, PUF, 2014.
Baisse des inégalités globales, hausse des interrogations nationales.
Recension de Branko Milanovic
« Comment la mondialisation a réduit le fosse? entre les nations», Les Échos, 3 juin 2016
Mesures de la pauvreté, mesures contre la pauvreté
Recension de Martin Ravallion
« La pauvreté, un défi mondial qui reste à relever », Les Échos, 17 juin 2016
http://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/0211028574946-la-pauvrete-un-defi-mondial-qui-reste-a-relever-2007316.php
TÉLÉCHARGER ICI
Rétroprospective et prospective de la protection sociale
Julien Damon
Professeur associé à Sciences po
Conseiller scientifique de l’En3s
2015 aura été une année pleine d’anniversaires, occasions de nombreuses plongées dans le passé et de nombreux regards portés sur l’avenir. Le monde a fêté, notamment, la fin de la deuxième guerre mondiale et la création de l’ONU. En histoire longue, la France aurait pu commémorer le demi-millénaire de Marignan et le tricentenaire de la disparition du Roi Soleil. Les Anglais, eux, auraient pu célébrer le bicentenaire de Waterloo (un 18 juin) et les 150 ans de l’Armée du Salut. Pour les questions sociales françaises, 2015, a été marquée par une célébration des 70 ans des ordonnances créant la sécurité sociale. Cette célébration, sans festivités excessives, était, d’abord, l’occasion d’une mise en perspective, pour se remémorer le chemin parcouru et pour envisager celui qu’il faudrait emprunter et ceux dont il faudrait se méfier. Une telle occasion, un 70ème anniversaire, ne doit pas consister en autocélébration. S’il n’y avait qu’une information pour relativiser la portée de l’événement et relativiser l’exception sociale française, on rappellera simplement qu’en 2015 les Etats-Unis ont célébré les 80 ans de leur « sécurité sociale » (le lancement par l’administration Roosevelt d’un grand programme fédéral de protection sociale). Et la célébration américaine est passée essentiellement par un tweet du Président Obama.
Fêter les 70 ans de la sécurité sociale, en France, ne saurait verser dans l’apologie béate. Et il faut assurément tempérer le culte dont le « modèle de 1945 » fait parfois l’objet[1]. Le moment 1945 peut être alternativement présenté comme la rationalisation de mécanismes anciens ou comme une révolution en termes d’ambition pour un avenir meilleur. De fait, lorsqu’il s’agit d’anniversaire, les deux temps de la rétrospective et de la prospective s’imposent. C’est l’exercice à deux facettes et à deux temps qui sera conduit ici. Plus précisément, on proposera, dans un premier temps, une rapide rétroprospective (regarder aujourd’hui ce qui ce racontait hier sur l’avenir)[2] et, dans un deuxième temps, quelques remarques de prospective (tenter de regarder demain à partir de nos lunettes contemporaines) sur la protection sociale française. Le prisme temporel sera de vingt ans : deux décennies en arrière, quand on s’inquiétait beaucoup, en 1995, et l’on proposait beaucoup au sujet de l’avenir de la protection sociale ; deux décennies en avant, quand on s’inquiète beaucoup, en 2015, au sujet de l’avenir de la protection sociale.
Pour le premier mouvement de cette réflexion, on s’appuiera sur un numéro spécial et double de la revue Droit Social publié à l’occasion du 50ème anniversaire de la sécurité sociale[3].
Cette livraison, dont des contenus ont marqué bien des esprits, titrait de façon neutre sans interrogation, sans exclamation, sans pluriel sur la protection sociale demain. De cet ensemble de contributions, il est loisible de tirer, rétrospectivement, cinq observations sur la façon dont pouvait, alors, se concevoir, la protection sociale en 2015 ou même en 2025. Explicitement, Jean Choussat s’intéressait ainsi à l’hôpital en 2025[4] quand Raoul Briet, lui, faisait porter ses réflexions sur les retraites à l’horizon 2015[5] – aujourd’hui donc – et au delà.
Ce recueil d’observations, d’interrogations, de projections et de suggestions, contient des opinions et orientations différentes, avec des signatures pour la plupart toujours aux responsabilités ou au moins encore à la manœuvre en 2015. La matière rassemblée dans ce numéro double apparaît particulièrement dense, avec, notamment, des développements sur la place des complémentaires, sur la possible sélection croissante des risques, sur une concurrence potentiellement accrue, sur le sujet récurrent des fonds de pension et de la capitalisation, sur les perspectives européennes. On ne saurait, au risque d’être fastidieux, reprendre tous les thèmes. On a donc repris cinq points dont l’ampleur traverse les grandes lignes des débats alors à l’œuvre et, pour une bonne part, toujours en cours, même si sous des angles et formulations différents, plus ou moins.
Ce numéro de Droit social comprend un article introductif, devenu célèbre, de Jean-Jacques Dupreyoux, de rétrospective critique sur la période 1945-1995[6]. Entendant déjà « la colère des dévots », selon ses mots, il critique l’idée même d’une célébration de la sécurité sociale. Celle-ci contient, d’abord, une assurance maladie organisée pour les médecins et non pour les patients (un « ratage monumental »). Elle organise, ensuite, une assurance vieillesse antiredistributive qui voit les ouvriers, à espérance de vie alors inférieure à l’âge de départ à la retraite, cotiser pour les cadres. Elle repose, enfin, sur des cotisations plafonnées qui interdisent une forte solidarité (au sens de redistribution verticale). Et Dupeyroux certes d’exprimer des réserves sur la sécurité sociale mais aussi des craintes quant à sa suppression, ensevelie dans un « libéralisme triomphant ». L’analyse, à plusieurs voix, n’a rien d’univoque idéologiquement. Parole et plume passent à Claude Bébéar qui appelle, dans un tout autre registre, à un changement radical de système. Avec, en particulier, une séparation très nette à opérer entre la solidarité et l’assurance[7]. Autre position : Jean-Michel Belorgey souligne, lui, que la coupure entre solidarité et assurance est artificielle[8]. Pour Bébéar, ne devrait rester comme cotisations sociales à la charge des entreprises que celles concernant les accidents du travail et le chômage. Que dire de ces échanges et propositions, notamment celles d’extraction libérale, 20 ans après leur publication ? La sécurité sociale n’a pas disparu et ne s’est pas transformée dans un sens radicalement plus libéral. C’est même la permanence des débats qui saute aux yeux, plutôt qu’une profonde recomposition de la solidarité. Ainsi, dans un autre article, Pierre Volovitch pose-t-il une question toujours actuelle « faut-il cibler la protection sociale sur ceux qui en ont réellement besoin », la locution « ceux qui en ont réellement besoin » apparaissant entre guillemets[9]. La réponse est alors négative, car toute mise sous condition de ressource induit un moindre soutien à la protection sociale dans son ensemble. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Au fond peu de choses ont été vraiment ciblés. De nouvelles prestations ciblées ont été ajoutées, mais peu de prestations ont véritablement été mises sous condition de ressources, sinon avec cette ruse qu’est la modulation des allocations familiales. En tout cas, ce débat sur la solidarité et les liaisons entre assurance et assistance a toujours de la vigueur. Sans qu’il ait véritablement été tranché dans un sens où dans un autre, tel que ceci pouvait être redouté ou souhaité (c’est selon) en 1995.
Tout, aujourd’hui, est dans le Big Data (le traitement de l’abondance de données) et l’Open Data (l’ouverture et la mise à disposition de données publiques). En 1995, le sujet était déjà, avec d’autres mots, à l’ordre du jour. C’est Pascal Penaud qui s’interroge sur les NTI et leur impact sur les OSS (pour le dire avec des sigles désuets)[10]. Ces NTI ou NTIC de 1995 offrent la possibilité de modifier le service rendu à l’usager, avec de fortes potentialités de modification de l’organisation interne. L’analyse se veut plutôt pessimiste, pour l’avenir d’organismes qui vivent une faible concurrence, avec des pratiques de gestion tayloriennes peu innovantes. Rétrospectivement, on peut trouver ce pessimisme trop prononcé. Historiquement, les caisses ont compté parmi les grands précurseurs de l’informatisation et de l’automatisation. Il s’agit de toujours mieux traiter flux de masse et volumes immenses d’informations. Des cartes perforées à l’Internet, les systèmes d’information se sont constitués, renforcés et adaptés, tant aux évolutions des législations qu’aux attentes toujours plus élevées des populations. De l’époque des super calculateurs à celle des micros ordinateurs et de l’informatique dans les nuages (le cloud), la sécurité sociale a toujours été un foyer d’innovations. Autant qu’une infrastructure physique (avec des personnels et de l’immobilier), elle est une infrastructure numérique. Ses sites Internet comptent parmi les plus fréquentés à l’instar des 110 millions de connexions par an au site de l’assurance maladie (Ameli). Une nouvelle fois, la célébration béate serait ridicule. Il y a plusieurs mondes entre les start-up et la gestion quotidienne des organismes. Pour autant, l’informatisation puis la digitalisation des services de sécurité sociale ont toujours accompagné les mutations de l’institution. En un mot, les OSS ont su digérer les TIC et ce que l’on baptisait la nouvelle économie. Reste qu’ils n’ont peut-être pas pleinement opéré leur mue digitale. On y reviendra quand on en viendra, dans cet article, à la prospective pour 2035.
Le thème de la complexité croissante et de la nécessaire ou impossible (c’est selon) simplification n’est pas neuf. Il fait couler de l’encre, notamment dans Droit social, depuis des décennies. En 1970, déjà, des articles, avec des désaccords techniques de détail, allaient dans le sens d’une nécessaire lutte contre la complexité illégitime et contre-productive[11]. Reprenant et commentant des positions politiques, des rapports administratifs sur la législation sociale, ces textes soulignaient le caractère sisyphéen de l’exercice de simplification et critiquaient l’absence de l’usager de ces débats, alors que la complexité croissante était déjà légitimée comme une adaptation du droit aux particularités. En 1995, certains imaginent que cette complexité peut couler la sécurité sociale, d’autres que la sécurité sociale devra, à l’avenir, s’en accommoder. En 1995, le débat se fait ainsi plus doctrinal, avec deux positions opposées. Etienne Marie pense que le système, apprécié à partir du cas des CAF, va vraiment exploser. Bertand Fragonard estime qu’Etienne Marie fait un « procès sévère » à la complexité des prestations familiales et à ses conséquences[12]. Mais il considère que la complexification est inéluctable surtout quand on veut personnaliser prestations et relations de service. À relire 1995, il n’y a donc pas nécessairement nouveauté au thème de la simplicité. Mais l’intensité de la complexité devient particulièrement problématique[13]. À trois échelles. Tout d’abord, sur un plan doctrinal, la cohérence globale du système de protection sociale échappe. L’aide et l’action sociales, qui étaient appelées à disparaître, se sont étendues et ramifiées. La prévoyance et les complémentaires, appelées elles-aussi, en principe, à s’effacer, ont le vent en poupe. La sécurité sociale elle-même fait l’objet, dans ses branches, ses régimes et ses mécanismes, d’une sophistication extrême. Face à ces mouvements, incessants, même les spécialistes n’ont plus vraiment de vue d’ensemble. Plus graves sont les embarras concrets des opérateurs et gestionnaires (caisses de sécurité sociale et collectivités territoriales aux premiers rangs). Les politiques sociales sont quotidiennement modifiées par une révision permanente de leurs paramètres, ce qui se traduit, de plus en plus délicatement, dans les systèmes d’information. Dévoreuse de moyens et d’énergie, comme une course sans fin, cette complexification continue ne permet plus de gérer à bon droit. Mais, plus graves encore, l’incompréhension et les critiques des destinataires des politiques sociales s’accentuent. Les usagers ne comprennent pas leurs droits que peinent à leur expliquer des techniciens ou conseillers dépassés par la complexité. La simplification s’impose donc à la fois pour dépasser les impasses doctrinales, les limites gestionnaires, les tracas individuels. In fine, deux légitimités fondent aujourd’hui la simplification : une légitimité économique (pour faire mieux, avec sinon moins, du moins probablement pas plus) ; une légitimité démocratique (pour assurer lisibilité, visibilité et efficacité des dépenses sociales).
Déjà en 1995, inquiets de vieillissement et des transformations du travail, les auteurs abordent les nouveaux risques. C’est d’ailleurs le titre de la contribution de Marie-Thérèse Join-Lambert[14]. Celle-ci liste la résurgence des épidémies, le développement de nouvelles formes de chômage ou de non travail, prolongées ou transitoires. Elle écrit qu’avec « le vieillissement se profile l’immense problème de la dépendance ». Sur le plan épidémique, elle pense au Sida mais nous devons penser, pour la période actuelle, à Chikungunya ou Ebola. Enfin elle souligne l’immense problème de l’insertion professionnelle des jeunes, avec l’allongement de la période d’accès à la stabilisation professionnelle. Aujourd’hui on voit avec la jeunesse – et avec un âge moyen de 29 ans lors de la signature du premier CDI – un nouvel âge de la vie, voire un nouveau risque. D’où, entre autres, l’intérêt marqué, autour de 2015, pour les logiques dites d’investissement social. La question posée est de savoir comment délimiter le périmètre de l’Etat-providence dans des sociétés post-industrielles vieillissantes. Alors que l’avènement de l’économie post-industrielle a remis en cause les compromis qui ont porté la croissance des Etats-providence, les grandes évolutions récentes (entrée des femmes sur le marché du travail, vieillissement de la population, transformations des inégalités, révolution numérique) appelleraient de nouvelles interventions sociales. Ce thème de l’investissement social, pour une protection sociale adaptée aux « nouveaux » risques et plus favorable aux jeunes, n’était pas ainsi labellisé en 1995. Mais l’idée, au fond, y était[15].
Le cinquième point qui retient l’attention, d’une relecture de 1995, procède de la gouvernance de la protection sociale. Gérard Adam décrit, en 1995, les limites et difficultés du paritarisme[16]. Perte de légitimité, divergences syndicales, collusion de quelques-uns avec quelques autres, et évolution des modes de financement appellent des révisions. Si l’écriture et les chiffres peuvent, à la relecture, sembler datée, les constats, parfois vifs, sur « les limites d’un concept trompeur » conservent toute leur actualité en 2015. Au-delà du seul paritarisme, Rolande Ruellan pose une question, en 1995, « Qui est responsable de la sécurité sociale ? », qui se repose assurément en 2015 et qui se posera certainement encore longtemps[17]. Elle souligne les ambiguïtés de la répartition des pouvoirs, le caractère parfois conflictuel de la mise en œuvre de ces pouvoirs. Elle envisage – ce qui sera pleinement établi – la responsabilisation du Parlement et l’établissement de nouvelles relations avec l’État. Certes dit-elle « le débat sur les responsabilités en matière de sécurité sociale est, il faut l’admettre, un débat d’initiés auquel les Français n’attachent que peu d’intérêt ». Et c’est pourtant bien là que de puissantes révisions, annoncées dans cet important numéro de Droit social, ont été introduites en particulier à partir du contenu du Plan Juppé. Ce plan, de novembre 1995, représente une tentative de réforme globale de la sécurité sociale dans son organisation et sa gouvernance (même si le mot « gouvernance » avait, à l’époque, moins de succès qu’aujourd’hui). Les changements envisagés ont recueilli des critiques fortes et ont conduit à l’une des plus grandes grèves de l’histoire, avec notamment une très forte mobilisation des assurés des régimes spéciaux. Bien que discutées, nombres des évolutions introduites dans le cadre de ce plan ont été depuis préservées voire confortées. Tel est le cas du nouvel équilibre entre les partenaires sociaux et les directeurs gérant les organismes, la création des lois de financement, le pilotage renforcé des dépenses d’assurance maladie. Toutes ces réformes sont, dans leurs attendus comme dans leurs conséquences, diversement appréciées, en fonction des convictions et visions de ceux qui en analysent les objectifs, les instruments et les résultats. En matière de sécurité sociale, que cela concerne les dépenses, les recettes et l’organisation, les réformes sont d’abord critiquées, envisagées comme des régressions, puis souvent appliquées dans la durée.
Ce petit parcours rétroprospectif permet de souligner bien plus de permanences que de ruptures. Rien d’étonnant diront certainement les tenants de la thèse dite de la « dépendance au sentier » qui estiment que lorsqu’un sillon a commencé à être creusé, il est difficile d’en changer[18]. Est-ce pour autant dire que 2015 était écrite en 1995 ? Assurément non, car comme la formule célèbre le dit bien l’avenir n’est écrit nulle part. Surtout, derrière l’impression de permanences, les transformations et les progrès sont substantiels. Ce que dénotent les propos d’experts en 1995, c’est une connaissance fine des inerties et des défis. Et il faut espérer qu’en 2035, quand seront relues les lignes prospectives à venir, sur quelques remarques prospectives autour de la protection sociale à cet horizon, les lecteurs auront une impression similaire.
Réfléchir à l’avenir peut désormais s’opérer de façon conventionnelle et outillée, dans le cadre des divers Hauts Conseils qui se sont successivement créés, ou bien dans le cadre de réflexions prospectives menées soit dans différentes branches[19] ou bien plus collectivement[20]. On peut également consulter une documentation très détaillée de projections, d’objectifs, de suivis de gestion dans le cadre des annexes au projet de LFSS présentant des « programmes de qualité et d’efficience », portant sur les grandes politiques de sécurité sociale[21]. Dans une certaine mesure, la protection sociale est devenue très familière de la prospective et en fait une activité en quelque sorte permanente. En tout état de cause les démarches, les lieux d’échange, les capacités techniques se sont multipliés depuis 1995. Une orientation complémentaire est de passer par un peu d’imagination et de provocation. Le terme actuellement en vogue est « disruption ». Quelles sont donc les innovations, transformations et contraintes qui pourraient, à l’horizon d’une vingtaine d’années, transformer substantiellement la protection sociale ?
En 2015, l’heure aura bien été à l’anniversaire, sans commémoration ridicule. L’heure aura également été à la révolution, notamment sur le plan numérique. Ce mouvement pouvant potentiellement, si l’on en croit ses prophètes, entraîner de profondes modifications dans tous les domaines[22]. Reprenant le vocable de révolution pour trois éléments (numérique, idéologique, territorial), on balisera trois domaines dans lesquels de puissantes modifications pourraient voir le jour, qu’elles soient, une nouvelle fois, souhaitées ou redoutées. Naturellement, les tendances lourdes, en particulier démographiques, sont connues (vieillissement de la population, transformation des familles, modifications des aspirations) tout comme les écueils financiers face aux déficits et à l’endettement. Plutôt que de revenir sur chacune de ces tendances et perspectives, par ailleurs bien détaillées[23], on préfère tenter l’originalité.
Le tsunami numérique pulvérisera les formes de travail et les modes de vie, en particulier, des classes moyennes. Cette prophétie se psalmodie à longueur de colloques, d’essais et de rapports. Comme tout serait en voie d’« uberisation » (le néologisme date de 2015), la protection sociale serait en voie de passer à la casserole de la « disruption » radicale (comme aiment le dire les protagonistes des débats sur le numérique). En trois mots, l’automatisation, la robotisation et la numérisation croissantes des sociétés contemporaines, bouleverseraient intégralement la protection sociale. La révolution numérique nourrirait une révolution digitale, dans la relation de service, et une révolution salariale dans les formes d’emploi[24]. L’ensemble pèsera, incontestablement, dans les décennies à venir.
La révolution numérique a, il est vrai, intégralement bouleversé des industries comme celles de la communication, de la finance ou de la mobilité. Elle transforme profondément, dans tous les secteurs, la relation de service. Le travail de production de la sécurité sociale (la gestion des droits et dossiers) se dématérialise lui aussi. Toujours moins de papiers, toujours plus de données.
Plus profondément, la transition numérique peut, potentiellement ou brutalement, avoir des impacts considérables sur l’édifice même de la protection sociale, et singulièrement sur les risques de sécurité sociale et les manières de les gérer. Sur le plan des productions, la sécurité sociale, conçue pour répondre aux besoins de la société industrielle de masse du 20ème siècle, apparaît remise en cause par l’avènement d’une société plus individuelle, plus fragmentée, où comptent davantage les petites structures, la fluidité des organisations, les services personnalisés. Techniquement, le numérique diminue les coûts et ouvre des opportunités très fortes, à la médecine. Celle-ci n’est déjà plus uniquement un colloque singulier entre un patient et un traitant, mais une relation à trois avec un Internet généralisé qui transforme la production des diagnostics.
Le numérique, associé au génie génétique, introduit de nouvelles capacités prédictives, notamment en santé. Le sujet est connu depuis des années, en ce qu’il change la nature même des risques, avec des aléas qui deviennent assurables individuellement. C’est tout le principe de solidarité nationale qui est mis à mal par une sécurité sociale plus prédictive[25]. En réponse à cette perspective de déchirure dans la solidarité, la sécurité sociale s’appuie sur les capacités préventives qu’autorise le numérique (communiquer avec les patients, informer les familles, associer les retraités). Au sujet donc de ses productions et réalisations, la sécurité sociale devient plus préventive, plus prédictive, plus personnalisée. Et ce n’est pas un mince enjeu que de faire cohabiter ces mutations avec un principe, certes adaptable, de solidarité nationale qui visait d’abord la réparation, qui se voulait plus réactif que prédictif et qui assurait une relation plutôt impersonnelle.
À ces immenses défis sur le plan des produits, s’ajoutent ceux, plus immédiatement perceptibles, sur les services. La perspective, totalement encouragée par les pouvoirs publics, relève de la dématérialisation. En l’espèce, les branches maladie, retraite, recouvrement, famille sont évaluées sur leurs progrès pour se trouver, déjà aujourd’hui, à plus de 90 % de flux dématérialisés de paiements des cotisations, de déclarations sociales, de feuilles de soins électroniques. Plus d’un milliard de feuilles d’assurance maladie traitées chaque année (soit 1 800 par minute) passaient autrefois par le courrier et sont maintenant à 90 % dématérialisées. L’assurance maladie était autrefois le premier client d’une Poste qui, face à la révolution numérique, doit trouver de nouvelles activités.
Une relation de service intégralement dématérialisée soulève la question de l’organisation des réseaux et guichets des organismes de sécurité sociale. Une partie croissante des activités pouvant être télétravaillées, la localisation même des caisses est une question. Quelle part de services physiques laisser ouverts ? Jusqu’où aller dans la numérisation de la relation ? Ces importantes interrogations intéressent d’abord les personnes qui se trouvent concernées par la fracture numérique. Si celle-ci n’est peut-être pas aussi profonde qu’on l’entend dire parfois, elle est extrêmement problématique pour les individus affectés. Ces interrogations intéressent aussi le gestionnaire de la sécurité sociale. Quel équilibre trouver entre, d’une part, des usines de traitement (que rien n’attache fondamentalement aux territoires) et, d’autre part, une relation humaine et une écoute personnalisée (qui ne peuvent qu’être territorialisées) ?
De façon plus prospective, une autre dimension de la révolution numérique, la dimension participative ou collaborative, apporte aussi son lot de potentiels renversements. Des usagers plus participatifs s’investissent dans la gestion directe des services qui les concernent (ne serait-ce qu’en renseignant et suivant leurs dossiers). Le système devient, comme ceci était souhaité en 1945, directement géré par les personnes concernées. Mais quid, dès lors, du paritarisme et des représentants élus ou désignés quand le service est directement géré par les usagers ? Si le numérique apporte bien de la nouveauté, il permet aussi de renouer avec des traditions anciennes. La sécurité sociale 2.0 peut reposer sur un mutualisme 2.0, des individus, des ménages, des groupes de population coopérant en s’informant, en s’entraidant (par exemple dans l’accueil des enfants ou des personnes âgées dépendantes), sans autre nécessité que des plateformes de mise en relation. Ce sont des relations de pair à pair (P2P en anglais numérique) qui s’étendent. D’où un néologisme possible, celui du « pairitarisme » venant remplacer le paritarisme. S’il y a probablement de l’utopie ou du cauchemar (là encore c’est selon) dans l’énoncé de ces perspectives, elles doivent être saisies avec le plus grand sérieux. Pour les organismes et branches de la sécurité sociale, en collaboration ou en compétition avec d’autres pans de la protection sociale (par exemple Pôle emploi ou les complémentaires), il y a là une question majeure de survie. Celui qui saura le mieux gérer les données et offrir le service de meilleure qualité incarnera, sous ce nom ou sous un autre, la sécurité sociale 2.0.
Une crainte régulièrement répétée, en particulier par les opérateurs du système de protection sociale, tient du risque de « libéralisation » du système. Il faut entendre par là, principalement, la privatisation et la mise en concurrence de l’ensemble ou de certains pans de la protection sociale. D’essence bismarckienne et assurancielle, le système français oscille aujourd’hui entre les deux cohérences libérale et social-démocrate. La révolution libérale, que certains estiment déjà passées, que d’autres espèrent encore, passe, entre autres manifestations concrètes, par une centration sur la lutte contre la pauvreté, en mettant de côté, relativement, la lutte contre les inégalités. Des perspectives radicales de simplification, comme par exemple à partir d’une prestation unique simplifiant mais avec de nombreux perdants ou d’une prestation universelle remplaçant toutes les autres, nourrissent également l’horizon libéral[26]. Celui-ci s’incarne, plus concrètement, à l’européenne pourrait-on dire, avec la perspective d’une entrée en concurrence systématique des équipements et services sociaux. Mais, de fait, la révolution libérale n’est en rien achevée et ce sont les prochaines années qui diront ce qu’il en sera et si les propositions libérales françaises seront entendues[27]. Dans une version extrême, cette libéralisation de la protection sociale passe par la concurrence totale entre les régimes et les systèmes, avec liberté d’affiliation ou non. C’est une marchandisation nouvelle du travail, avec d’autres formes de garanties mais sans protection collective obligatoire. Du côté social-démocrate, c’est la perspective dite de l’investissement social, déjà évoquée, qui est mise en avant. Est-il aujourd’hui possible de trouver les nouveaux compromis, les instruments et les visées qui permettraient de redéfinir les missions de l’Etat providence au XXIe siècle ? C’est toute l’ambition des réflexions et propositions en termes d’investissement social. Celles-ci sont vaillamment promues, en France, par le chercheur Bruno Palier[28]. L’idée procède d’un constat martelé : les systèmes de protection sociale, en particulier en Europe, avec leurs différences, se sont constitués non pas pour prévenir les problèmes sociaux, mais plutôt pour compenser les charges liées à leurs conséquences. C’est donc une réforme en profondeur qu’encouragent les partisans de ce mouvement vers un Etat-providence centré sur le capital humain, la jeunesse et l’enfance. Il y a là non pas une révision paramétrique gestionnaire établissant de nouvelles économies, mais une volonté de réaménager et réorganiser l’Etat-providence de façon à le faire sortir de la crise « par le haut »[29]. Ce qui est incontestable, et ce dans les constats des partisans de chacune des deux perspectives, libérale et social-démocrate, relève de l’hybridation des matrices idéologiques et des logiques (entre assurance et assistance) et de la dualisation, plus ou moins affirmée, entre bien protégés et mal protégés, du système français. D’où, selon, les révolutionnaires libéraux et les révolutionnaires socio-démocrates, une nécessité de réformer l’ensemble plutôt que ses seuls paramètres. Une autre option, loin d’appels jugés utopiques à la refonte, est de conserver les fondements de l’efficacité d’un système, tout en pilotant bien plus strictement les dépenses[30]. Car, oui, le système, auquel tiennent les Français, atteint nombre de ses objectifs : limitation des inégalités, bon état de santé, capacités de résistance aux chocs exogènes, relativement haut niveau de fécondité, etc. Il rencontre également de graves difficultés : déficits chroniques, « nouveaux » risques mal couverts (monoparentalité, dépendance, pauvreté), incapacité à s’accorder sur les directions que doivent prendre les réformes. Plutôt que des révolutions systémiques, des révisions paramétriques pourraient accompagner, sur les vingt ans qui viennent, l’adaptation de la protection sociale à son temps. D’une gestion plus volontariste du risque en assurance maladie à la poursuite de la réforme des retraites, l’idée force pour adapter la protection sociale est de dépenser mieux. Pas forcément moins, mais en se concentrant sur les besoins sociaux mal pris en charge et en gérant plus efficacement (ce qui n’est pas simple). À noter, aussi : la perspective d’expansion et d’extension de la protection sociale, n’est pas à rejeter, notamment quand il s’agit de prendre en compte les risques écologiques. Face à de nouveaux risques collectifs écologiques dont la responsabilité et l’assurabilité sont aussi humaines qu’elles le sont pour les risques sociaux, il faut, dans cette perspective, étendre l’État-providence plutôt que le restreindre. L’ambition est de mettre en œuvre un « État social-écologique », autour d’un « contrat social-écologique »[31]. On le voit, sur le plan idéologique, il est difficile de dessiner ce qui se passera d’ici 2035 car bien des constructions différentes, en concurrence, mais chacune avec leur cohérence, sont disponibles sur le marché des idées.
Troisième révolution que nous souhaitons aborder ici, la révolution métropolitaine. Le thème n’était aucunement entrevu en 1995. Il l’est aujourd’hui, dans le monde entier, au sujet de l’affirmation de la puissance politique et économique des grandes métropoles[32]. De manière prospective, certains diront spéculative, on invite à traiter de cette révolution métropolitaine au regard des politiques sociales. Non pas pour souhaiter ou critiquer, mais pour réfléchir et envisager l’avenir avec des yeux relativement nouveaux.
Avec la décentralisation, on a vu se mettre en place, à côté de l’Etat-providence, des « départements-providence », eux-mêmes remis en question par une recentralisation, puis l’arrivée des métropoles[33]. Le conseil général s’est, en effet, vu confier, avec la vague II de la décentralisation, des responsabilités accrues sur le plan des politiques sociales. Rappelons que le département était, à l’aube de cette décennie 2000, appelé à disparaître. Mais, par la magie des couloirs et des textes, il est apparu comme le grand vainqueur de l’Acte II de la décentralisation. Désigné comme « chef de file » de l’action sociale, le département s’est imposé. Alors que les dépenses sociales départementales (30 milliards d’euros) représentent moins de 5 % du montant total des dépenses sociales, il demeure à bien des égards fondé de le qualifier de providence. C’est, en effet, à lui qu’échoient une grande partie de l’assistance et la responsabilité d’adapter les politiques aux territoires.
2014 : nouveau coup de semonce. Le département, du moins une bonne part de sa substance et de son contenu, ont été à nouveau appelés à disparaître, pour renaître après le passage au Parlement d’un projet de loi très disputé. Parallèlement, l’événement le plus marquant est bien celui de l’affirmation des métropoles, en tant que construction juridique bien française.
Les villes françaises ainsi labellisées incarnent des territoires bien plus larges que leur seul ressort administratif. Avec une capacité élevée à capter et gérer des flux (de touristes comme de denrées et données), elles rayonnent sur des aires géographiques importantes. Classées selon leurs prix, leur qualité de vie, leurs infrastructures, elles sont comparées dans le cadre de multiples classements, dans les deux contextes hexagonal et international. Le défi pour elles est tout autant celui de l’attractivité que de la cohésion sociale.
De fait, des politiques sociales de format et de contenu plus métropolitains que nationaux sont partout envisageables dans le monde. En France, la perspective n’est pas encore claire. Mais le cas lyonnais, qui voit fusionner une communauté urbaine et une partie de conseil général, doit inspirer. Il ne s’agit plus seulement, à Lyon, d’une nouvelle forme de coopération intercommunale. La fusion d’une grande partie du Conseil Général du Rhône et du Grand Lyon est, potentiellement, un big bang local à répercussions nationales. Il n’y aurait pas seulement ici nouvelle étape du processus français de décentralisation. Il y a nouveau départ des grandes villes.
Selon les termes de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014, « la métropole de Lyon forme un espace de solidarité ». Ces premiers mots, dans la définition juridique de la métropole de Lyon, ne peuvent que retenir l’attention si on se préoccupe de questions et de politiques sociales. Sur les plans de l’aide et de l’action sociales, la métropole de Lyon, depuis le 1er janvier 2015, a opéré la fusion/acquisition (si on peut se permettre la comparaison), de plusieurs organisations. Le périmètre de ce qui est strictement réuni dans une unique entité est connu. Le périmètre de l’ensemble des institutions concernées est plus large : CCAS, services de Caisses de Sécurité Sociales, opérateurs associatifs, offices HLM. Ces institutions ainsi que les politiques qu’elles mènent et celles auxquelles elles participent peuvent connaître de profondes révisions, choisies ou subies, dans les suites de la création de la métropole de Lyon.
Les métropoles françaises, à l’instar de la métropole lyonnaise, deviennent des collectivités territoriales de plein exercice, aux compétences sociales étendues. Il n’est pas certain que l’expression « métropole providence » soit vraiment judicieuse. Le vocabulaire européen valorise l’idée de métropoles « inclusives », mais sans donner de bases juridiques à la désignation. La période est, en tout cas, à la construction concrète, à partir de ce premier exemple lyonnais fait de volontarisme et de prospective[34], de ces nouvelles collectivités publiques en charge d’une partie substantielle des politiques sociales. La question nationale qui se traite avec les débats contemporains sur la réforme territoriale est de savoir si la France est en train de vivre un Acte III de la décentralisation (avec tout de même quelques parties de recentralisation) ou un Acte I du renforcement des métropoles. La dynamique mondiale et le dynamisme lyonnais montrent que cette grande comédie nationale, à plusieurs actes, n’a plus forcément grande raison. Les métropoles s’affirment organiquement et dans la vie des gens. Il est probablement aussi vain de vouloir empêcher ce mouvement que d’en rendre les traductions locales toutes obligatoires sur une même formule décidée au niveau national. Ce qui – soit dit en passant – laisse de la place aux départements…
Conclusion – Du réalisme, du volontarisme et pas de défaitisme face au futur
En 1995, le monde était bien moins connecté : le téléphone portable apparaissait, mais le smartphone était inimaginable. Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, l’accès au téléphone portable est bien plus étendu que l’accès à l’eau potable. Même dans les pays les plus pauvres la révolution numérique est à l’œuvre. En 1995, la protection sociale française était moins contractualisée, moins régulée, moins étatisée. Chacun choisira son qualificatif. En tout cas, il y a 20 ans, même si précisément elles étaient en phase d’élaboration, pas encore de COG ni de LFSS. Surtout, il y a 20 ans la protection sociale était moins étendue. La dynamique d’universalisation, auparavant on disait généralisation, nourrit l’expansion de la protection sociale. Dans le monde tout d’abord, où l’on vise des socles de protection sociale[35], voire avec les « objectifs du développement durable » (ODD) que la communauté internationale a voté en 2015, une couverture maladie universelle à l’échelle mondiale. Il y a 20 ans, en France, la CMU n’était pas née.
Tout ceci rend, au fond, modeste quant à la prédictibilité des dynamiques. Bien entendu l’essentiel de la prospective est de ne pas uniquement prolonger les tendances à l’œuvre[36] et d’imaginer des ruptures, de repérer ce que les prospectivistes patentés aiment baptiser les « faits porteurs d’avenir ». Ils aiment aussi faire des citations. On lit ainsi souvent des formules attribuées au général de Gaulle, à Churchill ou Saint Exupéry selon qui l’avenir ce n’est pas ce qui se passera, c’est ce que nous ferons. Et c’est précisément le titre de l’article signé en 1995 par le Président de la CNAMTS : « l’assurance maladie de demain dépend des choix que nous ferons aujourd’hui »[37]. L’affirmation reste valable et le restera certainement longtemps. Mais l’ultime remarque est à trouver dans la conclusion de Raoul Briet, dans ce qu’il a appelé ses « réflexions sur l’au-delà » (ses réflexions sur les retraites pour 2015 et au-delà)[38] : est-il judicieux de raisonner aujourd’hui avec les notions et conceptions qui datent parfois d’hier pour prévoir l’après-demain ? Cette ultime interrogation est laissée à la sagacité du lecteur.
[1]. On s’autorise à renvoyer ici aux développements, proposés d’ailleurs à l’occasion de cet anniversaire des 70 ans, dans Julien Damon, Benjamin Ferras, La sécurité sociale, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2015.
[2]. Ce type d’exercice, à distinguer de l’uchronie, chère à Bernard Cazes (voir, plus globalement, son Histoire des futurs. Les figures de l’avenir de saint Augustin au XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, coll. « Prospective », 2008, 2ème éd.), a acquis ses lettres de noblesse avec l’ouvrage de Jacques Lesourne, Ces avenirs qui n’ont pas eu lieu. Une relecture du XXème siècle européen, Paris, Odile Jacob, 2001. Pour un exercice de rétroprospective autour de la famille et de la politique familiale, voir Julien Damon, « Les métamorphoses de la famille. Rétroprospective, tendances et perspectives », Futuribles, n° 396, 2013, pp. 5-21
[3]. Jean-Jacques Dupeyroux (dir.), « La protection sociale demain », Droit social, n° 9-10, septembre-octobre 1995. On se reportera largement à ces contributions mais aussi à d’autres articles de la revue, parus avant et ensuite. Ce privilège accordé ici à une revue naît du caractère incontestable de jalon à attribuer au numéro spécial de 1995. Il va sans dire que nombre d’autres revues, la Revue de droit sanitaire et social en premier lieu, sont tout aussi éminentes !
[4]. Jean Choussat, « L’hôpital en 2025 », Droit social, n° 9-10, 1995, pp. 792-796.
[5]. Raoul Briet, « Retraites : réflexions sur 2015 et au delà », Droit social, n° 9-10, 1995, pp. 797-800.
[6]. Jean-Jacques Dupeyroux, « 1945-1995 : quelle solidarité ? », Droit social, n° 9-10, 1995, pp. 713-715.
[7]. Claude Bébéar, « Pour un changement radical de système », Droit social, n° 9-10, 1995, pp. 734-738.
[8] . Jean-Michel Belorgey, « Logique de l’assurance, logique de la solidarité », Droit social, n° 9-10, 1995, pp. 731-733.
[9]. Pierre Volovitch, « Faut-il cibler la protection sociale sur ‘ceux qui en ont réellement besoin’ », Droit social, n° 9-10, 1995, pp. 739-743.
[10]. Pascal Penaud, « Nouvelles technologies de l’information : quel impact sur les organismes de sécurité sociale ? », Droit social, n° 9-10, 1995, pp. 769-771.
[11]. Pour deux occurrences, voir J. Moitrier, « La complexité comme mode de gestion de notre système de sécurité sociale », Droit Social, n° 5, 1971, pp. 355-364 ; M. Souveton, « Simplifications administratives : mythes et réalités », Droit Social, n° 6, 1971, pp. 409-419.
[12]. Etienne Marie, « Sur la complexité : l’exemple des règles gérées par les caisses d’allocations familiales », Droit social, 1995, pp. 760-764) ; Bertrand Fragonard, « Quelques réflexions à propos de la complexité du système des prestations familiales », Droit social, 1995, pp. 765-768). Signalons l’admirable formule de Jean-Jacques Dupeyroux dans sa contribution venant introduire ces deux articles (« Pour ouvrir le débat sur la complexité », Droit social, 1995, 758-759), « plus la détresse est grande, plus le système est opaque ».
[13]. Pour quelques autres jalons, ensuite, dans ce débat essentiel, cf. Etienne Marie, « La simplification des règles de droit », Droit social, n° 4, 2002, pp. 379-390 ; Michel Borgetto, « Le droit de la protection sociale dans tous ses états : la clarification nécessaire, Droit social, n° 6, 2003, p. 646-648. On lira aussi le rapport, plus général, du Conseil d’État, Sécurité juridique et complexité du droit, Paris, La Documentation française, 2006. On lira, encore, les travaux et suggestions de Jacques Bichot, « France : l’inflation législative et réglementaire. Les planches à décrets sont-elles combustibles ? », Futuribles, n° 330, 2007, pp. 5-24, Le labyrinthe. Compliquer pour régner, Les Belles Lettres, 2015. Dans ce dernier ouvrage, Bichot écrit que la complication permet aux bureaucrates (publics ou privés) de bien vivre, aux dépens de ceux qu’ils doivent servir. L’ensemble est une peinture détaillée et argumentée de la « minocratie » : le gouvernement par la dissimulation et la complication. Relevons que la peur de la complexité et l’aspiration au « choc de simplification » ne se trouvent pas qu’en France. Voir ce qu’en dit un conseiller influent du Président Obama, Cass R. Sunstein, Simpler. The Future of Government, Simon & Schuster, 2013.
[14]. Marie-Thérèse Join-Lambert, « Les ‘nouveaux risques’ », Droit social, 1995, pp. 779-784. Et au-delà du traitement des risques nouveaux ou anciens, pour une analyse de l’évolution même du « risque social », voir, notamment, Jean-Pierre Chauchard, « Les nécessaires mutations de l’État-providence : du risque social à l’émergence d’un droit-besoin », Droit social, n° 2, 2012, pp. 135-139.
[15]. Pour une tentative de clarification sur les sources et les formes de l’investissement social, voir Julien Damon, « L’investissement social : contenu et portée d’une notion en vogue », Revue de droit sanitaire et social, n° 4, 2015, pp. 722-733
[16]. Gérard Adam, « Quelques évidences sur le paritarisme », Droit social, 1995, pp. 744-747.
[17]. Rolande Ruellan, « Qui est responsable ? », Droit social, 1995, pp. 718-722. Une lecture à compléter, pour actualiser, par Michel Borgetto (dir.), Qui gouverne le social ?, Paris, Dalloz, 2008
[18]. Voir Bruno Palier, Giuliano Bonoli, « Phénomènes de Path Dependence et réformes des systèmes de protection sociale », Revue française de science politique, vol. 49, n° 3, 1999, pp. 399-
[19]. Voir, par exemple, les travaux de la branche famille en 2005 sur l’avenir de la protection sociale en 2015 : « Prospective 2015. Politiques familiales et sociales », Informations sociales, n° 128, 2005. Voir également les travaux menés en 2015 sur la politique familiale en 2025, à paraître dans Information sociales.
[20]. Voir, par exemple, les actes du colloque « Quel avenir pour la Protection sociale française ? », En3s/ENA, novembre 2012.
[21]. L’ensemble est disponible sur www.securite-sociale.fr
[22]. Voir les travaux et analyses, particulièrement vivifiantes, de The Family. www.thefamily.co. Voir aussi Nicolas Colin, Henri Verdier, L’âge de la multitude. Entreprendre et gouverner après la révolution numérique, Paris, Armand Colin, 2012. Voir aussi l’analyse approfondie de Sandrine Cassini et Philippe Escande, Bienvenue dans le capitalisme 3.0, Paris, Albin Michel, 2015
[23]. Voir, entre autres, les travaux du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFi-PS).
[24]. Alain Supiot, en 1995, s’intéressait déjà, dans sa contribution au dossier de Droit social aux évolutions du salariat : « L’avenir d’un vieux couple », Droit social, 1995, pp. 823-831. Il signalait des signes de décomposition du statut salarial. Pour mesurer les impacts des TIC, aujourd’hui (en 2015) et demain, sur les deux mondes du travail et de la protection sociale il faut lire les chroniques de Jean-Emmanuel Ray dans la revue.
[25]. C’était là un point central de l’analyse de Pierre Rosanvallon, en 1995, non pas dans Droit Social, mais dans La nouvelle question sociale, Paris, Seuil, 1995.
[26]. Voir, en ce sens, les analyses et propositions libertariennes et conservatrices, dans le contexte américain, de Charles Murray, In Our Hands. A Plan to Replace the Welfare State, Washington, AEI Press, 2006.
[27]. On pense, par exemple, à Claude Bébéar (dir.), Réformer par temps de crise, Paris, Les Belles Lettres, 2012 ; Arnaud Robinet, Jacques Bichot, La mort de l’État providence. Vive les assurances sociales !, Paris, Les Belles Lettres, 2013.
[28]. Voir l’ensemble de son œuvre depuis Bruno Palier, Réformer la Sécurité sociale. Les interventions gouvernementales en matière de protection sociale depuis 1945. La France en perspective comparative, Thèse de Sciences Politiques, Paris, IEP de Paris, 1999. Pour une version contenant de nombreuses propositions, voir Bernard Gazier, Bruno Palier, Hélène Périvier, Refonder le système de protection sociale, Presses de Sciences po, 2014.
[29]. Voir les remarques finales du chapitre « Le développement des systèmes de sécurité sociale » dans Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de la sécurité sociale, Paris, Dalloz, 2015.
[30]. Bertrand Fragonard, Vive la protection sociale !, Paris, Odile Jacob, 2012.
[31]. Voir Éloi Laurent, Le bel avenir de l’État Providence, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2014.
[32]. Voir Julien Damon, « Vers un monde métropolitain ? », Futuribles, n° 408, 2015, pp. 39-47.
[33]. Voir Robert Lafore, « La décentralisation de l’action sociale. L’irrésistible ascension du ‘département providence’ », Revue française des affaires sociales, 2004, n° 4, pp. 17-34, « Département : une victoire à la Pyrrhus ? », Actualités sociales hebdomadaires, n° 2931, 30 octobre 2015.
[34]. À ce titre, voir Millénaire 3, le centre de ressources prospectives territoriales, sociales et urbaines du Grand Lyon. www.millenaire3.com
[35]. Voir Martin Hirsch, Sécu : objectif monde. Le défi universel de la protection sociale, Paris, Stock, 2011.
[36]. Reste que la description d’un système qui serait mécaniquement issu des tendances actuellement à l’œuvre, et notamment en raison des problématiques économiques, a toute son importance. Voir ainsi le travail original et percutant de Didier Tabuteau, 2025 : l’odyssée de la Sécu, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2008. Le tableau de Tabuteau pour 2025, établi à la fin des années 2000, n’est pas reluisant. En 2025, les dépenses de santé représentent plus de 14 % du PIB, contre environ 10 % aujourd’hui. Le quart de la population n’est pas couvert ou l’est très mal. Depuis une réforme, qu’il imagine en 2008 pour 2013, la médecine de ville est duale : les « cabinets solidaires » appliquent les tarifs négociés avec la Sécu, les « cabinets sélectifs » pratiquent des honoraires libres. Entièrement privatisés en 2018, des Réseaux hospitaliers régionaux (RHR) assurent les soins les plus lourds. Les laboratoires pharmaceutiques gèrent les traitements individuels des patients, préparés notamment à partir de leurs cellules…
[37]. Jean-Claude Malet, « L’assurance maladie de demain dépend des choix que nous ferons aujourd’hui », Droit social, 1995, pp. 785-788.
[38]. Raoul Briet, « Retraites : réflexions sur 2015 et au delà », Droit social, n° 9-10, 1995, pp. 797-800.
Formation professionnelle : une dotation individuelle de 40 000 €
Julien Damon
Professeur associé à Sciences Po
La formation professionnelle représente, dans son inouïe complexité, environ 30 milliards d’euros de dépenses annuelles. La population active approche les 30 millions de personnes. Il en ressort simplement que la formation professionnelle représente 1 000 € par an par actif. Naturellement cette division est éminemment discutable, d’abord pour ce que l’on porte au dénominateur. On pourrait, dans une vision extensive, prendre toutes les personnes d’âge actif, ou, dans une vision restrictive, toutes les personnes nécessitant véritablement une formation (ce qui est difficile à évaluer). La division est également discutable pour ce qui relève de son numérateur. Le périmètre de la formation professionnelle est en effet large, rassemblant des activités, des opérateurs, et des dépenses d’ordre différent. Ces précautions à l’esprit, la division (que l’on peut aussi appeler un rapport ou un ratio) a bien un sens.
1 000 € par an, c’est, sur une quarantaine d’années d’activité, 40 000 €. Bien entendu un tel montant serait à actualiser finement. Cependant c’est l’ordre de grandeur qui importe ici. Et il apparaît clairement comme particulièrement important, même si on pourrait exhiber des sommes plus conséquentes encore dans les pays nordiques notamment
Pratiquement, la formation professionnelle, à la française, se caractérise par un montage particulièrement sophistiqué où se mêlent, sans grande cohérence, priorités variées, tuyauteries financières alambiquées, et une invraisemblable galaxie d’opérateurs, de régulateurs et de contrôleurs. Tout le monde s’accorde sur cette trop grande complexité, incarnée par une floraison de sigles obscurs, et sur les faibles performances d’un système, au moins pour ce qui relève des personnes éloignées de l’emploi. Par ailleurs, personne ne saurait contester un principe mis depuis des années en avant pour réformer le système : centrer le dispositif sur la personne.
Aujourd’hui nombre de propositions d’ajustements paramétriques sont discutées pour réformer la formation professionnelle. Une suggestion de refondation structurelle, intégralement centrée sur la personne, peut être avancée. Elle consiste à doter chaque individu de 40 000 €. Une telle dotation peut être organisée selon trois logiques. Il peut s’agir d’un capital versé, par exemple, à la majorité d’un individu, les affectations des dépenses pouvant être ciblées sur de la formation. Il peut, également, s’agir de chèques formation tirés, tout au long de la vie active, sur un compte mutualisé à l’échelle nationale. Il peut, encore, s’agir d’un compte formation, alimenté par ce capital et, le cas échéant, par des abondements des entreprises, l’ensemble étant intégré dans le cadre du Compte personnel d’activité (CPA) naissant. Quel que soit le support retenu, il est possible de faire monter progressivement en charge le nouveau programme, ceci afin de ne pas faire de perdants liés à la transition entre deux systèmes.
Capital, chèque, ou compte, le type d’instrument – qui est évoqué sur d’autres sujets comme l’éducation ou la santé – est second derrière le principe. Celui-ci, prosaïquement, consiste à concentrer intégralement les ressources dans un droit individuel à la formation, sous la forme, en quelque sorte, d’un droit de tirage. Cette idée, résolument moderne et volontariste, ne saurait se mettre en œuvre sans refonte intégrale de l’architecture contemporaine de la formation professionnelle. En un mot, une telle option appelle la suppression de la quasi intégralité des bureaucraties gestionnaires, la recomposition des organismes prestataires et la mutualisation totale des ressources publiques et privées aujourd’hui consacrées à la formation professionnelle.
En clair, la solution de la dotation individuelle suppose de dépasser les conservatismes, les corporatismes, les cloisonnements régulièrement dénoncés mais tout aussi régulièrement renforcés. Evidemment, une telle idée est empreinte d’idéalisme (qui sera dénoncé comme libéral) et d’irréalisme (qui sera souligné comme détaché des réalités). Est-elle pour autant totalement irrecevable ?
Michael Sandel, Justice, Paris, Albin Michel, 2016, 416 pages, 22 €.
Débats de justice pour tous
Enfin ! La traduction de « Justice » était attendue. L’ouvrage dont l’auteur – qui remplit des amphithéâtres et des stades – est l’un des plus grands philosophes contemporains, s’est déjà vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde. Issu de son cours à Harvard, dont la saveur et la substance sont disponibles en ligne (www.justiceharvard.org), ce parcours dans les enjeux de la philosophie politique est rigoureux et lumineux. Le pédagogue accompagne le lecteur dans le déploiement des raisonnements et dans les chocs d’arguments entre les conceptions rivales du juste. Trois grandes conceptions, utilitariste, libertarienne, communautariste visent la maximisation du bien-être, le respect de la liberté, la promotion de la vertu. Champion du troisième camp, Michael Sandel (même si la dénomination « communautarisme » ne lui convient pas) ne fait pas dans l’exégèse ésotérique des manières de concevoir la justice. Il propose une évaluation des théories de la justice à partir de situations et d’exemples très concrets. Il en va de dilemmes moraux, comme de sujets très actuels. Certains développements ont trait à ses discussions, pendant les cours, avec ses étudiants qu’il aime sonder en direct sur les sujets les plus controversées (le recours à la torture, le mariage homosexuel, la vente d’organes, la gestation commerciale pour autrui). L’idée est de mesurer les convictions, leur justification, la qualité des argumentation et des objections. Sur des sujets aussi divers que la conscription ou l’armée de métier (avec une page originale sur la Légion étrangère), l’acceptation du handicap dans une équipe de pom-pom girls, Sandel sait susciter l’intérêt et, souvent, le sourire. Comme il l’écrit, il s’agit de « se frayer un chemin sur le terrain très disputé de la justice et de l’injustice, de l’égalité et de l’inégalité, des droits individuels et du bien commun ». La thèse de Sandel veut dépasser le libertarisme et l’utilitarisme. Estimant qu’il est impossible de dire le juste sans se référer à la nature de la vie bonne, il plaide pour la promotion de la vertu et du civisme.
Vous pensez que les pouvoirs publics ne sauraient être neutres en termes moraux et religieux. Et vous critiquez ce que vous appelez la « neutralité libérale ». Quels sont les enjeux ?
Je m’oppose à une version influente du libéralisme contemporain qui insiste sur ce que j’appelle le « sujet désengagé ». La liberté de ce libéralisme postule un sujet qui n’est pas défini par ses liens d’appartenance. Il vit détaché de l’histoire, de la tradition et de l’identité culturelle. Cette conception de la liberté domine la philosophie anglo-américaine. Contre elle, je soutiens la vision de « sujets engagés », avec leurs attachements constitutifs, situés dans une existence historique, ce qui amène certaines obligations. La liberté affirmée par le « sujet désengagé » est une sorte de liberté consumériste. Je plaide en faveur d’une conception plus exigeante, sur le plan civique, de la liberté. Vous pourriez baptiser cela une conception républicaine de la liberté. Être libre ce n’est pas agir sans entrave selon mes intérêts et mes préférences. La liberté civique, ou républicaine, vise le bien commun. Ceci nécessite que les citoyens cultivent certaines vertus. En ce sens, la vie publique ne peut pas et ne devrait pas chercher à être neutre à l’égard de la vertu et de la vie bonne. La politique démocratique devrait toujours consister en délibérations autour du bien commun.
Vous soutenez cette « politique du bien commun », contre le libertarisme et l’utilitarisme.
Malgré leurs différences, notamment en ce qui concerne les bases des droits individuels, libertarisme et utilitarisme ont ceci en commun qu’ils prennent les préférences et intérêts des gens comme s’ils étaient donnés par la nature. Le libertarien insiste sur le droit de chaque personne à poursuivre ses intérêts, quels qu’ils soient, s’ils n’empiètent par sur la liberté des autres. L’utilitariste agrège les préférences des gens pour soutenir des politiques qui permettraient le plus grand bonheur du plus grand nombre. Je rejette ces deux théories au motif qu’aucune n’examine de façon critique les préférences et intérêts eux-mêmes. Aucune des deux théories ne se demande si des préférences sont valables et doivent être satisfaites tandis que d’autres ne le seraient pas. Les libertariens comme les utilitaristes soutiennent d’ailleurs le libre jeu des marchés, car les marchés prennent bien les préférences en compte, mais sans les juger ni les évaluer. Je soutiens qu’une vie bonne – pour une personne comme pour une communauté politique – implique que nous nous interrogions sur la valeur morale des préférences que nous voulons soutenir. La politique doit nécessairement passer par ces jugements moraux. Nous ne pouvons laisser notre jugement moral évoluer à la seule faveur des marchés. Nous devons délibérer, en citoyens, sur les visées et les fins qui sont dignes de nous. Nous devrions, concrètement, être plus engagés dans la confrontation des jugements moraux, cette confrontation étant inévitable dans les sociétés pluralistes.
Depuis la première édition de « Justice » en 2009, où vous vous inquiétiez déjà des inégalités croissantes, ce thème a pris de plus en plus d’importance. Quelles sont les conséquences du phénomène ?
Ces dernières décennies, les inégalités de richesse et de revenu se sont accrues. Globalement, le 1 % le plus riche possède aujourd’hui plus de richesses que les autres 99 %. Dans la plupart des sociétés démocratiques, la plus grande partie de la croissance économique a favorisé les plus aisés. Il y au moins deux raisons de s’inquiéter de la croissance des inégalités. L’une relève de la justice à l’égard des plus défavorisés et de ceux qui se trouvent au milieu de l’échelle des revenus. Un nombre croissant de personnes modestes se trouvent dépourvues d’éducation de qualité, de soins décents, de logement, de sécurité, de voix significative dans le débat public. Une deuxième raison de s’inquiéter ne procède pas de la justice mais de la cohésion sociale. Quand le fossé entre riches et pauvres devient trop large, les favorisés et les modestes vivent des vies de plus en plus séparées. Ils vivent, travaillent, consomment et se distraient à des endroits distincts. Leurs enfants vont dans des écoles différentes. Il existe ainsi de moins en moins d’espaces publics communs dans lesquels des gens d’origines sociales diversifiées se rassemblent et se rencontrent. Ce séparatisme a des impacts négatifs sur la solidarité sociale et la citoyenneté partagée. Cette séparation sape les expériences partagées de la vie quotidienne dont la démocratie a besoin.
La France est plutôt réticente à ce que vous baptisez « le fondamentalisme du marché ». Quel regard portez-vous sur nous ?
Oui, ma critique du fondamentalisme du marché est bien plus acceptée en France qu’ailleurs. Dans d’autres pays (dont le mien !), je rencontre davantage de résistances quand j’indique qu’il faut des limites au marché et aux relations de marché. Le principe de solidarité, que je tente d’encourager, est bien plus apprécié en France qu’ailleurs. J’ai cependant l’impression que la France, comme de nombreuses autres démocraties, fait face à un certain épuisement des idées politiques. Les idéologies qui ont structuré et animé le débat politique dans l’Europe d’après-guerre ont perdu leurs capacités d’inspiration. Depuis la chute du Mur de Berlin, et spécialement depuis la crise financière de 2008, nous sommes en quête d’une nouvelle philosophie publique. Nous avons besoin, à cet effet, de revigorer le discours public, en traitant plus directement des questions morales. Il y a là un défi central pour les démocraties à travers le monde. Dont la France, il me semble.
« Justice » se termine sur les sujets du patriotisme et de l’immigration. Que pensez-vous du sujet très sensible des migrants en Europe ?
Les crises des réfugiés et de l’immigration nous forcent à reconsidérer quelques-unes des questions les plus fondamentales de la philosophie politique. Quelle est la signification morale des frontières nationales ? Devons-nous nous préoccuper d’abord du bien-être de nos concitoyens ou de celui d’autres êtres humains ? Le patriotisme est-il une vertu ou un vice ? S’il est injuste pour un pays d’empêcher sa population d’en sortir, pourquoi est-il juste pour un pays d’empêcher des étrangers d’y entrer ?
Une grande partie du débat autour de l’immigration relève de l’économie. L’immigration amène-t-elle pertes d’emploi et baisses de salaires pour les travailleurs en place, ou impose-t-elle un fardeau aux services sociaux ? Mais quelque chose de plus profond est en jeu. Les débats sur l’immigration sont passionnés parce qu’ils touchent, en fin de compte, à l’identité nationale, à la communauté, à l’appartenance. Qu’est-ce qui caractérise la communauté politique ? Qu’est-ce qui nous unit en tant que peuple ? L’arrivée d’immigrants en grand nombre va-t-elle miner la cohésion sociale et les valeurs partagées ? Certains soutiennent que l’accueil d’immigrants de diverses origines culturelles peut enrichir l’identité nationale plutôt que l’éroder. Je n’ai pas de réponse simple à ces questions, mais il importe d’élever les termes du débat, en l’abordant sur la base de principes plutôt que de la seule peur.
Selon-vous le succès ne résulte pas seulement du mérite, mais aussi de la contingence. Comment expliquez-vous le succès extraordinaire de votre livre ?
Je suis étonné de la réception de cet ouvrage. Jamais je n’avais imaginé qu’un livre de philosophie politique toucherait des millions de lecteurs. Quels que soient ses propres qualités, son succès est du à des facteurs que je contrôle pas. En ce moment, dans le monde entier, il y a une grande soif de débat public sur des questions philosophiques fondamentales. Aujourd’hui, dans presque toutes les sociétés démocratiques, les citoyens sont frustrés par la politique, les responsables politiques et les partis politiques établis. Les gens sentent, à juste titre à mon avis, que les partis et responsables établis ne parviennent pas à répondre à de grandes questions essentielles qui comptent : sur la justice, le bien commun, et ce que cela signifie d’être un citoyen. Le discours public est en grande partie vide de sens moral. Il consiste, trop souvent, soit en prises de parole technocratique et étroite, qui n’inspirent personne, ou en empoignades entre partisans qui parlent les uns à côté des autres sans s’écouter. Nous manquons de débats raisonnés sur des principes concurrents. Mon livre s’adresse, à ce titre, non seulement aux chercheurs et aux philosophes, mais aussi aux citoyens qui se soucient des affaires publiques, et qui aspirent à un discours public plus profond, plus engagé sur le plan éthique. J’espère ainsi contribuer, de façon modeste, à élever et à revitaliser le discours public démocratique.
EXTRAITS
« Qui mérite quoi ? Callie Smartt était une pom-pom girl très appréciée à Andrew Hig School dans l’ouest du Texas. Elle souffrait d’un handicap moteur d’origine cérébrale et se déplaçait en fauteuil roulant, mais cela n’entamait en rien l’enthousiasme qu’elle parvenait à communiquer aux joueurs de l’équipe de football et à ses fans, par sa présence pleine d’entrain sur le bord de la touche, lors des matchs de l’équipe junior. À la fin de la saison, Callie fut cependant renvoyée du groupe. (…) La querelle des pom-pom girls a l’allure d’un cours accéléré sur la justice chez Aristote. Dans la philosophie de ce dernier, on retrouve deux idées centrales, qui figurent aussi dans la discussion concernant le cas de Callie. 1. La justice est téléologique. Définir des droits exige que nous identifions le telos (la finalité, le but ou la nature essentielle) de la pratique sociale en question. 2/ La justice est honorifique. Réfléchir au telos d’une pratique – ou se disputer à son propos – revient, du moins en partie, à réfléchir ou à débattre pour déterminer quelles vertus cette pratique devrait honorer. (…) Supposez que nous soyons en train de répartir des flûtes. Qui devrait recevoir les meilleures ? Aristote répond : ceux qui en jouent le mieux. Il serait injuste de faire des distinctions sur quelque autre critère, tel que la richesse, la noblesse, de la naissance ou de la chance. Aristote estime que les meilleures flûtes doivent revenir aux meilleurs joueurs parce que tel est ce pour quoi les flûtes sont faites : être bien jouées ».
« Kant aurait-il défendu Bill Clinton ? L’avocat du président concéda, comme l’avait fait avant lui Bill Clinton, que la relation avec la stagiaire était un mal, qu’elle était inappropriée et condamnable et que les déclarations du président à ce propos « avaient induit en erreur et trompé » le public. Il refusa de concéder une seule chose, que le président avait menti. (…) L’échange très vif sur la question du mensonge – « a-t-il menti ? » -accrédite l’idée kantienne qu’il y a, entre un mensonge et une vérité trompeuse, une différence morale significative. La différence, à mon avis, se tient là : une esquive savamment conçue rend hommage au devoir de véridicité d’une manière qui est tout à fait étrangère au mensonge direct. Dans les termes de la théorie morale de Kant, des déclarations véridiques mais trompeuses – à un meurtrier qui tambourine à la porte ou devant une commission parlementaire – sont moralement admissibles sur un mode auquel ne peuvent prétendre des mensonges éhontés. Peut-être estimez-vous que la position de Kant est peu plausible et que je me suis donné trop de peine à établir le contraire. La distinction entre un mensonge direct et une vérité trompeuse contribue cependant à éclairer le sens de la théorie morale de Kant ; en même temps qu’elle donne l’occasion d’un étonnant rapprochement entre Bill Clinton et le moraliste austère de Königsberg ».
« Que nous débattions du renflouement des banques ou des conditions présidant à l’attribution d’une décoration militaire, des mères porteurs ou du mariage homosexuel, de la discrimination positive ou du service militaire, des salaires des patrons du CAC 40 ou du droit d’utiliser une voiture de golf lors d’une compétition, les questions de justice appellent toujours une réflexion sur les notions d’honneur et de vertu, de fierté et de reconnaissance. La justice ne nous renvoie pas seulement à la question de savoir comment répartir des biens. Elle exige aussi de nous que nous sachions les évaluer ».
État-Unis : apartheid social et désobéissance civile
Julien Damon
Professeur associé à Sciences Po
La virulence de la campagne présidentielle américaine détonne. Deux ouvrages, de deux auteurs influents, renseignent sur l’état d’esprit et l’état de l’union. Inégalités croissantes et mobilité sociale diminuée étiolent le rêve américain. L’American way of life est mise à mal par les régulations publiques intrusives.
Un apartheid social naissant
Les Etats-Unis ne se fracturent plus sur des bases raciales, mais principalement selon les classes sociales. Au pays du rêve américain, la mobilité sociale est bloquée. Aux sources du problème : le fossé grandissant entre riches et pauvres en qui concerne l’éducation de leurs enfants. Célèbre professeur à Harvard, progressiste décoré par le Président Obama, Robert Putnam estime que la distance entre nantis et mal-lotis est certes monétaire, mais qu’elle est de plus en plus sociale. Naissances hors-mariage, obésité, fréquentation des Églises, pratique du sport, et – sujet important pour Putnam – dîners en famille, tout diverge de façon prononcée. Les foyers de la classe moyenne supérieure sont non seulement plus aisés et plus stables, ils sont aussi plus stimulants. Alors qu’il y avait peu d’écarts en la matière auparavant, aujourd’hui les enfants de parents diplômés bénéficient de 50 % de plus de temps d’implication des parents. Ces parents dialoguent avec leurs enfants, les éduquent, les préparent. Ils ne les obligent pas uniquement à obéir, mais les rendent aptes à réussir dans des économies gouvernées par la connaissance et les capacités cognitives. Résultat général : les enfants aisés de faible niveau scolaire ont aujourd’hui les mêmes chances d’obtenir un diplôme universitaire que les enfants pauvres bons à l’école. Ces derniers ont de moins en moins accès à des activités périscolaires devenues payantes. Putnam rend ainsi compte d’une « forme naissante d’apartheid social » (sans citer Manuel Valls) à partir de riches données agrémentées de portraits et interviews, qui illustrent plus le propos qu’ils ne le fondent. Devant ce tableau édifiant, Putnam invite à investir précocement pour le développement des enfants. Si les prescriptions du docteur Putnam n’ont rien de très original, son diagnostic sur la transformation des Etats-Unis en un pays stratifié rigidement en classes sociales de plus en plus étanches, fait autorité.
Une désobéissance civile préconisée
Le conservateur Charles Murray a fait des constats similaires à ceux de Putnam, sur la polarisation sociale et sur l’effondrement de la confiance dans les institutions publiques. Il considère maintenant que ce n’est pas en élisant un nouveau président ni en attendant les nominations des juges de Cour Suprême que viendra le changement, mais des gens. Inquiet d’une intrusion publique grandissante, Murray, ici proche du Tea Party, écrit que l’Amérique n’est plus une terre de liberté. Celle-ci s’évide à mesure que s’amoncellent les interventions et protections publiques, depuis le New Deal. La loi s’est, de surcroît, terriblement compliqué et personne ne comprend rien à des textes illisibles (le Obamacare compte plus de 400 000 mots). Alors que l’Etat aliène et sert d’abord ses propres intérêts au détriment des Américains ordinaires, Murray veut rendre le pouvoir aux individus et aux communautés. Afin de raviver la démocratie américaine, il plaide pour une campagne non-violente de désobéissance civile. Non pas contre toutes les régulations, mais contre les règlements inutiles, stupides, tyranniques. Murray entend, de la sorte, ce qui restreint l’accès à une activité, ce qui entrave la propriété, ce qui empêche les gens de prendre volontairement des risques. Qu’une agence précise ce qui est nécessaire pour la sûreté nucléaire se légitime. Qu’une autre dise combien de temps chaque soignant doit passer avec chaque patient n’a aucun sens. Murray imagine un fonds de défense, le fonds Madison (pour honorer « le père de la Constitution »), pour mutualiser les conséquences de cette désobéissance civile. Il s’agit explicitement de faire de l’intervention fédérale une sorte de risque contre lequel s’assurer. Une mobilisation collective gripperait la chaîne judiciaire par le nombre de dossiers, et épuiserait le gouvernement. Afin de sauver la liberté, Murray veut faire vivre un principe issu du sport « pas de mal, pas de faute ». Une telle orientation, qui ne changerait pas les lois mais laisserait les Américains jouer, pourrait rencontrer le succès dans de petites villes ou des espaces ruraux, surtout peuplés par les classes moyennes blanches. Au risque, accepté par Murray, d’approfondir encore les divisions américaines.
Robert Putnam, Our Kids. The American Dream in Crisis, Simon & Schuster, 2015, 272 pages.
Charles Murray, By the People. Rebuilding Liberty Without Permission, Crown Forum, 2015, 295 pages.
Allocation sociale unique : que faut-il unifier ?
De nombreux projets politiques plaident en faveur d’une allocation sociale unique. L’unification des prestations s’avère extrêmement ambitieuse. Tour d’horizon des divers sujets qu’une telle volonté de simplification et de rationalisation suppose de traiter.
L’idée d’une allocation sociale unique alimente déjà la campagne présidentielle naissante. François Fillon la propose dans son livre « Faire ». Alain Juppé a annoncé vouloir la créer. Dans son ouvrage « Ne vous résignez pas ! », Bruno Lemaire cite un conseil donné par George Osborne, le ministre des Finances britannique. « Si j’ai un conseil à te donner, lui dit-il, prépare bien ton projet d’allocation sociale unique ! Ne néglige pas les problèmes informatiques et de contrôle de fichiers ». À gauche, simplifier le système des prestations ne laisse pas indifférent. Le député socialiste Christophe Sirugue s’est vu confier une mission par le Premier ministre au sujet de la rationalisation des minima sociaux (RSA, etc.). Il doit rendre ses conclusions, très attendues, tout début avril. La Cour des Comptes suggère, de son côté, un rapprochement des principaux minima sociaux avec les prestations logement. Le think tank libéral IFRAP a même élaboré récemment un simulateur. Des voix différentes s’élèvent ainsi pour fusionner certaines prestations, allant parfois jusqu’à un revenu dit universel. Mais de quoi parle-t-on ? La matière est aussi compliquée que les enjeux sont importants. Au fond, tout dépend de ce qui est entendu par « unique ».
Plusieurs unifications nécessaires
Aller dans le sens d’une allocation unique suppose de déterminer le périmètre de ce qui sera unifié. D’abord, il faut décider de l’ensemble qui sera fusionné. Jusqu’où aller ? Faut-il, par exemple, inclure les prestations familiales ? Et pourquoi ne pas y intégrer les allocations de l’assurance chômage ? Les contours de l’allocation unique s’en trouvent changés. Tenant nécessairement compte des situations familiales et de logement, elle ne saurait être forfaitaire. Son unicité ne sera vraisemblablement pas uniformité.
Après les questions de périmètre, il faut décider d’un gestionnaire unique. Actuellement, les allocations unifiables sont gérées par les caisses d’allocations familiales, mais aussi par Pôle Emploi ou d’autres caisses de sécurité sociale, pour le compte de l’Etat ou celui des départements. Entre les collectivités territoriales, les services fiscaux, les CAF, chacun peut faire valoir ses compétences et sa légitimité. De toutes les manières, pour une allocation unique, un guichet unique s’impose. Et les problèmes sont colossaux, car avec fusion des prestations, il faut fusionner les équipes gestionnaires et les systèmes d’information. Ce grand mécanisme de fusion/acquisition n’est pas chose aisée dans le domaine social.
Il convient également de choisir, au delà des modalités de calcul et de versement, un instrument unique de financement. C’est la grande tuyauterie des finances sociales (avec, en l’espèce, des cotisations de diverses natures, des impôts locaux et nationaux) qu’il faudra intégrer dans un canal unique. Plus crucial encore, le choix des gagnants et perdants doit s’effectuer. C’est, dans ce choix, l’un des enjeux de l’unification des « droits connexes » des différentes prestations. Nationalement, certaines ouvrent droit à des tarifs sociaux pour l’eau et l’électricité, à l’exonération de la taxe d’habitation, voire à des trimestres et des points de retraite. L’unification, par le haut (mais ceci serait extrêmement coûteux) ou par le bas (mais ceci fera forcément de nombreux perdants), de ces droits connexes est épineuse. S’ajoutent, de plus, aux droits connexes nationaux, les droits connexes locaux. Les minima sociaux, peuvent, en effet, être améliorés, localement, par de l’accès gratuit à certains équipements sociaux, culturels et sportifs proposés par les collectivités territoriales. Pour que l’allocation sociale unique soit vraiment unique, elle ne devrait pas varier localement en fonction des décisions municipales ou départementales. Qui décidera, pour cette véritable unification, de mettre un terme à la libre administration des communes ? La simplification, comme toujours, apparaît très compliquée.
Allocation unique ou universelle ?
On ne saurait traiter d’allocation sociale unique sans aborder l’idée de revenu universel. Celle-ci est un serpent de mer du débat social. Certains de ses promoteurs en fêtent le demi-millénaire puisqu’elle apparaît, de façon très imagée, dans l’« Utopie » de Thomas More (parue en 1516). Sous des noms changeants, les projets sont tout de même de plus en plus précisément documentés, avec des ambitions très dissemblables. Certains, avec un tel système veulent compléter l’Etat providence. D’autres souhaitent s’en débarrasser. C’est dire combien il y a de la marge entre les diverses formulations d’un revenu universel. En tout état de projet, l’idée est toujours d’un revenu uniforme (forfaitaire), universel (servi à toute la population d’un territoire), et, surtout, inconditionnel (sans contrepartie). Le grand objectif n’est pas uniquement de lutter contre la pauvreté, mais de lutter en faveur de la liberté ; chacun doté de ce revenu de base pouvant plus aisément exercer sa liberté. Utopie irréaliste et nocive soutiennent les uns. Projet nécessaire et crédible argumentent les autres. Qui rappellent que les gouvernements finlandais et québécois ont mis très sérieusement l’idée à l’étude, tandis que les Suisses voteront en juin prochain pour savoir si le revenu de base doit être inscrit dans la Constitution. Il y a certes de grandes différences de visée entre le projet d’unification de quelques prestations sociales et celui de réviser fondamentalement la protection sociale. Les recompositions envisageables procèdent cependant d’une logique similaire : une triple ambition de clarté, d’efficacité et d’équité. Aller vers l’allocation unique, qui peut être conçue comme rapprochement de quelques prestations semblables ou comme refonte plus substantielle, n’est pas seulement un thème technocratique de barèmes et de tuyaux. C’est une question de justice. Mobilisant nécessairement des conceptions rivales de la justice sociale, l’unification constitue un sujet éminemment politique. Reposant sur des dimensions techniques redoutablement complexes.
ENCADRÉ – Le « crédit universel » britannique
Depuis 2013, les pouvoirs publics britanniques remplacent progressivement six prestations sociales et crédits d’impôt (en matière de logement, de chômage, de famille, de handicap) par une prestation unique, le « crédit universel ». Annoncé en 2010, le projet est célébré par le gouvernement conservateur qui le met en œuvre et qui annonce des résultats satisfaisants en matière d’incitation à l’emploi. Il est décrié pour ses difficultés et lenteurs de réalisation. Le programme ne saurait, de fait, toucher toutes les personnes concernées avant 2020. Les observateurs ont tous noté l’ambition de ce programme d’unification, à partir d’abord d’une phase pilote dans quatre localités qui a d’ailleurs été très retardée. Les embarras juridiques apparaissent secondaires derrière les difficultés à harmoniser les systèmes d’information. Le coût total de déploiement est estimé à plusieurs milliards de livres, notamment en raison de la coexistence, pendant la période de transition, des différents systèmes. Suscitant moins d’enthousiasme qu’à l’origine, l’exemple permet tout de même de savoir ce qu’il est possible et ce qu’il convient de faire. En ne négligeant surtout pas les aspects gestionnaires.
Diversité et complexité des allocations
Le numérique ne casserait pas tant de briques…
Julien Damon
Professeur associé à Sciences Po
La révolution numérique ne bouscule pas grand-chose. Aux conséquences réduites, dans les chiffres de la productivité comme dans la vie quotidienne, elle accompagne une période, qui va durer, de faible croissance. Une thèse iconoclaste, très documentée.
Voici un gros (750 pages) et grand livre. À rebours de nombreuses projections, l’économiste Robert Gordon soutient que les grandes innovations et disruptions associées ne sont pas devant mais derrière nous. Ni objecteur de croissance altermondialiste, ni technophobe, l’économiste de Northwestern s’oppose à ceux qu’il baptise « les techno-optimistes » qui imaginent à la fois reprise de la croissance et tsunamis dans les modes de vie. Dans sa fresque, agréable à dévorer, Gordon s’intéresse aux difficultés d’intégration des innovations dans le calcul du PIB. Surtout, il passionne par son analyse des évolutions de la consommation, de l’indice des prix, de l’espérance de vie, et du niveau de vie au-delà du seul PIB par individu.
Les révolutions sont passées
Il ressort un fascinant portrait des transformations des modes de vie des Américains en 1870 (40 millions d’âmes dépendant, fondamentalement, du cheval) à aujourd’hui (310 millions de personnes ayant tous recours à la voiture). De 1870 à 1970, les Etats-Unis ont connu un siècle extraordinaire. Les ménages sont passés, selon les mots du livre, du Moyen Age à la modernité. Ils vivaient dans des fermes isolées. À partir de 1940, ils vivent majoritairement connectés à l’eau, au téléphone, à l’assainissement, et au téléphone. En 150 ans, les enfants sont passés de l’usine aux jeux vidéos. Les hôpitaux, de « cloaques pour indigents », sont devenus des plateaux techniques qui guérissent des maladies. Réduction du temps de travail et augmentation de la productivité par tête ont nourri la dynamique de progrès. Le siècle 1870-1970 et la deuxième révolution industrielle auront été proprement exceptionnels. La période aura combiné les apports de l’électricité et de l’automobile dans une urbanisation qui facilite aussi le recours au crédit et à l’assurance. Une telle mutation, selon Gordon, ne peut avoir lieu qu’une fois. La troisième révolution industrielle, celle dite de la transition numérique, ne saurait avoir des impacts de même intensité. Pour rappeler deux augustes Français cités, Louis Lumière et Louis Pasteur ont bien davantage fait pour l’humanité que Marc Zuckerberg et Jeff Bezos. La machine à laver a plus contribué à l’émancipation et la qualité de vie que le Smartphone. L’ascenseur et le réfrigérateur ont plus fait qu’Internet.
Évolutions limitées et inquiétudes prononcées
La révolution dite numérique est bien plus étroite que les précédentes. Elle ne concerne, au premier chef, que la communication et le divertissement, soit 7 % du PIB. La transition numérique, déjà bien avancée, aura de l’influence en matière de productivité médicale. Mais petits robots et impression 3D ne révolutionneront pas la production de masse. Même le Big Data, surtout utilisé pour du marketing, n’aurait pas grande portée. Gordon ne craint ni les voitures sans conducteur, ni l’intelligence artificielle. Tout ceci ne bouleversera pas autant la vie des gens que les innovations antérieures. Et ces créations destructrices d’emplois s’accompagneront de nouvelles destructions créatrices. Gordon rappelle que les Etats-Unis sont aujourd’hui presque en situation de plein emploi, ce qui invite à s’interroger sur les chocs de la digitalisation en matière d’emploi. Notre économiste est surtout pessimiste quant à la croissance, sur les 25 prochaines années, et aux inégalités. Il s’inquiète ce qu’il baptise des « vents contraires » pesant sur la majorité des Américains : exacerbation des inégalités et érosion des revenus moyens ; dévaluation des diplômes attachée à l’inflation scolaire ; vieillissement démographique ; poids de l’endettement et des nécessaires efforts fiscaux à consentir. Gordon y va de ses préconisations : taxer davantage les plus aisés, augmenter le salaire minimum, assouplir les législations (dont celles concernant la drogue) pour désemplir les prisons, accroître la scolarisation précoce. Si le cocktail est baroque, les commentaires soulignent la qualité du propos en ce qui concerne le passé. Les critiques portent sur les prédictions. S’il est facile de dire qu’on ne sait jamais vraiment prédire productivité et croissance futures, il est vrai que notre prospectiviste fait bien peu de cas de la surprise et de l’imagination. Il semble bien sûr de lui l’auteur qui dédie son ouvrage à sa femme, « qui sait que notre amour est là pour durer ». Bien entendu l’avenir dira si Gordon aura eu raison. Mais pour le moment il faut le lire.
Robert Gordon, The Rise and Fall of American Growth, Princeton University Press, 2016, 762 pages.
RSA et bénévolat : n’importe quoi ou pourquoi pas ?
Julien Damon
Dans la famille des querelles autour du RSA, je demande la plus récente. Un département propose que le bénéfice du RSA soit conditionné à l’exercice de 7 heures hebdomadaires de bénévolat. Mais pourquoi pas s’écrient ceux qui veulent lutter contre l’assistanat et, plus largement, tous ceux qui estiment, à raison, que la prestation ne marche pas. Le RSA, qui correspond maintenant, à gros traits, à ce qu’était le RMI créé en 1988, déchaîne les passions. Il mérite cependant mieux que des propositions à l’emporte pièce. Au sujet de la toute dernière idée, trois réserves s’imposent. Tout d’abord, il est bien étrange et même tout à fait inapproprié de vouloir lier le bénévolat à une obligation. On voit bien l’idée consistant à rattacher le RSA à une contrepartie en termes d’activité. Mais le bénévolat ne saurait être ni obligé, ni rémunéré. À défaut ce n’est pas du bénévolat. Est-ce seulement de la coquetterie sémantique ? Pas vraiment. Lier RSA et bénévolat, ce n’est pas forcément dénaturer le RSA, auquel est rattaché un équilibre de droits et devoirs, mais c’est assurément dégrader le bénévolat. Certains allocataires du RSA sont déjà bénévoles dans des associations, de solidarité ou non. Doit-on vraiment les rémunérer pour cela ? Et pourquoi ne pas le faire pour les autres bénévoles ? S’il peut y avoir des assurances à prendre par les institutions qui s’appuient sur des bénévoles, s’il peut y avoir des défraiements, vouloir les rémunérer, d’une manière ou d’une autre, est un total dévoiement. Une rémunération pour une activité, avec subordination du titulaire du RSA pour la bonne mise en œuvre et le contrôle de cette activité, serait aisément requalifié en salariat, en indemnités ou en honoraires. Bien loin de la prestation sociale. Et que dire des activités « bénévoles » qui pourraient être fournies ? Comme s’assurer qu’il n’y ait pas concurrence déloyale avec des activités privées ou avec des emplois publics ? Avec toutes ces questions, il en va d’abord de la dignité du bénévolat que de ne pas être rattaché au RSA. On rétorquera qu’il ne s’agirait pas vraiment de bénévolat, mais plutôt d’activité. Et c’est la deuxième réserve. Les responsables politiques comme les gestionnaires ont, en effet, la mémoire courte. Fin 2003, le RMI a été décentralisé et confié aux départements tandis qu’était créé un nouvel outil, le RMA (revenu minimum d’activité), avec vocation d’inciter les allocataires à exercer une activité rémunérée. Complétant, sans le remplacer, le RMI, le RMA naît en 2004 dans une franche opposition. La gauche dénonce une dérogation inacceptable au droit du travail et un effet d’aubaine pour des entreprises qui trouveraient de la main-d’œuvre à bon marché. La droite valorise un dispositif nouveau, incitatif pour faciliter le retour à l’emploi des allocataires du RMI. Mais – et c’est le point crucial – le RMA est un désastre. Extrêmement compliqué à gérer, il est tombé dans l’oubli, après avoir concerné un nombre très restreint d’allocataires. On murmure qu’il aurait touché moins de bénéficiaires que l’on a compté de parlementaires pour s’écharper à son sujet. Cet accident industriel d’une prestation particulière devrait empêcher de vouloir revenir, imprudemment, sur la liaison nécessaire entre activité et RSA. Une troisième remarque porte sur le format de la proposition qui fait aujourd’hui débat. Avec 7 heures de travail « bénévole » hebdomadaire obligé, et un RSA moyen autour de 450 euros par mois, on aboutit à 16 euros de l’heure. Soit environ deux fois le SMIC horaire net. Ce qui n’est pas sans soulever des questions abyssales sur les concordances entre les deux dispositifs… En trois mots, avec la rémunération courtelinesque du bénévolat, l’oubli du spectaculaire échec du RMA, et une rémunération des allocataires du RSA à hauteur de deux fois le SMIC horaire, l’ampleur des possibles erreurs est colossale. Pour autant le RSA mérite absolument d’être profondément réformé. En ce sens d’ailleurs, des pans de la gauche comme de la droite, réfléchissent à l’établissement d’un revenu universel (qui, par définition, serait inconditionnel) et, plus prosaïquement, à une fusion des prestations d’assistance, de la toute nouvelle prime d’activité et des prestations logement. Ce qui serait, soit dit en passant, un retour au projet initial du RSA, élaboré il y a une dizaine d’années. En conclusion, il importe de réviser, avec volontarisme, le RSA. La toute nouvelle proposition, issue de la sphère départementale confrontée à l’épuisement de l’instrument, voulait peut-être simplement le rappeler.